Good vibrations. Chronique pour quatre personnages
Brice Matthieussent
LUNDI 7 FÉVRIER
DARIA
Un livre à la main, elle franchit le portail. Il neige dru, le brouillard est dense, la lumière crépusculaire. On n’entend rien, ou presque. Les voitures garées en épi sous les arbres évoquent de gros scarabées blancs hibernant côte à côte, dont les antennes verticales seraient les essuie-glaces relevés par les conducteurs prévoyants. Ses bottines crissent dans la neige fraîche parmi les traces de pas. À gauche, on ne distingue ni les bâtiments de la cité universitaire, ni la faculté des sciences, ni les collines basses qui d’habitude bouchent l’horizon. Les rares bruits sont feutrés, étouffés. Tout est ralenti, l’espace a rétréci, le lointain est gommé, le proche limité par une grisaille uniforme striée de flocons. Daria s’arrête et lève la tête pour répéter un jeu de l’enfance : les points blancs descendent lentement du ciel cotonneux comme s’ils y poussaient à l’envers, et il faut les viser pour les attraper avec la langue, où ils fondent aussitôt. Les autres flocons rejoignent la neige poudreuse qui émousse les angles du sol, d’où monte une lueur blafarde. Malgré les bottines fourrées, le manteau, l’écharpe, les gants et le bonnet, Daria est frigorifiée. Il est neuf heures moins le quart ; lundi matin, elle a cours d’histoire de l’art. Elle range le livre dans son sac à dos, un peu tard, car la couverture blanche est mouillée, assombrie par endroits. Toute cette neige la distrait.
Cela, et son récent voyage d’une semaine à Londres où, devant les photos noir et blanc de Robert Frank exposées à la Tate Modern, elle s’est sentie très émue. Daria Maret est ce qu’on appelle une âme sensible. Pas au sens péjoratif de l’expression, « âmes sensibles s’abstenir », où l’on suggère que le monde se diviserait en caractères bien trempés, capables de supporter sans broncher tous les chocs, visuels ou autres, et puis en « âmes sensibles » qui seraient des êtres d’une délicatesse excessive. Ainsi feint-on de confondre sensibilité et sensiblerie. Daria est donc sensible, non pas au point de souffrir du syndrome de Stendhal (devant un tableau d’une grande beauté ou une œuvre d’art sublime, le spectateur perd conscience et s’évanouit), mais elle a cette qualité rare de laisser naturellement ses émotions monter jusqu’à son visage et l’épiderme de son corps. De même, elle se laisse – trop aisément à son goût – envahir par les émotions des autres. Sa fascination pour l’art est liée à ce trouble momentané de l’identité. L’espace d’un instant, Daria et l’œuvre d’un artiste ne font qu’un. Bien sûr, elle ne vit pas cette expérience devant chaque œuvre, et même chez un artiste qu’elle aime toutes les œuvres ne produisent pas cet effet de fusion. Elle recherche cette sensation de perte, de dissolution, qui, loin d’être une simple diminution, une soustraction, est aussi un accroissement, une sorte de plénitude, tout en la redoutant bien sûr. À Londres, face aux images mélancoliques prises par Robert Frank aux États-Unis, devant ces photographies de format modeste mais d’une puissance rare, Daria s’est sentie happée dans le monde gris d’une Amérique granuleuse découverte par un exilé suisse dépressif. Elle s’y reconnaît dans ce monde, elle s’y trouve chez elle, en territoire familier, même si elle n’est jamais allée aux États-Unis, ni d’ailleurs en Suisse. Pour Daria, aimer une œuvre d’art c’est le contraire d’un passe-temps agréable, d’une distraction cultivée, c’est risquer de s’y perdre, de s’y dissoudre, risquer littéralement de ne pas en revenir.
Extraits

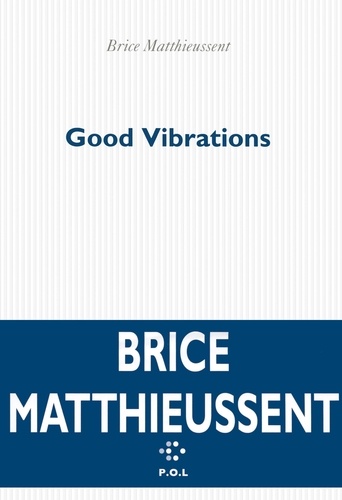


























Commenter ce livre