Arden
Frédéric Verger
Lorsque nous étions enfants, il arrivait souvent que nos parents nous confient, ma sœur et moi, à la garde d’une tante qui habitait à Montreuil au dernier étage d’une maison étroite et haute.
La bâtisse solitaire se découpait sur le ciel au sommet de la rue des Roulettes, raide côte pavée dont les virages en épingle semblables à ceux d’un col offraient à notre grande-tante un prétexte pour ne jamais sortir de chez elle. Son goût pour les charmes de la nature se satisfaisait de l’enchevêtrement d’orties et de ronces qui s’étendait à l’arrière de l’immeuble. Inépuisable réserve des rats les plus divers, où crépitaient l’été mille vies circonspectes à l’ombre d’un marronnier immense qu’on aurait cru jailli des entrailles de la cave, l’un de ces marronniers à l’écorce noire, au tronc penché, aux feuilles de dimension tropicale, qui semblent les frères sauvages des marronniers de nos parcs.
Qui aurait grimpé dans son feuillage obscur se serait retrouvé face à face avec ma tante car sa chambre s’ornait d’un balconnet minuscule, sorte de cage où elle aimait s’installer, assise sur une chaise dans le coulis du soir, le nez et la coiffe caressés des ramures.
Ses longs cheveux couleur de cendre, mal tenus par des épingles, s’ébouriffaient comme la paille d’un nid. Au sommet du crâne, elle portait, été comme hiver, parfois même pour dormir, une minuscule coiffe de satin noir dont les rembourrures matelassées faisaient penser à des carrés de chocolat, et qui tenait par deux rubans couleur d’azur noués sous le menton. D’ordinaire elle drapait sa carcasse d’un épais châle de laine à pompons, dont la couleur, sans doute sous l’action d’invisibles fluctuations de l’atmosphère, semblait explorer toutes les nuances de ce territoire mystérieux qui sépare le mauve du grenat.
Sa longue figure aux pommettes osseuses était comme fendue en deux par un nez si étroit que ses ailes avaient l’air collées et qui paraissait se contenter, par délicatesse, par bon goût, de deux piqûres d’épingles en guise de narines. Ce nez d’ivoire était si luisant, si frais, si tendre qu’il nous semblait déchirant que notre tante dût bientôt mourir. Lorsque nous levions la tête de nos jeux, souvent ses yeux nous fixaient mais ils semblaient regarder un autre monde, comme ceux des oiseaux. Sombres, du myosotis des Rocoule, tout à coup ils s’éveillaient et furetaient sur nous tandis que sur ses lèvres naissait le sourire de ceux qui surprennent quelqu’un dans sa cachette.
Souvent, en revenant de l’école, nous apercevions dans le feuillage du marronnier de petits éclairs jaunes. C’étaient les serins de notre tante échappés de leur cage toujours ouverte. Il leur arrivait de voleter ainsi autour de la fenêtre de sa chambre comme ils le faisaient d’ordinaire autour du grand lit où elle reposait le plus clair du temps, adossée à d’énormes oreillers maculés de taches brunes, semblables à celles du café ou du sang. La chambre était tout entière occupée par ce lit qui me semblait lorsque j’étais enfant si vaste, si enchevêtré de couvertures, d’édredons, de coussins d’oreillers et de châles que je ne pouvais m’y asseoir sans répugnance tant il me semblait vivant, empli d’objets oubliés qui avaient peut-être fini par acquérir leur vie propre, gorgé d’odeurs amères et parcouru de frissons, comme la mer. Nous étions pourtant obligés de nous y asseoir, ma sœur et moi, lorsque ma tante nous racontait des histoires. Elles nous plaisaient tant que nous oubliions bientôt les odeurs, les creux et les bosses du sommier défoncé qui nous avalait, et nous nous prélassions dans les édredons grenat.
Extraits

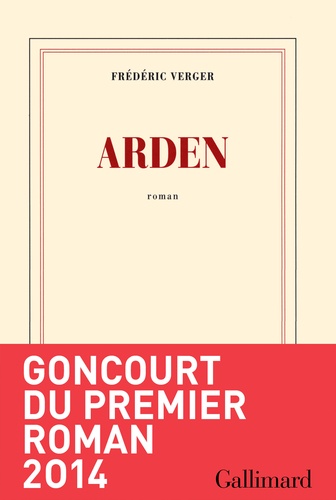




























Commenter ce livre