Ce que murmurent les collines. Nouvelles rwandaises
Scholastique Mukasonga
Editeur
Genre
Littérature française
La rivière Rukarara
« La Maritza, c’est ma rivière... », a chanté Sylvie Vartan. Moi qui n’oserai pas chanter, je me contenterai de murmurer : « La Rukarara, c’est ma rivière... » Oui, je suis bien née au bord de la Rukarara, mais je n’en ai aucun souvenir, les souvenirs que j’en ai sont ceux de ma mère et de son inconsolable nostalgie.
La Rukarara, c’est donc ma rivière, même si elle n’a jamais coulé que dans mon imagination et dans mes rêves. Je n’avais que quelques mois quand ma famille a quitté ses rives. Mon père avait été muté à Magi à la suite du sous-chef dont il était le secrétaire-comptable. Magi, c’est au sommet d’une haute crête qui domine abruptement une autre rivière, l’Akanyaru. Au-delà de l’Akanyaru, c’est le Burundi. Il n’était pas question de descendre jusqu’à la rivière. Maman interdisait à tous ses enfants, même aux garçons intrépides, de dévaler le versant de peur de nous voir rouler jusqu’au bas de la pente où nous attendaient, tapis dans les papyrus, crocodiles et hippopotames, les uns pour nous dévorer, les autres pour nous écraser, sans compter, ajoutait-elle, les bandits venus du Burundi qui se cachaient dans les marais de la berge et guettaient les enfants imprudents pour les enlever dans leurs pirogues et les vendre, à Ngozi, à Bujumbura, aux Sénégalais qui faisaient commerce de sang humain. L’Akanyaru restait pour moi, et pour mes frères et sœurs, un fleuve inaccessible que l’on apercevait tout en bas, comme un long serpent se glissant entre les papyrus et qui interdisait l’accès au monde inconnu qui devait s’étendre au-delà de l’horizon, au-delà du Burundi, un monde où sans doute coulaient d’autres rivières, d’autres fleuves que je me promettais de découvrir un jour quand je serais grande.
Quand ma famille, comme tant d’autres Tutsi, fut déportée au Bugesera, à Nyamata, le convoi de camions qui transportaient les « réfugiés de l’intérieur » dut traverser le pont de fer qui franchissait la Nyabarongo. Mais ni le fracas ni les cahots des véhicules sur le tablier métallique ne purent me réveiller d’entre les bras de ma mère. Gitagata, le village de regroupement qui nous fut assigné, était loin de la Nyabarongo. J’allais avec les autres filles chercher de l’eau au lac Cyohoha ou, pour des occasions solennelles, à la source de Rwakibirizi dont le flot abondant et intarissable semblait jaillir par la grâce d’un improbable miracle au milieu de ce pays de sécheresse qu’est le Bugesera. Les déplacés ne parlaient de la Nyabarongo qu’en la maudissant. Avec ses eaux rougies de terre tel un mauvais présage, elle était comme le mur liquide de notre prison et le pont de fer, quand j’eus à le franchir pour aller au lycée de Kigali ou en revenir, le lieu de toutes les humiliations et de toutes les violences qu’exerçaient les militaires du poste de garde. Au lycée, j’ai appris que, pour les Grecs, il fallait pour aller en enfer traverser un fleuve noir et glacé qui s’appelait le Styx ; moi, j’en connaissais un autre qui y menait aussi : la Nyabarongo.
Extraits

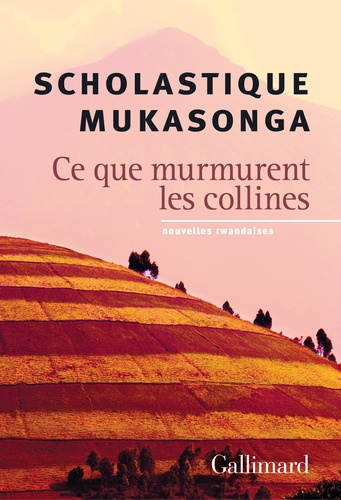



























Commenter ce livre