Charlie Fisher et le gang des Whiz
Colin Meloy
À Felix et Titine
Chapitre
PREMIER
Avant de te raconter la scène à laquelle assista Charlie Fisher, ce mardi d’avril 1961, avant de te décrire ce moment exceptionnel qui déclencha une série d’événements et bouleversa le cours de sa vie, avant cela, je dois d’abord t’expliquer qui était Charlie et par quel hasard il était assis, place Jean-Jaurès, à Marseille, par cette chaude matinée.
Pour commencer, Charlie était en vacances. Plus exactement, son père lui avait suggéré de réfléchir à la situation délicate dans laquelle il se trouvait. De fait, depuis quelques années, sa vie ressemblait à des vacances perpétuelles. Quelle chance, quand on a douze ans, dois-tu te dire. Pourtant, si ton existence n’était qu’une interminable récréation, tu finirais sans doute par trouver le temps long. En tout cas, c’est ce qu’éprouvait Charlie.
Le père de Charlie était Charles Fisher Senior en personne. Ce nom ne t’évoque sans doute rien, tout cela date d’il y a fort longtemps, bien avant ta naissance. Tes grands-parents, eux, ont certainement entendu parler de Charles Erasmus Fisher Sr., le célèbre diplomate américain qui avait épousé la jeune héritière allemande Sieglinde Dührer au cours d’une grande cérémonie organisée au château de Louis II de Bavière. La mère de Charlie, Sieglinde, était une belle femme, une actrice de théâtre réputée, dont Charles Sr. était tombé amoureux lors d’un voyage à Vienne, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leur mariage fut de courte durée et suffisamment spectaculaire pour faire couler l’encre des journaux à scandale. Quand Charlie eut sept ans, ses parents étaient déjà séparés depuis longtemps ; le divorce ne fut qu’une simple formalité. Le garçon connaissait à peine son père : celui-ci n’avait passé que très peu de temps auprès d’eux dans la maison familiale située dans le quartier de Georgetown, à Washington. Charlie recevait régulièrement des cartes postales qui portaient l’écriture soignée de Charles Sr. et provenaient de villes aussi exotiques que Moscou, Buenos Aires ou Yokohama, mais il pouvait compter sur les doigts d’une main le nombre de soirs où son père lui avait lu une histoire. Sieglinde, aidée d’une cohorte d’assistantes, d’infirmières et de gouvernantes, était la seule véritable famille de Charlie. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise quand, un beau matin, sa mère lui déclara tout net qu’elle était fatiguée de son rôle de mère et que Charlie, à partir de ce jour, irait vivre avec son père. Il pouvait dorénavant la considérer comme une « super tante », qui serait là s’il en avait un jour besoin.
Charlie avait-il le choix ? Il n’était qu’un petit garçon de neuf ans… La femme de chambre, Penny, l’aida à emballer ses biens les plus précieux (sept livres, quelques vêtements et une boîte de petits soldats), puis déposa un baiser sur son front une fois qu’il fut assis sur la banquette arrière de la Lincoln Continental. Il fut conduit à l’aéroport et mis dans un avion à destination du Maroc, où l’attendait son père. À partir de cet instant, Charlie vécut la vie d’un enfant de diplomate, naviguant sans cesse d’un continent à l’autre, de Toronto à Bombay ou à Vladivostok ; les semaines et les mois qui défilaient ressemblaient à des vacances sans fin.
Et il s’ennuyait à mourir.
C’était exactement ce qu’il ressentait, assis sur la place Jean-Jaurès, à Marseille, par cette chaude matinée du mois d’avril 1961. Si tu étais aussi désenchanté et fatigué du monde que Charlie, tu saurais que Marseille est une célèbre ville portuaire de France, située au bord de la mer Méditerranée. Et si tu avais passé autant de temps que lui dans les avions, à digérer des livres prescrits par ton pot de colle de professeur particulier, tu saurais qu’Edmond Dantès, le héros du Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas, a été emprisonné au château d’If, une forteresse édifiée au seizième siècle sur une petite île au large de Marseille. Surtout : si tu avais eu droit à autant de sermons sur la sécurité que Charlie, en raison d’un père sévère et d’une armée d’assistants et de secrétaires, tu saurais que beaucoup de gens considèrent Marseille comme le paradis des voleurs.
Cette idée excitait Charlie : le royaume du crime, à côté de chez lui ? Cela le changeait agréablement des avenues modernes et aseptisées de Zurich ou des résidences surveillées de Hong Kong. L’imagination du garçon de douze ans n’attendait que ça pour s’enflammer. Cependant, après quelques semaines passées dans sa nouvelle maison, il comprit que le véritable fléau qui menaçait Marseille, c’était les touristes.
Les touristes bruyants et râleurs.
Charlie trouva néanmoins une façon de faire bon usage de cette découverte. Il exposa son plan à son professeur particulier, un jeune homme de vingt-cinq ans, constamment grincheux, prénommé Simon : s’il écrivait des histoires de cinq cents mots sur des personnes qu’il voyait dans la rue, cela compterait pour sa note de rédaction. Un pacte fut conclu ; un auteur de nouvelles était né. Charlie se plaisait à imaginer le monde intérieur des hordes de touristes, tout juste débarqués d’un bateau de croisière, qui envahissaient les rues et les places de la ville. C’est ainsi qu’il s’installa sur un banc, pour observer les vacanciers insouciants qui déambulaient dans le marché animé de la place Jean-Jaurès, ce mardi matin.
Une jeune femme avec des lunettes de soleil suivait à la trace un homme d’âge moyen qui inspectait les innombrables marchandises sur les étals. Le stylo-plume de Charlie (un Sheaffer Imperial en argent, offert par son père pour ses onze ans) resta un instant en suspens au-dessus des lignes de son cahier de rédaction avant de délivrer le passage suivant : Elle était l’héritière d’une fortune bâtie sur la culture de la betterave sucrière. Il était représentant de commerce en huile de serpent. Ils s’étaient rencontrés sur un yacht. Il lui avait promis la jeunesse éternelle. Elle devait, pour cela, le suivre autour du monde pendant qu’il cherchait les ingrédients nécessaires à l’élixir de jouvence. Elle ne s’était pas doutée que cette quête était l’affaire d’une vie.
Charlie inclina la tête en relisant ce qu’il venait d’écrire. Un sourire illumina son visage. Il lissa du plat de la main la page suivante de son cahier.
— Qu’est-ce que tu fais ? demanda une voix.
— Pardon ?
Charlie leva les yeux et vit un garçon vêtu d’un jean cigarette et d’un tee-shirt blanc, assis à côté de lui sur le banc. Sa peau caramel et ses cheveux bruns laissaient penser qu’il était originaire d’un pays du Moyen-Orient.
Comme c’est la première fois que tu entends parler Charlie, il faut que tu saches qu’il avait une voix grave et calme qui, au cours des derniers mois, avait baissé d’au moins deux tons. Ce changement le rendait un peu timide, ce qui est fort compréhensible. Sur ordre de sa mère, à l’âge de huit ans, il avait consulté un orthophoniste, en raison d’un léger bégaiement survenu lorsqu’il était en maternelle. Il avait réussi à se débarrasser de ce défaut, mais il avait pris l’habitude, entre-temps, de « parler dans sa barbe », comme disait son père. Même si Charlie ne savait pas ce que cela signifiait, nous devons faire confiance au jugement de Charles Fisher Sr. ; par conséquent, tu es invité à lire les propos de Charlie en tenant compte de cette indication. Néanmoins, sache aussi que cette règle ne s’applique qu’aux douze premiers chapitres. Après cela, tu découvriras qu’il commence à s’exprimer d’une voix totalement différente. Quoi qu’il en soit, à ce moment-là du récit, Charlie parlait dans sa barbe.
— J’ai dit : qu’est-ce que tu fais ? répéta le garçon assis sur le banc. Tu écris des poèmes ou un truc du genre ?
— Non, répliqua Charlie d’un ton prudent. J’écris juste des histoires.
— Des histoires…
Le garçon ramassa un morceau de bois et se mit à gratter le banc, l’air absent.
— Super, ajouta-t-il. Comme le vieil homme avec une barbe ?
— Quel vieil homme avec une barbe ?
Le garçon fit une grimace ; fouiller dans sa mémoire semblait représenter un terrible effort.
— Comment il s’appelle, déjà… ? Il écrit des histoires. Heming… ford ?
— Hemingway, corrigea Charlie. Ernest Hemingway.
— C’est ça ! s’exclama le garçon avec un sourire.
— Je ne me comparerais pas à lui, mais l’idée générale est la même.
— Continue, je t’en prie, dit le garçon. Je te regarde juste.
Charlie sourit poliment. Il se tourna pour observer l’esplanade, à la recherche de son prochain sujet. Il fut tiré de ses pensées par le garçon qui commenta :
— Ah, je vois !
— Quoi ?
— Tu écris ce qui se passe. Sur la place.
— Oui, en un sens.
— J’ai pigé. Continue.
Charlie s’apprêtait à le faire, quand il fut encore interrompu.
— Et lui, qu’est-ce que tu en penses ?
— Qui ? demanda Charlie, légèrement agacé.
— Ce gars, là. Celui avec un chapeau blanc.
Le garçon pointa son doigt vers la foule qui se pressait sur le marché. Un homme costaud, vêtu d’un costume rayé bleu et blanc, ample, et coiffé d’un panama immaculé, déambulait dans les allées. Tous les cinq pas, à peu près, l’homme levait le bras et écartait la manche de sa veste pour consulter sa montre.
— Ah, pas mal ! approuva Charlie.
Cependant, le garçon paraissait guetter le moment où le jeune auteur se remettrait à écrire. Être ainsi observé mit Charlie mal à l’aise. Le garçon dut s’en rendre compte car il recommença à examiner le bâton dans sa main.
Charlie écrivit : Allait-il arriver ? L’homme au bras robotique avait dit qu’il serait à La Plaine à deux heures. Il ne restait que peu de temps avant que les sentinelles des Martiens n’arrivent pour réclamer leur rançon.
Il venait à peine d’achever cette dernière description quand une scène un peu étrange attira son attention. Une fille semblait suivre l’homme au panama qui se faufilait entre les étals des vendeurs, et il était évident qu’elle n’avait aucun lien avec lui.
Il ajouta ces mots : Sans éveiller les soupçons de Radcliffe, la sentinelle des Martiens était arrivée, sous l’aspect d’une petite fille.
Charlie reprit son observation : l’homme au costume rayé serpentait à présent entre des poteaux métalliques tel un skieur dans un slalom, tandis que la fille, à quelques mètres de distance, imitait chacun de ses virages. Quand l’homme scrutait sa montre, elle en profitait pour se rapprocher de quelques centimètres. Charlie tapota son stylo contre sa joue. Il avait passé suffisamment de temps sur cette place, ce mardi matin, pour avoir une idée précise de l’activité du marché et de l’interaction entre ses occupants. La fille qui suivait l’homme semblait opérer en dehors de ce système, comme si elle était une ombre ou un fantôme existant au-delà ou au-dessus de l’agitation du marché et du monde réel. Comme le ferait probablement une sentinelle des Martiens.
Au même instant, il aperçut devant l’élégant personnage un garçon qui avait la même attitude que la fille et qui avait l’air tout aussi étranger à l’homme qu’elle. Plus surprenant encore : en regardant attentivement, Charlie se rendit compte que le garçon était, en quelque sorte, en train de diriger l’homme au panama : il le ralentissait et lui bloquait le passage. Il commença même à en contrôler les mouvements, se plaçant à sa gauche quand l’homme se dirigeait vers la gauche, ralentissant l’allure quand celui-ci accélérait, sans que la cible n’en ait jamais conscience. Pendant ce temps, la fille qui était derrière l’homme, elle, le suivait telle une ombre, devenant presque une extension de son corps.
Et c’est à cet instant que survint l’événement qui donnerait un virage à quatre-vingt-dix degrés à la vie rectiligne de Charlie Fisher.
L’homme fut dépouillé.
Plus exactement : des pickpockets le volèrent.
Pas un vol éclair dans un moment de distraction, non : tout avait été très bien orchestré, digne d’une chorégraphie soigneusement préparée. Charlie vit à peine l’action, comme lorsqu’on aperçoit du coin de l’œil un oiseau-mouche s’approcher brièvement, avant qu’il ne s’envole. Le garçon placé devant s’arrêta soudain afin que l’homme stoppe sa marche à quelques centimètres seulement de son dos. Un troisième enfant sortit de nulle part : un garçon de l’âge de Charlie apparut alors dans la foule et, d’un geste tranquille, donna un léger coup à l’arrière du chapeau de l’homme, de telle sorte que le couvre-chef descendit légèrement sur son front. L’individu, pensant avoir été simplement bousculé, sortit la main de la poche de son pantalon et releva le bord de son chapeau. La fille, parfaitement positionnée derrière lui, profita de cette seconde pour glisser doucement la main sur le côté du pantalon de l’homme – un geste léger, comme quand on balaye une miette sur sa manche –, puis elle se mit brusquement à courir. Un quatrième enfant – un autre garçon – se détacha de la foule et se plaça à côté de la fille. Un objet marron fut transféré de l’une à l’autre : un portefeuille.
Le détroussage de l’homme ne s’arrêta pas là. Le garçon qui avait heurté son chapeau se retourna et, pour s’excuser de sa maladresse, tendit le bras pour une poignée de main amicale. L’homme, qui ignorait encore qu’il n’avait plus son portefeuille, serra la main du garçon avec un sourire réservé. Ce dernier s’inclina puis disparut dans la foule.
L’homme poursuivit sa déambulation au milieu des marchands qui criaient dans les allées du marché afin d’attirer le chaland. Lorsqu’il s’arrêta, une fois de plus, pour jeter un coup d’œil à sa montre, il se figea sur place. Même de là où il était posté, Charlie put voir, lui aussi, la même chose que l’homme : son poignet était nu. Plus de montre.
Charlie éclata de rire. Il ne put se retenir. Il était stupéfait et impressionné. Il avait beau savoir qu’il venait d’assister à un vol, celui-ci s’était déroulé avec une telle fluidité et une telle maîtrise qu’il en paraissait à peine illégal. Pour Charlie, c’était de la magie pure.
— Tu as vu…
Il se tourna sur sa droite pour voir si le garçon en jean avait été témoin de la même scène que lui… et découvrit qu’il était seul sur le banc. Le garçon était parti. Il scruta alors la foule à la recherche des quatre enfants qui avaient mené cette incroyable opération. Ils s’étaient volatilisés. Il se rendit bientôt compte que d’autres silhouettes, dans le marché grouillant de monde, enveloppaient leurs victimes avec la même agilité. Avant le vol, la place était apparue à Charlie semblable à un champ de trèfles : paisible, sans rien d’exceptionnel. Mais sa vision s’était resserrée et il admirait à présent le régiment d’abeilles qui pillaient le riche nectar des trèfles. C’était comme s’il avait découvert la ruche secrète : la place Jean-Jaurès et son effervescence, un mardi matin, était le territoire des pickpockets.
Sidéré, Charlie leva son stylo machinalement pour se gratter le nez. Mais quelque chose clochait. Il baissa les yeux pour regarder ce qu’il y avait dans sa main.
Le stylo n’était plus là.
Il tenait un morceau de bois.
Chapitre
DEUX
Pendant un moment, Charlie envisagea l’idée de n’avoir jamais possédé de stylo-plume Sheaffer Imperial et de s’être servi depuis toujours du morceau de bois qu’il avait maintenant dans la main. Il imagina son père et ses fidèles assistants jouer la comédie auprès du pauvre garçon à l’esprit confus, qui choyait son bâton bien-aimé tel un stylo précieux, jusqu’à ce que Charles Fisher Sr. l’envoie dans une clinique spécialisée. Heureusement, cette brève fantaisie passa et Charlie recouvra ses esprits.
Une chose était certaine : son stylo n’était plus là. Au même titre que la montre et le portefeuille de l’homme au panama, il avait été volé. Mais comment ?
Un soudain regain d’activité sur la place Jean-Jaurès le sortit de sa sidération. Quelques visiteurs du marché s’adressaient à présent à des policiers qui déambulaient entre les stands. Ils hurlaient en boucle : « AU VOLEUR ! » Charlie contempla la place transformée en chaos et les dizaines de promeneurs qui vérifiaient avec angoisse le contenu de leurs poches et de leurs sacs. Un éclair bleu et blanc, juste à la gauche de Charlie, l’alerta sur une rixe qui venait d’éclater sur un côté de la place. Là, il vit le garçon qui, quelques instants plus tôt, l’observait en train d’écrire. Le garçon en jean et tee-shirt blanc, qui grattait d’un air distrait le banc avec un bout de bois.
Charlie marmonna tout seul, pendant que les synapses de son cerveau reconstituaient laborieusement le déroulé des événements : stylo, garçon avec bout de bois, stylo parti, bâton resté, garçon parti. Les images se déversèrent sur lui comme des diapositives projetées en accéléré.
Le temps que Charlie retrouve une activité mentale normale, le garçon s’était échappé, après une bagarre avec un policier costaud dont il sortit vainqueur. Il détala le long d’une des nombreuses avenues qui s’ouvraient autour de la place tels les pétales d’une fleur. Il avait été repéré par la plupart des gardiens de la paix qui patrouillaient et cherchaient désespérément un suspect à arrêter. Un bataillon de policiers tout de noir vêtus s’échappa au galop de la place Jean-Jaurès, à la poursuite du voleur de stylo.
Charlie se leva d’un bond, son cahier de rédaction coincé sous le bras, et courut derrière eux. Il éprouvait un étrange sentiment de possession vis-à-vis de ce garçon. C’était son voleur qu’ils pourchassaient.
— Attendez ! cria-t-il.
Personne ne parut l’entendre. Ni même lui prêter attention.
Le voleur fut retardé un court moment rue Sibie, après avoir renversé un présentoir devant une librairie. Cela permit à Charlie de rattraper son retard. Une pluie de livres virevolta sur le trottoir et le garçon dut batailler pour rester debout ; deux des quatre policiers se montrèrent moins agiles : ils trébuchèrent, tombèrent l’un sur l’autre et se retrouvèrent ainsi hors course. Charlie esquiva habilement l’obstacle et garda le rythme, toujours aux trousses des deux autres policiers. Apercevant la police, une femme qui vendait illégalement des pistaches sur le trottoir se dépêcha de mettre sa marchandise à l’abri.
Quelques dizaines de mètres après la librairie, la rue Sibie croisait la rue des Trois-Mages et son flot trépidant de voitures qui la rendait difficile à traverser. Le garçon au tee-shirt blanc agit en expert, naviguant entre les scooters vrombissants et les coupés Peugeot comme un toréador qui esquive une armée de taureaux. Ses poursuivants n’avaient ni son agilité ni sa taille, si bien que l’un des policiers percuta bruyamment une Vespa sur laquelle circulaient deux jeunes gens. La machine glissa sur la chaussée dans un cliquetis de ferraille tandis que la circulation s’arrêtait.
— Pardon, pardon, dit poliment Charlie en tentant courageusement la traversée.
La politesse était importante : en tant que fils du consul américain, il devait veiller à sa réputation. Pour toute récompense, il reçut une avalanche d’insultes hystériques. Une fois en sécurité sur le trottoir d’en face, il vit que les deux policiers avaient réussi à attraper le garçon. L’un le tenait par l’encolure de son tee-shirt, l’autre lui palpait les poches.
Tandis que les policiers le réprimandaient avec véhémence, le garçon levait les mains et répétait en boucle :
— Pas bien parler français !
Ils venaient tout juste de sortir un stylo (le Sheaffer Imperial de Charlie) de la poche avant du pantalon du voleur et l’agitaient devant son visage quand Charlie arriva sur place.
— Où sont les portefeuilles ? Qu’est-ce que tu as d’autre ?
— Rien, je vous jure ! cria le garçon. Juste le stylo, c’est tout.
Excité et essoufflé, Charlie fit irruption dans la discussion :
— C’est mon stylo !
Tous se figèrent. Puis les trois individus qui étaient devant Charlie tournèrent la tête pour regarder le nouveau venu.
— Parfait, déclara l’un des policiers, pas peu fier. Nous avons la victime.
À cet instant, Charlie prononça une phrase inattendue, qui le surprit lui-même :
— Ce n’est pas un voleur.
— Pas quoi ?
— J’ai dit : ce n’est pas un voleur, répondit Charlie.
— Il y a de fortes chances que si, décréta le policier.
Charlie prit une profonde inspiration.
— Je le lui ai donné, annonça-t-il. Je lui ai donné le stylo.
L’autre policier, qui tenait toujours le garçon par son tee-shirt, lança un regard méprisant à Charlie.
— Tu le lui as donné ? s’étonna-t-il.
Sa lèvre supérieure était surmontée d’une fine moustache.
— C’était un cadeau, expliqua Charlie. Laissez-le partir, s’il vous plaît.
Sans lâcher le garçon, le policier reporta son attention sur Charlie.
— Qui es-tu ? demanda l’homme.
— Je m’appelle Charlie Fisher, je suis américain, rétorqua-t-il.
Il montra le corps du stylo, où son nom était gravé en élégantes lettres cursives.
Lentement, à contrecœur, le policier lâcha le tee-shirt du garçon. Celui-ci trébucha et recula de quelques pas. Lui aussi dévisageait Charlie avec stupéfaction. Il était tellement étonné, en réalité, qu’il mit un certain temps à répondre quand l’autre policier lui demanda :
— C’est vrai ?
— Oh… oui ! bégaya le garçon. Pour sûr, c’est la vérité.
Il baissa les yeux sur le stylo, comme s’il le voyait pour la première fois.
— Merci beaucoup. Pour ce stylo.
Charlie sourit.
— Ça me fait plaisir. J’espère que tu en feras bon usage.
Il fixa ensuite les deux policiers, se redressa, et ajouta, plein d’assurance :
— Vous pouvez partir. Tout va bien, ici.
Les deux policiers échangèrent un long regard, un peu perdus. L’un d’eux ouvrit la bouche pour parler mais Charlie balaya sa remarque d’un geste de la main.
— Franchement, messieurs, vous avez sûrement mieux à faire, articula-t-il.
— Très bien, dit finalement l’un des policiers. Si c’est la vérité.
— Ça l’est.
— Eh bien, dans ce cas…, dit l’autre policier.
— Bonne journée, messieurs ! lança Charlie d’une voix forte.
Les policiers s’attardèrent encore un moment, examinant les deux garçons comme s’ils cherchaient à mémoriser l’emplacement précis de leurs taches de rousseur. L’un marmonna quelques mots, l’autre rit dans sa barbe, puis tous deux s’éloignèrent.
Après leur départ, le garçon au tee-shirt blanc scruta Charlie à travers les mèches brunes qui lui tombaient devant les yeux. Il jeta un coup d’œil au stylo, qui était toujours dans sa main.
— Je peux vraiment l’avoir ?
Charlie rit de bon cœur.
— Oui, à une condition, dit-il.
— Laquelle ?
— Tu me montres comment tu as fait ?
Le garçon s’appelait Amir et était originaire du Liban – en tout cas, c’est ainsi qu’il se présenta. Il prononça son nom et son pays de naissance avec une assurance un peu suspecte. Il ne donna pas son nom de famille et Charlie ne l’y força pas. Il prétendit ne pas avoir voulu voler le stylo, au départ (il s’était dit que Charlie ne méritait pas ça), mais après l’avoir vu s’en servir et avoir lu les phrases qu’il avait écrites avec, il avait soudain eu envie de le posséder. Comme si c’était le stylo qui permettait à Charlie de créer ses étranges histoires à partir de rien.
— Donc je l’ai pris. C’est aussi simple que ça.
Ils longèrent quelques pâtés de maison et arrivèrent à une fontaine ; elle était entourée de petits murets de pierre qui les invitaient à s’asseoir. Charlie regarda son nouveau camarade, intrigué.
— Ça ne doit pas être aussi simple. J’avais le stylo dans ma main, quand même.
— Je ne sais pas comment t’expliquer. Tu avais le stylo dans la main, oui. Mais tu regardais ailleurs, hein ? Tu ne faisais pas attention au stylo.
— Mais je n’ai pas besoin de le regarder pour savoir qu’il est dans ma main.
Le garçon fit une grimace, l’air excédé.
Charlie sourit.
— Tiens, donne-moi le stylo, dit-il.
— Le stylo ?
Le garçon fronça les sourcils et baissa les yeux sur la tête du Sheaffer Imperial qui dépassait de sa poche.
— Je te le rendrai, ne t’en fais pas, précisa Charlie.
Le stylo et le bout de bois (que Charlie avait gardé en souvenir du vol) changèrent de propriétaire pour la seconde fois de la journée. Charlie prit le stylo dans la main droite et le tint comme pour écrire.
— Refais-le, demanda-t-il en montrant d’un signe du menton le bâton dans la main du garçon.
Amir rit.
— Mais je ne peux pas, maintenant.
— Pourquoi pas ?
— Bah ! t’es au parfum.
— Au parfum ? demanda Charlie.
— Ça veut dire que tu te méfies de moi. Tu sais que j’ai l’intention de le chourer.
Le garçon se passa la langue sur les lèvres. Quelques poils dessinaient une ombre au-dessus de sa bouche. Ses dents de devant avaient poussé de travers.
— D’accord, dit Charlie. Je vais faire comme si je ne savais pas.
Amir sembla trouver cette idée acceptable.
— Remets-toi dans la même position, indiqua-t-il. Comme si tu écrivais.
— D’accord, répéta Charlie en sortant son cahier de sous son bras.
Il l’ouvrit à une page blanche, le stylo en l’air, prêt à écrire. Il attendit, son regard bifurquait de temps à autre vers le garçon assis à côté de lui. Celui-ci ne bougeait pas.
— Bon, il faut que tu écrives quelque chose, expliqua Amir.
— Ah !…
Charlie commença à écrire son nom : Charlie Fish…
SCRATCH ! Une tache d’encre gicla sur la page lorsque Amir se pencha et arracha maladroitement le stylo de la main de Charlie. Celui-ci tressaillit et lança un regard au garçon.
— Pas comme ça ! protesta le jeune auteur.
Amir rit de bon cœur.
— C’est la manière la plus simple, dit-il en s’amusant à faire tourner le stylo entre ses doigts. Tope et tire comme un vrai zig.
— Fais-le pour de bon, avec le bâton.
— D’accord, dit Amir en rendant le stylo. Pour de bon, cette fois.
Charlie répéta l’opération : il tint son stylo en l’air pendant quelques secondes, puis il commença à écrire son nom. À sa grande surprise, aucune trace d’encre n’apparut sur la page. La plume grattait bruyamment le papier mais ne dessinait aucun trait. Charlie examina le stylo pour s’assurer que ça n’était pas un morceau de bois. À l’évidence, ça ne l’était pas. Il tourna son regard vers Amir.
Dans le creux de sa main, Amir avait la cartouche d’encre.
— Comment as-tu…, bafouilla Charlie. C’est impossible.
Le garçon haussa les épaules.
— Personne ne t’oblige à y croire, hein, dit-il. Je peux récupérer mon stylo ?
Sans un mot, Charlie lui tendit le stylo vide. Amir le prit, le dévissa et remit la cartouche en place.
— Tu connais les autres ? demanda Charlie, au bout d’un moment. Les pickpockets du marché ?
— Peut-être, répondit le garçon.
— Tu peux me le dire. Je n’en parlerai à personne.
Amir joua avec le stylo entre ses doigts avant de lâcher :
— Je vais d’abord te poser une question.
— C’est de bonne guerre, dit Charlie.
— Pourquoi tu ne m’as pas balancé ? demanda Amir.
— Pourquoi je n’ai pas quoi ?
— Pourquoi tu n’as pas dit à la police que je t’avais volé ton stylo, tout à l’heure ?
— Ça m’intriguait, répondit Charlie. Et tu avais l’air gentil. Tu ne méritais pas d’être arrêté.
— Tu ne le savais pas, à ce moment-là.
— J’ai eu une intuition, dit Charlie avec un sourire.
— Tu es peut-être trop sympa, Charlie Fisher, ajouta Amir. Peut-être que tu ne devines pas si bien que ça les gens ?
— Je pense être plutôt bon juge.
— Je t’ai volé. Ça fait de moi un criminel.
— Mais un criminel d’une espèce rare. Tu sais faire des choses que peu de gens savent faire.
Amir haussa les épaules, perplexe.
— Apprends-moi, dit Charlie. Montre-moi comment faire.
Le garçon siffla entre ses dents et secoua la tête.
— Je ne peux pas, Charlie Fisher, je suis désolé. Nous appartenons à deux mondes différents, toi et moi. Tu fais partie du monde normal, tu vois. Je suis un zig. Les deux ne se mélangent pas.
— Un zig ?
— Un canon. Un escroc. Je suis dans le Whiz.
— Je ne te suis toujours pas.
— Un pickpocket, Charlie. Je suis un voleur. Et toi ? Tu es un bon petit Américain. Qui écrit des histoires. Je pense que tu devrais continuer dans cette voie.
Charlie ne se laissa pas décourager.
— Dans ce cas…, dit-il en redressant les épaules. Réflexion faite, c’est bien mon stylo. Je me suis trompé, tout à l’heure, avec les policiers.
— Tu ne ferais pas ça, s’inquiéta Amir.
— Ah non ?
À quelques mètres de là, sur une avenue encombrée, on pouvait voir deux policiers en train de faire la circulation.
— Ces deux-là me semblent plutôt sympathiques, reprit Charlie.
Les deux garçons se regardèrent droit dans les yeux, sans un mot. Autour d’eux résonnait le grondement des rues de Marseille. Amir continuait à faire tourner le stylo entre ses doigts habiles.
— Tu me mets dans une situation délicate, lâcha-t-il finalement.
Il se passa la langue sur les lèvres et fit une grimace avant d’ajouter :
— Très délicate.
Charlie haussa les épaules.
— Allez…, insista-t-il.
— Je vais réfléchir, dit le garçon, après un moment.
— Où et quand ? pressa Charlie en lui laissant à peine le temps de finir sa phrase.
Amir secoua la tête d’un air désapprobateur.
— Ça ne se passe pas comme ça d’habitude. Faut que je voie…
Il réfléchit un instant, puis proposa :
— Demain, je viens chez toi, et je te montre. OK ?
— OK, accepta Charlie, qui lui tendit la main pour sceller cet accord en bonne et due forme.
Amir la serra. Puis il se leva et glissa son nouveau stylo dans la poche de son jean.
— Merci encore pour ce cadeau, Charlie Fisher, conclut-il d’un ton solennel en s’inclinant. À la prochaine.
Un tramway plein de voyageurs descendait le cours Belsunce dans un cliquetis métallique ; Amir courut pour l’attraper. Il sauta sur la plateforme arrière, s’accrocha à la rambarde puis se tourna pour faire un dernier signe de la main à Charlie avant de disparaître.
Charlie le regarda s’éloigner. Il était impressionné par son agilité et l’élégance de ses gestes. Si seulement lui, Charlie, possédait une telle grâce et une telle assurance, songea-t-il. À quoi ressemblerait sa vie, alors ? Malheureusement, il n’était que Charlie Fisher Jr., l’Américain sans amis, le gribouilleur de l’avenue du Prado. En pensant à l’avenue du Prado, soudain il sursauta.
— Attends, Amir ! cria-t-il en direction du tramway, parti depuis longtemps. Tu ne sais pas où j’habite !
Chapitre
TROIS
Charlie avait donc été dupé pour la seconde fois. C’était mérité : il avait essayé d’obtenir les faveurs d’un voleur chevronné. Son père lui reprochait de toujours chercher les mauvais compagnons. Il l’avait mis en garde : s’il continuait sur ce chemin, il risquait d’être constamment seul. L’expérience de Charlie avec le pickpocket ne faisait que confirmer cette théorie. Son père serait furieux : il lui avait fait cadeau de ce stylo avec l’idée qu’il soit transmis de génération en génération. Le jeune garçon le possédait depuis un an à peine.
Tout en ruminant cette mésaventure, Charlie longea le cours Belsunce jusqu’à la Canebière, d’où il rejoignit les rues animées du Vieux-Port. Une forêt de mâts s’y reflétaient dans l’eau mouchetée de soleil, pendant que les touristes, agglutinés sur les quais dans la chaleur des rayons, formaient des queues interminables pour monter dans les bateaux à destination des îles. Charlie était en retard pour le déjeuner avec son père ; ils étaient convenus de se retrouver au Miramar, un restaurant sur les quais, à 13 h 30. Il marchait en gardant les mains dans les poches, maintenant qu’il avait fait l’expérience, à ses dépens, de l’insécurité qui régnait sur certaines places de Marseille. Tout le monde lui semblait soudain suspect. Une femme avec un nuage de ballons qui montait jusqu’aux lampadaires interpella Charlie quand il passa devant elle et il sursauta en enfonçant ses mains encore plus profondément dans ses poches. Même l’inoffensif vendeur de savons, habillé comme s’il sortait tout droit d’un tableau de Manet, avec son maillot rayé et son bonnet phrygien, parut louche aux yeux de ce pauvre Charlie.
Lorsqu’il atteignit enfin les tables du restaurant dressées sur le quai, le jeune garçon avait tellement les nerfs en pelote qu’il eut le plus grand mal à se signaler auprès du maître d’hôtel sur son trente et un. Heureusement, les Fisher étaient connus au Miramar et Charlie fut expédié vers l’intérieur de l’établissement d’un bref geste de la main. On l’amena à une table située dans un coin de la salle, où son père, Fisher Senior, donnait l’assaut à un grand plateau de fruits de mer. Tandis qu’il s’approchait, Charlie décida, en son for intérieur, de passer sous silence le vol du stylo. Mieux valait risquer d’être démasqué quelques mois plus tard que subir illico le châtiment de Charles Fisher Sr.
— Je suis désolé d’être en retard, s’excusa Charlie en prenant place en face de son père. J’ai été retenu.
Il attrapa sa serviette d’un geste nerveux et l’étala sur ses genoux, manquant renverser son verre d’eau au passage.
— Mmm…, dit Charles Fisher Sr., qui venait tout juste d’enfourner une huître particulièrement grosse dans son gosier et était, de ce fait, indisponible.
Il tapota sa moustache avec sa serviette afin d’en essuyer la saumure et ouvrit la bouche pour parler, mais son fils le devança précipitamment :
— J’ai donné mon stylo. Le Sheaffer Imperial. Je l’ai donné.
Les mots jaillirent comme un geyser de la bouche de Charlie. Tant pis pour la décision de ne rien révéler. Et puis c’était un vrai soulagement d’avouer.
Charles Sr. oublia ce qu’il s’apprêtait à dire.
— Tu quoi ?
— J’ai donné le stylo. Celui que vous m’aviez offert.
— Le Sheaffer Imperial ?
— Celui-là même, répondit Charlie.
— Avec ton nom gravé dessus ?
— Oui.
— Et pourquoi donc, grand Dieu ? demanda Charles Sr., sidéré.
Charlie prit une crevette sur le plateau de fruits de mer et la projeta dans sa bouche, ce qui lui laissa le temps de réfléchir à la suite : raconter toute la vérité à son père ou s’abstenir. Le temps de mâcher sa crevette et de boire une gorgée d’eau pétillante pour la faire passer, il avait fait son choix.
— Je l’ai donné à quelqu’un qui semblait en avoir besoin, déclara-t-il.
— Quelqu’un qui en avait besoin ?
— Terriblement.
— Besoin pour quoi ? Pour noter quelque chose qu’on lui dictait ? Un numéro de téléphone, par exemple ?
— C’est exactement ça, dit Charlie en expédiant une nouvelle crevette dans sa bouche.
Charles Sr. était d’un naturel sceptique.
— Tu ne pouvais pas simplement le lui prêter ? insista-t-il.
Une fois la deuxième crevette avalée, Charlie tenta une autre tactique :
— Vous m’avez toujours dit qu’il fallait être charitable envers les personnes moins bien loties.
— Eh bien…, commença Charles Sr., conscient qu’il venait de se mettre dans une impasse.
À son tour, il se servit une palourde sur le plateau de fruits de mer pour différer sa réponse.
— Eh bien, je ne parlais pas forcément d’un stylo à encre à cinquante dollars. Avec ton nom gravé dessus.
Il poussa un long soupir et ajouta :
— Charlie, c’était un cadeau que je t’avais fait. D’une grande valeur. À qui donc l’as-tu donné ?
— À un garçon dans la rue. Sur la place Jean-Jaurès.
— À un garçon dans la rue, répéta son père. Et ce garçon en avait besoin pour noter un numéro de téléphone ?
— Oui.
— Et, sans doute, de nombreux autres numéros de téléphone ? Une vie entière de numéros de téléphone, en fait ?
Charlie Jr. prit une autre crevette, la trempa dans la sauce cocktail et la fourra dans sa bouche.
— Mmm, mmm…, fit-il en guise de réponse.
— J’essaie de deviner, au hasard, dit Charles Sr. C’était un garçon avec lequel tu avais envie d’être ami ?
Charlie sentit le rouge lui monter aux joues. Était-ce la vraie raison ?
— Je suppose que oui, Père, bredouilla-t-il.
— Je te garantis que ça ne te mènera nulle part d’acheter l’amitié des gens. La véritable amitié se mérite.
Il pointait vers Charlie les dents de sa fourchette à fruits de mer.
Comme tu le sais, maintenant, Charles Sr. avait une moustache. Il faut également que tu saches que sa moustache était brune et s’acheminait vers le gris, tout comme ses cheveux impeccablement coupés et gominés. Il portait un blazer gris en tweed (son uniforme quotidien) et avait coincé une serviette dans le col de sa chemise. Ses cinquante-deux ans se devinaient au coin des yeux et sur le pourtour des lèvres, même si la Méditerranée avait un effet merveilleux sur son teint – teint qui avait tant souffert lors de sa précédente mission de consul spécial à Dublin, en Irlande.
— Écoute, poursuivit Charles Fisher Sr. Samedi soir, il y a une réception…
— Je ne veux pas y aller, répliqua Charlie.
— Écoute-moi jusqu’au bout, dit son père.
Charlie prit la dernière crevette, la mangea et répéta :
— Je ne veux pas y aller.
— Samedi soir, il y a une réception qui te plaira, j’en suis sûr. Il y aura beaucoup d’enfants de ton âge.
Le père de Charlie fit un geste au serveur, qui s’approcha de la table et la débarrassa du plateau de fruits de mer vide.
— Le fils du vicomte de Falmouth est en ville et une fête est donnée pour ses neuf ans. J’irai, à la demande de son père. Tu es également invité.
— Non, merci, s’entêta Charlie.
Charles Sr. continua, comme si de rien n’était :
— Je crois me rappeler qu’ils ont parlé de balades en poney. Et de clowns.
Ces appâts grossiers ne méritaient pas la considération de Charlie, qui avait quand même douze ans. De toute manière, les balades en poney ne l’avaient jamais passionné.
— Et des enfants. De ton âge, à peu près. Beaucoup d’enfants. Je te présenterai moi-même. Et, bien sûr, ils parlent tous anglais.
— Non, merci, répéta Charlie.
— Charlie, il faudra que tu acceptes, à un moment donné. En tant que fils du consul américain à Marseille, tu as en quelque sorte l’obligation de participer à certains événements.
Le serveur revint à leur table. Il posa un bol de bouillabaisse devant le père et une omelette avec des frites devant le fils.
— Tu étais en retard. J’ai pris la liberté de commander pour toi, expliqua Charles Sr.
Le plat tombait à pic, car Charlie ne savait quoi répondre à son père. Pourquoi ne voulait-il pas y participer ? Qui ne rêverait d’être invité à une fête de la famille royale en visite à Marseille ? Ce rejet lui venait-il de la trahison de sa mère ? Ou était-ce son statut d’enfant un peu à part qui l’avait amené à détester ce genre de manifestations ? Charlie ne les rejetait pas par peur ou par ignorance : il avait assisté à quantité de réceptions de ce type. Des bar-mitsvah en smoking à Tel-Aviv, des garden-parties sur les terrasses ensoleillées de Delhi. Des grands galas donnés par la famille royale d’Argentine. Lors de ces fêtes, la nourriture et les divertissements étaient somptueux – on ne regardait pas à la dépense. Les participants étaient impeccablement habillés et se comportaient de manière tout aussi distinguée. C’était magnifique et étonnant. Sauf que Charlie n’était jamais en compagnie des adultes bien habillés et bien élevés ; il était placé à la table des enfants, qui représentaient la pire espèce de l’humanité : les rejetons des aristocrates.
Charlie avait rencontré plus de vraies princesses qu’il n’en existe dans tes livres de contes et il avait pu constater qu’elles ne ressemblaient absolument pas à leurs homologues de chez Walt Disney. Elles étaient plus méchantes et gâtées les unes que les autres. Elles parlaient d’un ton hautain, nasillard et piquaient des crises pour un rien. Elles portaient des noms bizarres tels qu’Eugenia, Lavinia ou Elsinore. Elles daignaient à peine parler avec Charlie et quand elles le faisaient, c’était non seulement très bref, mais elles se tenaient la tête comme si Charlie venait de débarquer au volant d’une vieille guimbarde rouillée. Quant aux princes – les Harry, les Henri, les Heinrich van Spackleburgers –, ils étaient très éloignés des princes charmants que tu imagines. Ils conduisaient des voitures de sport hors de prix qu’ils démolissaient régulièrement comme de simples modèles réduits, puis qui étaient immédiatement remplacées par d’autres bolides plus neufs et plus brillants. Pendant les repas, avachis et rotant, ils la ramenaient sur leurs nombreuses petites copines aux quatre coins du monde, les comptabilisant comme si elles étaient des objets qu’ils collectionnaient puis jetaient. Ils se montraient féroces à l’égard de Charlie et de sa timidité. À leurs yeux, il n’était qu’un roturier, le simple fils d’un diplomate américain. Un parasite.
Charles Sr. savait interpréter le silence de son fils. Ça n’était pas la première fois que Charlie manifestait sa tendance asociale.
— Je sais, dit-il. Je sais que c’est dur pour toi. Mais tu dois faire un effort. Tu es un garçon très sympathique, Charlie. Simplement, tu n’as pas encore rencontré les jeunes gens qui te correspondent.
— C’est vrai, répondit Charlie.
— Mais comment veux-tu les rencontrer si tu renonces à sortir ?
— Je sais, Père, approuva Charlie. J’ai peut-être juste besoin d’un peu de temps.
Son père hocha la tête et commença à manger sa soupe de poisson. Charlie attaqua également son plat. Le brouhaha du restaurant leur tint compagnie, ce bavardage joyeux, typique des restaurants marseillais. Les deux Fisher mangèrent sans échanger un mot de plus, hormis quand Charlie commanda une grenadine. Charles Sr. avala une dernière cuillerée de sa bouillabaisse, puis enleva la serviette accrochée à sa chemise.
— Au travail, dit-il. Il y a des papiers à signer, des passeports à délivrer et des mains à serrer.
Il fit un signe au serveur et régla l’addition. Puis il se leva et sortit un stylo de la poche intérieure de sa veste, qu’il tendit à son fils.
— C’est un simple stylo d’hôtel, ajouta-t-il. Ça ne remplacera pas un Sheaffer, j’en suis désolé, mais ça fera l’affaire. Essaie de ne pas le donner.
Charlie prit le stylo avec un sourire. Son père lui fit un clin d’œil et lui caressa le dos. Charlie le regarda partir puis appela le serveur.
— Oui, monsieur ? demanda celui-ci.
— Une autre grenadine, s’il vous plaît.
Quand elle fut servie, il la but en silence, en jouant avec le nouveau stylo sur lequel était écrit « Bienvenue ! Hôtel Lutetia, Paris ». Il essaya de le faire tourner entre ses doigts, comme l’avait fait Amir, mais sans y parvenir.
Charlie resta un long moment assis à cette place, les coudes sur la table (malpoli), le petit stylo en plastique s’échappant de ses doigts à plusieurs reprises. Puis le jeune garçon décida de rentrer chez lui, au Prado, un quartier de Marseille un peu au sud du Vieux-Port. Il prit l’itinéraire le plus direct en suivant la rue Paradis, à l’écart de la jungle des bateaux de plaisance et des embarcations de pêche, jusqu’à la vaste avenue du Prado, plantée d’arbres. Il aurait pu aussi gravir la colline qui surplombe le palais du Pharo, face au fort Saint-Jean, et, de là, tout en contemplant au loin l’élégante basilique Notre-Dame-de-la-Garde, surnommée « la Bonne Mère », longer la route de la corniche, qui côtoie la mer Méditerranée cristalline, seulement troublée par l’archipel du Frioul, puis poursuivre vers le sud, jusqu’au rond-point où trône la reproduction géante du David de Michel-Ange, le Prado et la mer.
Le Prado, à cette époque-là, était l’endroit le plus chic de Marseille. La large avenue était bordée de platanes feuillus qui projetaient leur ombre sur le flot de voitures – les marques et modèles les plus prestigieux. De chaque côté de la grande artère s’élevaient de riches villas en pierre, aux façades flamboyantes habillées de lierre et de chèvrefeuille, protégées par de hautes grilles en fer forgé. Les Fisher s’étaient installés dans l’une de ces demeures.
Le lendemain après-midi, Charlie était exactement dans la même position que la veille, comme s’il avait été transporté du restaurant Miramar à l’un des nombreux ateliers de dessin de son immense maison à trois étages. Il avait toujours les coudes sur la table (malpoli) et il jouait toujours avec son stylo. Cependant, il parvenait mieux à le faire tourner entre ses doigts, sans doute parce qu’il avait passé beaucoup de temps à s’y entraîner. Le temps qu’il aurait dû consacrer à ses devoirs, comme essayait de le lui rappeler Simon, son professeur.
— Est-ce que tu peux poser ce stylo et te concentrer un moment, Charlie ? demanda Simon.
— Oui, souffla Charlie en s’efforçant de déplacer le stylo en plastique de son annulaire à son auriculaire.
C’était le changement de doigt le plus délicat à effectuer.
— Tu ne l’as pas posé, constata Simon.
Charlie ne parvint pas à effectuer le passage d’un doigt à l’autre, et le stylo tomba sur la table avec un bruit sec.
— Merci, dit Simon, prenant, à tort, la maladresse de Charlie pour de l’obéissance. À présent, je voudrais revenir sur une des erreurs courantes que tu sembles faire.
Le cahier de rédaction de Charlie était ouvert sur la table et Simon était occupé à disséquer l’une des nouvelles de Charlie comme s’il s’agissait d’une grenouille sur un plateau de laboratoire.
— Tu te rappelles ce qu’est un modificateur mal placé ? poursuivit Simon.
— Quelqu’un qui modifie et qui est en mauvaise posture ? demanda Charlie en souriant.
Pas de sourire de Simon en réponse. Le professeur ne souriait pas souvent. Cela surprenait d’ailleurs Charlie, car Simon lui apparaissait comme quelqu’un ayant une vie très riche. C’était un étudiant diplômé et, aux yeux d’un garçon de douze ans, les « étudiants » étaient dans une situation idéale, avec leur indépendance fraîchement acquise et sans véritable responsabilité. Il profitait d’une année de congé au milieu de ses études et vivait sous le toit des Fisher sans autre contrainte que de donner à Charlie, trois fois par jour, des leçons d’anglais, de français et de géographie. En contrepartie, Simon recevait une allocation importante, et bénéficiait d’un week-end de trois jours par semaine. Il portait une barbichette et de grosses lunettes noires, suivant la mode hippie. Pour couronner le tout, il était de Manhattan, jouait de la guitare, et fréquentait une jeune Française appelée Cécile. Personne ne pouvait deviner pourquoi il était si rabat-joie.
— Un modificateur mal placé est une phrase : une phrase descriptive, qui décrit le mauvais objet dans la phrase, expliqua Simon d’un ton sec.
Il regarda par la grande fenêtre et poursuivit :
— Par exemple : « Après avoir escaladé la grille, la distance qui le séparait du sol était trop haute pour que le garçon puisse sauter. » La phrase « après avoir escaladé la grille » modifie à tort les mots « la distance », au lieu de…
Simon s’interrompit un instant puis rectifia :
— Un garçon escalade la grille.
Charlie suivit le regard de Simon et vit que la phrase qu’il venait de prononcer, modifiée ou non, était vraie : un garçon était en train d’escalader la grille. Plus exactement, il avait fini de l’escalader – une grille en fer forgé de plus de dix mètres de haut doublée d’une épaisse haie qui cachait la vue depuis la rue – et était maintenant suspendu en haut, un bras accroché autour d’une des pointes de la grille. Entre le garçon et la fenêtre de l’atelier de dessin, il y avait quinze mètres de pelouse soignée, mais même à cette distance, Charlie reconnut Amir, le pickpocket.
Charlie n’eut même pas le temps d’ouvrir la bouche que Simon se précipitait vers les portes-fenêtres qui donnaient sur la pelouse et hurlait :
— Hé, toi, là-bas ! On peut savoir ce que tu fabriques ?
— Attendez ! cria Charlie en sautant de sa chaise.
— C’est une propriété privée ! poursuivit Simon en brandissant un doigt accusateur, en bon professeur qu’il était.
Amir, suspendu à la grille, ne se sentait pas vraiment menacé. Apercevant Charlie, il eut un large sourire.
— Salut, dit-il en faisant un signe de sa main libre.
Simon s’apprêtait à prévenir l’équipe de sécurité quand Charlie se rua vers lui.
— Attendez ! Je le connais, dit-il.
— Ah bon ? s’exclama le professeur, incrédule.
Il observa de nouveau Amir : cheveux bruns en bataille, pantalon en toile sale, chemise rose délavé, large sourire. Il mit néanmoins ses doutes de côté.
— D’accord. Mais que fait-il en haut de la grille ? Il ne pouvait pas sonner au portail ?
— Il est un peu spécial, répondit Charlie avant de traverser la pelouse en courant pour rejoindre son ami.
— Attends ! hurla Simon depuis les portes-fenêtres. Ta leçon !
— Après avoir escaladé la grille, le garçon se rendit compte que la distance jusqu’au sol était trop grande ! lança Charlie en tournant la tête. Modificateur mal placé !
— Ça n’est pas si haut, s’amusa Amir quand Charlie arriva sous lui.
Pour le prouver, il retira son bras enroulé autour de la grille et sauta au sol avec l’aisance d’un écureuil. Il atterrit en s’accroupissant puis se redressa et tendit la main à Charlie pour le saluer.
— Salut, Charlie, dit-il. Bel endroit.
— Comment as-tu trouvé ?
Amir épousseta ses bras, comme pour ajuster sa tenue, et siffla d’admiration.
— Je suis chez les bourgeois, ici. Tu viens d’une… on appelle ça comment ? Tu viens d’une bonne lignée, Charlie Fisher.
— Merci. Enfin, oui, je crois.
Charlie eut soudain honte de son milieu social.
— C’est à mon père, surtout. C’est un peu trop grand pour nous. J’aurais préféré quelque chose de plus petit, ou… Mais sérieusement, dis-moi : comment as-tu trouvé mon adresse ?
— Il n’y a pas de secrets pour Amir. Pas à Marseille.
Charlie dévisagea un moment le garçon.
— Alors, bienvenue chez moi.
— Merci, dit Amir, qui fixait un point derrière Charlie. J’ai l’impression que je t’ai dérangé, tu étais avec quelqu’un…
Simon arriva à côté de Charlie.
— Ah, oui ! répliqua Charlie. C’est mon professeur. Mais on venait juste de finir.
— Ah oui, vraiment ? intervint Simon.
Il se présenta à Amir qui le regarda, suspicieux.
— On peut dire qu’on a terminé, s’il vous plaît ? demanda Charlie à Simon. J’avais donné rendez-vous à Amir.
Simon, les mains sur les hanches, respira profondément, comme s’il prenait soudain conscience qu’il était dehors, dans la chaleur de l’après-midi. On pouvait entendre le cri des mouettes, à faible distance, et sentir le parfum de mer et de jasmin qui flottait dans l’air. Les réticences du professeur se dissipèrent rapidement. Il consulta sa montre.
— Il ne nous reste en effet que dix minutes, admit-il.
Il contempla Charlie et ajouta :
— Tu finiras ta lecture pour la semaine prochaine ?
— Cinquante pages, oui monsieur.
— Et commence ta rédaction. Il nous faut pouvoir montrer quelque chose de ton travail avec moi, Charlie.
— Pas de problème.
— C’est l’idée, Simon, lança Amir.
Simon esquissa un léger sourire.
— Charmant ami, commenta le professeur. Ton père est d’accord ?
— Ça serait mieux que Père ne soit pas au courant.
Une brise agita les feuilles de la haie ; de la musique s’échappait par la fenêtre ouverte d’une maison voisine.
— Très bien, dit Simon. C’est vraiment une journée magnifique. Autant que tu restes dehors pour en profiter. Il ne faut pas non plus se perdre dans les études.
— Son apprentissage, à celui-là, vient juste de commencer, dit Amir en faisant un clin d’œil à Charlie.
Simon fronça les sourcils en examinant le garçon. Charlie intervint aussitôt :
— Arrête de blaguer tout le temps, Amir. Allez, viens, on va…
Il chercha un instant ses mots.
— On va lancer quelques calots.
— Des calots, répéta Simon.
Il fit demi-tour et se dirigea vers la maison en disant :
— Tout en lançant des calots sur le terrain de pétanque, l’après-midi se changea doucement en soirée.
— Modificateur mal placé ! cria Charlie. L’après-midi se changea doucement en soirée pendant que les garçons lançaient des calots sur le terrain de pétanque !
Simon leva la main pour approuver en disparaissant dans la maison. Les deux garçons le regardèrent s’éloigner.
— Tu es prêt pour une vraie leçon ? lança Amir.
— Je prends juste mes affaires, répondit Charlie.
Extraits

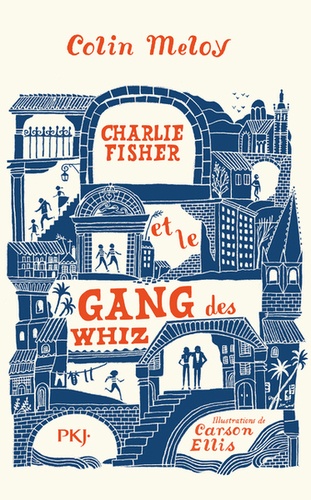



























Commenter ce livre