Jules Ferry. La liberté et la tradition
Mona Ozouf
I
UN HÉRITIER
Fixer sur le perron de l’Élysée l’image de ministres frais éclos, ce n’était pas encore l’usage, à l’aube de notre République. Imaginons pourtant, couleur sépia, la photographie qu’on aurait pu faire, le 4 février 1879, du nouveau ministère. Nous peinerions à y reconnaître la consécration d’une date éclatante, celle où un président républicain peut enfin s’entourer de ministres républicains, événement capital mais que nous avons oublié et que nul ne commémore. Nous aurions plus de difficultés encore à identifier les nouveaux promus : tous enveloppés du deuil auquel le XIXe siècle a condamné le genre masculin, identique noirceur des redingotes, gilets et nœuds papillon, même raideur des cols empesés, même solennité des postures. La seule concession à l’originalité, ici, tient à la longueur de la moustache ou à l’abondance de la barbe, mais sur tous les visages flotte le même air de concentration migraineuse. Le photographe eût-il légendé son portrait, que les noms des nouveaux promus, Cochery, Waddington, Greslet, Tirard, Freycinet, Léon Say, n’éveilleraient eux-mêmes en nous que de maigres souvenirs. À l’exception toutefois de l’homme qui dans cette brumeuse cohorte obtient un portefeuille jugé jusque-là subalterne, celui de l’Instruction publique : Jules Ferry.
Lui nous parle encore. Le président de la République a placé son quinquennat sous sa bannière, son nom brille sur les murs de nos villes et au fronton de nos écoles. Mieux, les réformes qu’il a mises en œuvre continuent à tisser notre vie quotidienne. Et pas seulement en raison des écoles qu’il a rendu gratuites, obligatoires et laïques, et auxquelles on pense toujours quand on l’évoque. Car nous achetons au kiosque le journal de notre choix, sans crainte de la censure et sans restriction aucune, et nous avons oublié son rôle dans l’acquisition de cette liberté fondamentale. S’il nous est permis de nous réunir librement et, pour défendre nos intérêts légitimes, de rejoindre un syndicat, nous le lui devons aussi. Comme de pouvoir élire nos maires, au lieu de les recevoir du préfet ou de la loi non écrite qui a longtemps désigné pour la mairie l’important du bourg, seigneur ou gros propriétaire. Toutes nos libertés publiques, devenues invisibles par leur évidence même, ont été acquises au long des six petites années où Jules Ferry a, et encore de manière intermittente, détenu le pouvoir.
C’est assez pour lui valoir le titre d’homme qui a fait la France, et les historiens, notamment anglo-saxons, ne le lui ont pas chicané. Pour Eugen Weber, il est un de ceux qui, au terme d’une entreprise réfléchie, menée avec une ténacité peu commune, ont su, d’un peuple de paysans, faire surgir des Français. Cette création, la langue anglaise en fait, avec plus de force que le français (Peasants into Frenchmen), une vraie métamorphose. Les paysans tirent du pays leur nom de baptême, mais le pays, pour eux, n’est encore nullement la France ; les traits et les contours de cette lointaine personne restent inconnus à ceux qui n’ont jamais eu de carte sous les yeux, son histoire est ignorée de ceux qui ne lisent pas, sa capitale plus exotique que l’Inde ou que la Chine. Le « pays », c’est seulement leur canton étroitement circonscrit, replié sur lui-même, ankylosé dans ses usages, remué par d’obscures querelles de bornage, secoué par les peurs ancestrales de la grêle et des sorciers ; d’une intimité assez chaleureuse cependant pour qu’on contracte, quand on en est éloigné, le « mal du pays ». Les échos de la nation y arrivent assourdis, déformés, méconnaissables : on s’y est longtemps entretenu des exploits d’un certain Napoléon Bonne-attrape, et dans cette aube républicaine, il arrive qu’on menace les enfants dissipés de la venue d’un ogre, le Grand-Bêta. Les historiens anglo-saxons en déduisent qu’en France le sentiment national est d’apparition tardive ; les noces de la France avec les Français ont été longues à se conclure, et elles ont été préparées, arrangées, et finalement consommées au cours de l’immense entreprise pédagogique à laquelle Jules Ferry a attaché son nom.
Extraits

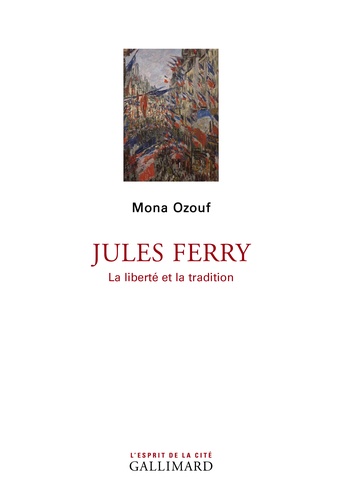



























Commenter ce livre