Kaléidoscope
Marie Caillet
Marie Caillet
Chapitre premier
Franchement, la maison est moche.
Ce n’est pas gentil de dire ça, alors que maman vient à peine de se garer devant, mais c’est vrai. Elle ressemble à un pâté : sa façade est couverte de pierres brunâtres et on dirait qu’elle dégouline, tant le jardin qui l’encercle est boueux. Le seul détail qui me plaît, c’est une fenêtre ronde au premier étage – un œil-de-bœuf, si je me souviens du bon terme. Je me demande ce qu’elle fait là : elle ne va pas du tout avec les autres.
— Et voilà, les filles ! lance maman.
Elle déboucle sa ceinture. Le déclic du mécanisme résonne dans l’habitacle.
— Tout le monde descend, ajoute-t-elle avec entrain. Je vais vous faire visiter. On retournera chercher les valises après !
Quand elle ouvre la porte, un courant d’air tiède s’engouffre dans la voiture, charriant l’odeur aigrelette et fade des feuilles mortes. Ni Sandra ni moi ne bougeons d’un pouce.
— Il y a quatre chambres à l’étage, poursuit maman en attrapant son sac à main. Vous aurez chacune la vôtre. Le grand luxe, non ?
Devant moi, ma sœur reste de marbre, mais je vois sa nuque se raidir. J’imagine sans peine son expression : mâchoires serrées au maximum, regard braqué sur le pare-brise. Elle n’a pas décroché deux mots depuis le début du voyage.
— Les filles ?
L’intonation de maman s’infléchit légèrement. En deux mots, elle passe de l’enthousiasme un peu forcé à quelque chose de plus velouté, de plus posé. Je croise son regard à travers la vitre – un regard vert bouteille qui peut devenir tranchant comme un tesson quand on le brave. À contrecœur, je détache ma ceinture.
— Merci, Naomi, dit maman. Tu prends Chresto ?
Je perçois une note de soulagement dans sa voix. En silence, j’attrape la caisse de transport posée à côté de moi. Un miaulement de détresse retentit et une tache blanche remue dans l’ombre. De toute évidence, Chresto a aussi peu envie que moi de descendre. Mais que puis-je faire d’autre ? Rester bras croisés sur mon siège en exigeant de repartir à Paris, dans notre cher appartement de la porte des Lilas ? C’est Sandra qui a le cran de faire ça. Pas moi.
Je pousse la portière de la Fiat 500 et m’extirpe de l’habitacle. La rue teintée par la vitre se dévoile avec ses vraies couleurs. Elle est bordée de résidences soignées, à moitié cachées par des haies que la fin de l’été vient roussir à la cime. Notre maison se situe à l’extrémité de la rue. Elle a beau être grande, elle fait piètre figure à côté de toutes ces habitations bien propres. Une main d’acier me comprime l’estomac.
Je ne veux pas franchir le portail. Je ne veux pas vivre ici. Sans papa, cette maison ne sera jamais mon foyer.
— Naomi ?
Maman m’attend, souriante. Je discerne un frémissement inhabituel sur son visage, malgré le bonheur qui l’éclaire. Maman a toujours foncé dans sa vie, toujours pris les grandes décisions avec une assurance inébranlable – se marier, avoir deux filles, divorcer, déménager dans un coin perdu de Bourgogne après avoir passé toute sa vie à Paris. Mais, en croisant son regard, je prends conscience que, pour elle aussi, tout est nouveau. Inconnu.
C’est cette petite lueur qui me décide. La gorge serrée, je trottine vers elle, la caisse de Chresto pesant au bout de mon bras.
— Sandra ? Sois gentille, ma chérie ; sors de la voiture.
Ma sœur aînée fait mine de ne pas entendre. Je distingue son profil à travers la vitre, avec ses mèches blondes et son nez retroussé – c’est fou comme elle ressemble à maman, quand elle prend cet air buté.
— Très bien, reprend maman. Tu fermeras en sortant, d’accord ?
En guise de réponse, ma sœur allume la radio, monte le volume à fond et cale ses pieds contre la boîte à gants. Maman soupire, mais ne fait aucun commentaire. Le portail en fer forgé grince quand elle le pousse, raclant un sol recouvert de feuilles jaunes.
— Marche bien sur les gravillons, ça glisse, me dit-elle. La maison était inhabitée depuis deux ans. On a beaucoup de travaux à faire…
Elle se faufile avec aisance entre les flaques et les feuilles décomposées. J’essaie de marcher dans ses pas, tout en regardant autour de moi. L’avant du jardin est envahi d’arbres maigres, de lierre et de plaques de boue. Sous le ciel pâle de la fin août, c’est sinistre. La porte d’entrée crisse désagréablement quand maman la pousse. J’entrevois un couloir sombre, encombré de cartons.
— Chéri ? On est arrivées ! lance maman en disparaissant à l’intérieur.
Chresto crache dans sa caisse, et j’ai la fugace impression qu’en cet instant précis nous éprouvons exactement la même chose. Moi aussi, si j’étais un chat, je cracherais.
« Chéri. »
Je serre les dents, je serre la main qui tient la caisse de Chresto, et je franchis le seuil. Une odeur d’humidité, de poussière et de vieux papier peint me saute au visage. Le hall d’entrée semble me happer, me tirer dans sa pénombre. Je n’ai comme seul repère que la voix claire de maman et le L lumineux d’une porte entrouverte, au fond à gauche.
Je sais déjà ce que je vais trouver derrière. Je le repousse de toutes mes tripes, de toute mon âme. Mais, quoi qu’il en soit, c’est trop tard. Alors j’ouvre la porte en grand.
— Hé, ma puce ! Tu as fait bon voyage ?
Je m’arrête sur le seuil du salon, fixant l’homme qui enlève à la hâte son bras enroulé autour de maman. C’est un grand blond dégarni avec des lunettes bleues et un jean qui tire-bouchonne sur ses chevilles maigres. Il se dépêche de traverser la pièce et plie son double-mètre pour m’embrasser.
— Content de te revoir, Naomi. Et Chresto est là aussi, génial ! Tu verras, il aura de quoi se dégourdir les pattes ici. Tu veux boire quelque chose ? Ou manger ? Il y a du thé, de la limonade, des Oréo…
Plus je me tais, plus il me noie sous une montagne d’attentions, de questions, de sourires. Je sens monter en moi une sensation d’étouffement familière. Je n’y peux rien, Christophe me crispe. Heureusement, maman toussote, ce qui l’interrompt.
— Heu… La cuisine, c’est la porte d’en face, si tu veux y aller, dit-il en fourrageant dans ses cheveux. Je reviens, d’accord ? Je vais chercher les valises.
Il sort, ses grandes jambes le portant à toute vitesse dans le couloir. Maman pose une main sur mon épaule.
— Tu peux lui parler, tu sais. Christophe ne va pas te manger.
J’ai envie de lui répondre qu’il a fait pire. Il a démoli, pulvérisé, anéanti ma vie. D’accord, le divorce de papa et maman, c’était il y a deux ans. Mais tout le reste, c’est sa faute. Lorsqu’il a déboulé, fou de joie, en annonçant à maman qu’il avait trouvé un associé fleuriste près de Dijon. Lorsque maman, qui en avait soi-disant marre de Paris et de son job super bien payé de représentante commerciale dans une boîte qu’elle détestait, a décidé de le suivre.
Après, tout s’est précipité. Démission de maman. Recrutement à Dijon. Disputes violentes avec papa pour vendre leur appartement, où nous vivions encore, maman, Sandra et moi. Tout ça pour terminer dans un quartier paumé en pleine Bourgogne.
Qu’est-ce qu’elle veut que j’en dise, franchement ?
Le silence tombe entre maman et moi. À ma place, Sandra aurait tempêté, rué dans les brancards, claqué les portes. Je pense que maman aurait préféré. Mais ma colère, ma peur, tout ce qui remue en moi reste bien scellé derrière mes lèvres.
— On va attendre Sandra pour le goûter. Tu me suis à l’étage ? propose maman. Je vais te montrer ta chambre.
Je hoche la tête et reprends la caisse de Chresto. Elle est lourde, je pourrais la laisser dans l’entrée – après tout, Chresto est le chat de Sandra, pas le mien –, mais, d’une certaine façon, ce lest me rassure. Il devient quelque chose qui m’oblige à rester droite. À tenir.
Je talonne maman dans le couloir, jusqu’à un escalier coincé entre la porte du fond et une fenêtre poussiéreuse. Les marches craquent sous ses talons, mais, malgré le poids de Chresto, je ne fais aucun bruit. Je la suis jusqu’à l’étage, noyé dans la pénombre. Des portes closes défilent, des cartons. Mon cœur bat si fort que je le sens palpiter jusque dans mes oreilles. Enfin, maman s’arrête.
— Et voilà !
Elle pousse une porte et me fait signe de passer. Le ventre noué, j’obéis. Et, soudain, j’ai l’impression de bondir dans un autre espace-temps.
Tout est là. Mes coussins entassés sur le lit, mes posters et ma lampe de chevet articulée. Tout est disposé exactement comme à Paris. Sauf qu’au lieu des murs carrés de mon ancienne chambre un vasistas surplombe mon lit, et que le bureau donne sur l’œil-de-bœuf que j’ai remarqué dans la voiture.
— Ça te plaît ?
Maman entre derrière moi, prudente – je le devine au grincement ténu du parquet sous son poids. Mon regard retourne sur le lit, survole les coussins, la couette bien repassée. Et, soudain, un grésillement de panique remonte ma colonne vertébrale et se diffuse sur mon crâne.
— Où est Diego ?
— Diego ? répète maman.
Lorsque je me tourne vers elle, ses yeux s’agrandissent. Elle a compris.
— Tu m’as dit que tu t’en occupais !
Ma voix résonne dans toute la chambre. Elle me surprend moi-même. Maman aussi, à en juger par son air désemparé.
— Il ne doit pas être loin…
— Je te l’ai laissé à Paris ! Je ne l’ai pas pris chez Mamé !
Ma panique croît, tourbillonne, ébranle le solide loquet qui boucle ma bouche depuis des heures. Le visage de maman se crispe.
— Naomi, on a des dizaines de cartons à défaire. Christophe et moi, on s’est démenés pour préparer vos chambres à temps. J’ai dû ranger Diego ailleurs, c’est tout. En attendant, tu peux te débrouiller sans lui, non ?
Elle pose sa question avec une intonation particulière, que je décrypte aisément : « À douze ans, tu as passé l’âge d’avoir un doudou, quand même ! »
Soudain, c’est comme si le verrou qui me scellait les lèvres glissait dans ma gorge et s’y coinçait. Mes larmes montent et se pressent contre lui. Elles s’accumulent jusqu’à me faire mal. Je sais bien que c’est stupide, mais l’absence de ma panthère en peluche me donne l’impression de perdre les pédales. Retrouver Diego était la seule chose qui me donnait envie d’entrer dans cette maison.
Maman interprète mon silence complètement de travers. À moins qu’elle ne s’en moque : elle m’embrasse sur les cheveux.
— Je te laisse t’installer, il faut que j’aide Christophe. On t’appelle pour le goûter, OK ?
Une légère brise. La porte s’est refermée. Je me retrouve seule.
Mon premier geste est de libérer Chresto qui s’est mis à crachoter et à griffer sa caisse. Dans un éclair noir à pattes blanches, il file se cacher sous le lit et devient silencieux comme une ombre. Je reste au milieu de la chambre, immobile. Petit à petit, mes battements de cœur s’apaisent, et le verrou coincé dans ma gorge se dénoue. À chaque respiration, je le sens se désagréger, libérant mon souffle. L’envie de pleurer est toujours là, mais elle descend dans mon ventre, plus diffuse. Moins urgente.
J’inspire un grand coup et je m’avance. Les odeurs, les bruits m’assaillent. Le grincement du parquet. L’odeur d’humidité et de poussière. Chaque sensation m’atteint la peau avec la précision d’une aiguille.
Je m’approche du bureau, où trônent mon pot à crayons en forme d’ananas, mon casque audio et le cadre photo où je pose avec papa, disposé à droite – exactement comme à Paris. J’éprouve une bouffée de reconnaissance pour maman. J’ai beau lui en vouloir à mort, elle s’est donné tellement de mal pour reconstituer mon petit nid que, si je m’asseyais à mon bureau, j’aurais presque l’illusion d’être de retour chez nous.
Mais voilà le problème : sur une illusion, on ne construit rien.
— J’irai pas dans ta baraque, c’est mort !
Le hurlement de Sandra traverse la vitre. Arrachée à mes pensées, je m’approche de la fenêtre.
— Je m’en fiche ! De toute façon, tu ne nous as même pas demandé notre avis ! Lâche-moi, je descendrai pas, OK ?
En me hissant sur la pointe des pieds, j’aperçois la Fiat 500, coffre ouvert, et maman penchée sur la vitre avant, du côté passager. Christophe prend la dernière valise et claque la porte du coffre.
— Alice, ce n’est pas grave. Ton goûter t’attend dans la cuisine, ajoute-t-il à l’intention de Sandra.
Avec un soupir agacé, ma mère soulève l’autre valise. Je les regarde franchir le portail ensemble, puis disparaître à moitié sous les arbres.
— C’est normal, dit la voix assourdie de Christophe. À cet âge, personne n’aime les déménagements, surtout s’il faut quitter son petit copain…
— Ça n’excuse pas le fait qu’elle me réponde. Ni qu’elle te snobe ! Je te jure, elle est en pleine crise d’ado. On va en voir de toutes les couleurs !
J’entends le rire clair de Christophe.
— Telle mère, telle fille, non ?
— Si seulement c’était le cas pour les deux, soupire maman. Ça aurait été plus simple. Sandra s’adaptera, je la connais. Naomi…, c’est différent.
Le pull violet de Christophe, fragmenté par les branches d’arbres, se rapproche d’elle, indiquant qu’il passe un bras autour de son épaule.
— Ça ira. Elle aura peut-être besoin de plus de temps, mais elle s’y fera.
— Je ne sais pas, s’inquiète maman. Elle est toujours tellement fermée. Je ne sais pas quoi faire pour qu’elle sorte de sa coquille.
Ils se taisent en émergeant du couvert des arbres, d’où ma fenêtre est visible. Je reste cachée derrière la vitre, pétrifiée. La porte d’entrée claque.
Dans le silence, j’entends les griffes de Chresto qui s’attaque au sommier, déchirant les fibres en petits coups secs et brutaux.
Le bruit me sort de mon état de choc. Je referme la fenêtre, faisant bloc contre les paroles de maman, ordonnant à ma mémoire de les laisser glisser, fuir, disparaître. Pour m’occuper les mains, je réorganise mon pot à crayons, remets mes Post-it en place, fais glisser le tiroir du bureau. Une liasse de feuilles à carreaux jaillit, propageant une bouffée de papier neuf et d’encre acide. Alors, comme par magie, toute la conversation entre maman et Christophe fuit à mille kilomètres de mon esprit.
Je pouvais m’en moquer tant que j’étais en vacances chez Mamé. Je pouvais l’ignorer dans la voiture. Je pouvais même l’oublier en franchissant le seuil de cette maison. Mais ici et maintenant, face à mon bureau bourré de fournitures scolaires, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas.
Après-demain, je rentre en cinquième.
Chapitre 2
« Collège public de la Salpêtrière. »
Tels sont les mots que j’ai tapés sur Google dimanche matin – en m’y reprenant à trois fois pour écrire « Salpêtrière ». J’aurais pu me contenter du courrier que m’a donné maman, avec la date de la pré-rentrée, l’adresse du collège et toutes les infos pratiques, mais c’était plus fort que moi.
J’ai regretté mon geste dès que j’ai vu les photos.
Je ne sais pas à quoi je m’attendais. Un endroit avec des arbres et de la pelouse, j’imagine – une sorte de mini-Poudlard, étant donné que maman nous a rabâché que l’avantage de déménager, c’est qu’on aurait plus d’espace et de verdure. À la place, un bâtiment grisâtre et une cour en bitume, avec trois pauvres arbres au milieu, m’ont sauté à la figure. J’ai quitté Google en vitesse.
Le lundi matin, dès que je me réveille, les images jaillissent devant mes yeux. Intactes.
« Biiip ! Biiip ! Biii… »
J’arrête le hurlement de mon réveil et je me contracte sous ma couette. La première chose que j’aperçois est mon sac de cours au pied de mon bureau. Un courant d’adrénaline me parcourt le dos, les jambes, les doigts. Je donnerais n’importe quoi pour que ma couette tiède devienne un terrier dans lequel je puisse m’enfoncer, loin du réveil, de la rentrée et de l’odeur de pain grillé qui glisse déjà sous la porte.
Mais c’est le jour J. Je n’ai pas le choix.
Je repousse l’édredon et traîne les pieds jusqu’à ma chaise de bureau. Mes habits m’y attendent, bien pliés. Jean, pull bleu sombre, bottines. Rien pour sortir du lot, mais rien pour m’en écarter. C’est maman qui a préparé ma tenue. En sixième, elle me laissait m’habiller, mais cet été elle a insisté pour refaire toute ma garde-robe. On dirait que l’idée d’un faux pas l’angoisse encore plus que moi.
— Bien dormi, ma puce ?
Christophe est déjà là quand je descends à la cuisine. Je m’assieds sur mon tabouret du bout des fesses. L’odeur du pain grillé me soulève le cœur.
7 h 30. Boule au ventre.
Christophe s’agite autour de la table, dépose une assiette devant moi. Je me force à prendre une tartine et à l’enduire de confiture. C’est une cuisine différente des autres années, un décor différent derrière la fenêtre. Même l’homme qui s’assied en face de moi est différent. Et, pourtant, je retrouve exactement les mêmes sensations qu’à toutes les rentrées. L’angoisse brouille tout, jusqu’au goût des tartines.
Est-ce que le changement de collège va changer quelque chose ? Vais-je trouver ma place ? Me refaire des amis ?
— Bonjour, Sandra, dit Christophe. Je te sers quoi ?
Je lève le nez de mon assiette, tout en notant que Sandra, elle, n’a pas droit au « ma puce ». Ma sœur fonce vers la table en grommelant je ne sais quoi et renverse la moitié du sachet de céréales dans son bol. Christophe toussote.
— Bon, les filles…, il y a un changement de programme. Votre mère doit se rendre à sa nouvelle agence à 9 heures et, comme c’est à l’opposé de votre collège, c’est moi qui vais vous emmener à votre pré-rentrée. On démarre dans vingt minutes, c’est bon pour vous ?
J’ai beau fixer la toile cirée, je devine qu’il lance des petits coups d’œil dans ma direction. Sandra conservant un silence buté, je lui fais un petit « oui » de la tête. Il se détend visiblement.
— J’irai vous chercher à midi trente. Vous verrez, vous allez vous faire des copains super vite, j’en suis sûr !
Il m’adresse un clin d’œil. Je remarque qu’il a les iris presque aussi bleus que ses lunettes. Son regard déborde de sympathie, mais c’est comme si je me trouvais bloquée dans un bocal aux parois invisibles. Rien ne m’atteint.
— Et voilà, les filles. Terminus ! annonce Christophe en serrant le frein à main.
La fourgonnette s’ébroue, tressaille puis s’immobilise avec un soupir de vieux cheval. Assise à l’arrière, je me penche en avant pour voir à travers la vitre.
Je pensais m’être psychologiquement préparée avec mes recherches Google. L’enceinte en ciment gris, les grilles vertes, le bâtiment en béton qui se devine derrière les arbres – rien dans ce spectacle ne m’est inconnu. Et cela n’a soudain plus aucune importance. Je n’ai d’yeux que pour le flot d’élèves qui s’engouffre à travers la grille. Des dizaines de têtes, de manteaux, de sacs à dos. Trop. Beaucoup trop.
— Tu baisses ton siège pour Naomi, Sandra ? demande Christophe. Attention aux fleurs en passant.
Ma sœur saute dehors et s’exécute. Un courant d’air déferle dans la fourgonnette, réveillant les parfums des cyclamens et des fuchsias entreposés à l’arrière pour les livraisons. Je descends sous les regards intrigués de quelques familles – au milieu des monospaces, la fourgonnette de Christophe, recouverte de marguerites bombées au spray, a l’air de s’être trompée d’endroit. J’ai envie de disparaître sous terre et de boucher le trou au-dessus de moi.
— Bon, j’imagine que les listes des classes sont affichées dans la cour, dit Christophe en claquant sa portière. Prêtes ?
— J’y vais toute seule, annonce Sandra d’un ton sans réplique.
Et elle nous plante là, les mains rivées sur les bretelles de son sac à dos comme si elle s’apprêtait à actionner un parachute. Je n’ai même pas droit à un regard de sa part, elle qui, l’année précédente, me tenait la main pour mon entrée au collège. Son dédain me fait l’effet d’une gifle.
— Eh bien, on ira à deux alors, rétorque Christophe avec bonne humeur.
Je sens mes oreilles chauffer sous mes cheveux. Si ma sœur a honte de moi, je ne vais pas en rajouter en me faisant accompagner comme un bébé. N’osant pas repousser explicitement mon beau-père, je me dépêche d’ouvrir la marche, avançant à grandes enjambées qu’il n’a aucun mal à suivre. Nous traversons la rue, mélangés à d’autres. Plusieurs filles nous dépassent en courant pour rejoindre leurs copines. Surexcitées, elles se sautent au cou dans un envol de cheveux longs et d’écharpes. Mon estomac se noue d’un cran supplémentaire.
Et si je suis la seule nouvelle ? Si tous les élèves de ma classe se connaissent déjà ?
— Il ne faut pas t’en faire une montagne, ajoute Christophe. Ta sœur entre en troisième, elle a besoin de montrer qu’elle est grande. Ce n’est pas contre toi, tu sais !
Je trouve qu’il parle trop fort. À vingt mètres de la grille, personne n’a besoin de savoir que ma sœur m’a lâchée. Et puis tout me dérange, d’un coup : sa stature qui dépasse tous les autres parents, ses lunettes kitsch, son sweat Star Wars. Je m’arrête.
— Je continue toute seule.
— Tu dis, ma puce ? fait Christophe en pliant son double-mètre.
Au lieu de me répéter, je désigne les collégiens qui franchissent la grille. L’énorme majorité des adultes s’arrêtent là, à la démarcation précise où aucun parent ne peut affronter une rentrée à la place de son enfant.
— Tu es sûre ? demande Christophe, l’air inquiet.
J’éprouve une pointe d’agacement. Pour qui il se prend, à la fin ? Pour papa ?
— À ce midi.
Ma petite voix passe inaperçue dans le brouhaha. Je m’échappe.
En quelques pas, je me fonds dans la marée montante des élèves. La plupart me dépassent d’une bonne demi-tête, à l’exception de quelques sixièmes au regard apeuré. Je me retrouve assaillie par les odeurs haïes de la rentrée : les tissus synthétiques des sacs à dos neufs, les eaux de toilette sucrées des filles, quelques relents de cigarettes que des troisièmes se dépêchent d’écraser en entrant dans l’enceinte. J’angoisse tellement que mes aisselles se trempent de sueur. J’ai beau me trouver à des centaines de kilomètres de mon ancien collège, rien n’a changé. Les sensations et les bruits sont juste agencés différemment.
Malgré moi, je cherche Sandra dans la foule. Elle est pourtant facile à repérer, avec sa chevelure blonde et sa haute taille, mais je ne l’aperçois nulle part. Imitant son dernier geste, j’agrippe les bretelles de mon sac à dos des deux mains pour me donner du courage, et je m’oriente vers les panneaux des classes. Plus j’avance, plus la foule ralentit et se solidifie. Je me faufile en apnée au milieu des sacs et des manteaux. Dans une succession floue, j’aperçois des garçons immenses aux sacs à dos négligemment accrochés à une épaule, des filles au regard assombri par leur maquillage. D’autres pianotent sur leur portable ou appellent leurs copains en criant. Je dois déployer des trésors de furtivité pour accéder aux panneaux, puis pour me décaler tout à gauche, où sont placardées les classes des cinquièmes.
Par chance, mon nom de famille est « Jerval », ce qui m’évite de me tordre le cou pour atteindre le haut de l’affiche, mais je suis incapable de voir la moindre lettre de la partie inférieure : une fille se tient devant moi, sa chevelure abondamment bouclée me cachant la liste. Soudain, elle pousse un cri perçant et pivote, m’envoyant ses cheveux dans la figure.
— LES FILLES ! On est dans la même classe !
Des exclamations surexcitées retentissent derrière moi. Le visage inondé de joie, la fille s’échappe de la foule. Je me dépêche de prendre sa place, bousculant un garçon qui a eu le même réflexe. Je marmonne une excuse et me décale sur le côté, oppressée par le mouvement de foule qui me pousse inexorablement vers le panneau. Se retrouver là, c’est comme être au tableau : la liste semble devenir géante, se déformer sous mon regard. Les mots et les chiffres flottent devant moi, réduits à de simples barres et courbes d’encre. Je pose une main sur le panneau en métal pour tenter de trouver un repère.
— Ça va ? demande une voix.
C’est le garçon que je viens de bousculer. Je m’écarte un peu de l’affiche pour le voir. Il m’observe derrière de grosses lunettes en plastique rouge. Elles sont un peu sales, mais, derrière, je distingue ses yeux bridés à l’expression très sérieuse. Il a des cheveux noirs et raides, trop longs, qui tombent dans son cou et sur son front. On dirait qu’il essaie de faire disparaître son visage de toutes les façons possibles. Je n’aime pas trop ce qu’il dégage.
— Oui, ça va, dis-je rapidement.
Je reviens aux panneaux, glissant un regard au passage sur son pantalon noir à pinces – qui porte un truc pareil au collège, franchement ? – et son tee-shirt décoré d’un énorme logo de jeu vidéo que je ne connais pas. Je le place définitivement dans la catégorie des nerds et m’en retourne à la pancarte. Le garçon m’aide sans le savoir : il fait glisser son doigt de nom en nom, puis s’arrête à la ligne : « JUNG Makoto - 5e 3 ». Mon nom se trouve juste au-dessus, associé au même numéro.
Super. Je n’aurai qu’à le suivre pour trouver ma classe.
J’attends qu’il s’en aille pour m’extirper de la foule à mon tour. D’autres élèves nous imitent. J’aperçois quelques filles qui courent rejoindre leurs amies, euphoriques. Certains élèves, à l’inverse, ont du mal à retenir leurs larmes. Je me sens étrangère à tous. La tête rentrée dans les épaules, le cœur battant la chamade, je presse le pas en tentant de ne pas perdre de vue le garçon.
En traversant la cour, une chevelure dorée accroche mon regard : au milieu de sa nouvelle classe, Sandra discute déjà avec une fille, sourire aux lèvres. Rien à voir avec la soupe au lait qu’elle nous sert à la maison. Je me fais toute petite en passant devant elle, mais de toute façon elle ne me remarque pas.
Soudain, le dénommé Makoto bifurque vers le bâtiment principal. J’aperçois une feuille A4 au-dessus des têtes, avec la mention « 5e 3 » inscrite au Stabilo bleu. Elle est brandie par un petit homme ventripotent avec un chignon serré et des lunettes à monture dorée. Une bonne vingtaine d’élèves s’attroupent autour de lui. Je ralentis aussitôt.
Personne n’a l’air de se connaître, à part la fille aux cheveux bouclés et ses deux copines qui discutent à mi-voix, et une poignée d’élèves. Tous les autres sont silencieux. J’observe attentivement les visages. Qui sera ami, ennemi ? Populaire ou suiveur ? Certains profils, certains looks se détachent. Mais je suis bien placée pour savoir qu’il est impossible de prédire le comportement d’une personne à sa seule apparence. Ma précédente année au collège me l’a bien fait comprendre : les personnes les plus banales peuvent être capables du pire. Quant au meilleur… Au collège, je l’ai rarement vu.
Une angoisse familière commence à grimper en moi, me bloquant la gorge, me brouillant la vue. Je serre les poings pour retrouver mon sang-froid. C’est un nouveau collège, me dis-je avec force. Le groupe de Rémi, Pauline, Victor n’est plus ici. Cette année, je redémarre de zéro. Je me fondrai dans la masse.
Les paumes moites, je vais me placer au bout de la file, derrière deux garçons qui échangent des cartes en douce. À mon arrivée, ils me gratifient d’un coup d’œil éclair, et se détournent pour pouffer en silence. Je me pétrifie. Le prof frappe dans ses mains.
— Bonjour à tous ! Je suis M. Acclo, votre professeur principal. Nous sommes au complet : nous allons pouvoir aller en classe. Mettez-vous en rangs.
Un mouvement parcourt la classe au fur et à mesure que chaque élève se place près de son binôme. Je me retrouve en fin de file, seule, jusqu’à ce que le garçon aux yeux bridés vienne se placer à côté de moi. Je lui jette un coup d’œil méfiant, et j’aperçois soudain son sac à dos. Plus exactement, c’est une mallette en cuir d’un autre âge, complètement avachie. On dirait qu’elle a traversé la Première Guerre mondiale. Je comprends soudain le ricanement des deux garçons.
— On y va ! lance M. Acclo.
Il nous fait un grand geste du bras et ouvre la marche. La file d’élèves s’ébranle à sa suite, se disloquant petit à petit. En passant devant Sandra, je détourne la tête pour observer la cour, mon regard sautant de détail en détail. La peinture blanche, à moitié effacée, qui délimite le terrain de foot ; les arbres aux cimes rognées ; le bâtiment carré, d’un gris naguère blanc, aux dizaines de fenêtres ternes.
— Tu es nouvelle ?
Je tressaille. Makoto s’est tourné vers moi, prenant le même ton un peu brusque, un peu distant, que devant les panneaux d’affichage. Je fais sobre :
— Oui.
— Moi aussi. Tu viens d’où ?
Devant nous, les garçons cessent de discuter. Je me demande si c’est pour nous écouter.
— Région parisienne.
— Oh ! s’exclame Makoto, dont le regard se nuance.
Il m’observe plus attentivement, comme s’il me comparait avec le portrait-robot d’une collégienne d’Île-de-France. Le résultat ne doit pas être concluant, car il change de sujet :
— C’est à ton père, la camionnette avec des fleurs ?
Cette fois, l’un des garçons se retourne carrément pour m’examiner. La panique me donne l’impression subite de nager dans mes chaussettes.
— Non.
— C’est vrai ? s’entête le garçon. Je suis quasiment sûr de t’avoir vue sortir de la camionnette.
Mais de quoi se mêle-t-il, celui-là ? Je prends une voix coupante qui me donne l’impression d’entendre maman :
— C’est pas mon père.
Makoto doit comprendre le message : il ne me parle plus jusqu’à notre entrée dans le bâtiment. M. Acclo nous entraîne dans un escalier qui résonne fort, puis ouvre la porte d’une salle du deuxième étage.
— Je ferai le plan de classe plus tard, déclare-t-il. Choisissez votre place, dans le calme, s’il vous plaît !
Un frémissement parcourt la classe et, aussitôt, tout le monde s’éparpille à la recherche du meilleur emplacement. Les premiers arrivés se précipitent vers les rangées du fond. Ceux qui se connaissent se dépêchent de s’asseoir côte à côte. Quand Makoto et moi nous avançons enfin, presque toutes les rangées sont prises. Mon voisin s’assied sagement au premier rang et me lance un regard que j’ignore délibérément. Avisant une table libre dans la rangée du milieu, à côté d’une fille brune un peu dodue, je me précipite pour y poser mon sac. Je me sens un peu coupable, mais tant pis : ce garçon renfermé, avec sa mallette de grand-père, n’est sûrement pas celui qui va m’aider à m’intégrer.
— C’est déjà pris, ici, dit la fille brune en me lançant un regard acéré.
Ma main se fige à deux centimètres de la chaise.
— C’est la place de Chloé ! répète la fille, agacée.
— Pas grave, je me mets là, c’est pareil ! déclare une nouvelle voix.
Je me retourne pour voir une grande blonde s’installer au quatrième rang, juste derrière moi. Ma voisine émet un soupir excédé et, m’ignorant délibérément, sort sa trousse. Je me liquéfie sur place.
Pour un premier jour de rentrée, je suis loin du parcours sans faute.
Extraits

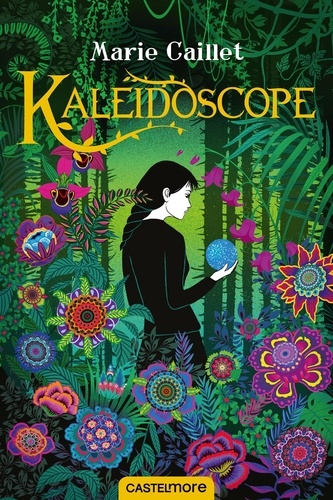


























Commenter ce livre