La dernière conquête du major Pettigrew
Helen Simonson
1.
Encore bouleversé par le coup de téléphone qu'il venait de recevoir de l'épouse de son frère, le major Pettigrew ouvrit sa porte, sans réfléchir. Mme Ali, de la boutique du village, se tenait là, dans l'allée de brique humide. Elle eut un tressaillement presque imperceptible, haussa le sourcil - mais à peine. Une bouffée d'embarras monta tout à coup aux joues du major et il ne put s'empêcher de lisser du plat de la main sa robe de chambre écarlate aux motifs de clématites - des mains qui lui firent soudain l'effet de deux battoirs.
«Ah, dit-il.
— Major?
— Madame Ali?»
Il y eut un silence qui parut se dilater lentement, comme l'univers qui, venait-il de lire, s'espaçait peu à peu avec le temps. «Sénescence», c'était le terme qu'ils employaient, dans le journal de dimanche.
«Je suis venue pour l'argent du journal. Mon petit vendeur est malade », lui expliqua-t-elle, dressée de toute sa menue stature et brusquant le ton, très loin de la rondeur lente, modulée de sa voix quand ils commentaient ensemble la texture et le parfum des thés qu'elle mettait à infuser tout spécialement pour lui.
«Je suis absolument confus, bien sûr. » Il avait oublié de mettre l'argent de la semaine dans une enveloppe, sous le paillasson, devant la porte. Fouillant les poches de son pantalon, dissimulées quelque part sous les clématites, il sentit ses yeux se mouiller. Ses poches s'obstinèrent à demeurer inaccessibles, jusqu'à ce qu'il soulève l'ourlet de sa robe de chambre. «Je suis confus, reprit-il.
— Oh, pas de problème, fit-elle, reculant d'un pas. Vous pouvez me déposer ça plus tard au magasin... à un moment où ce sera plus commode. »
Elle se détournait déjà quand il fut saisi d'un impérieux besoin de s'expliquer.
«Mon frère est mort», annonça-t-il.
Elle se retourna.
«Mon frère est mort, répéta-t-il. J'ai reçu le coup de fil ce matin. Je n'ai pas eu le temps. »
Le ciel était encore rose et, dans l'if gigantesque sur le versant sud du cottage, le chœur de l'aube n'avait pas achevé son bavardage quand le téléphone avait sonné. Depuis lors, bien qu'il se soit levé tôt pour s'attaquer à son ménage hebdomadaire, il était resté, devait-il admettre, dans un état d'hébétude. Avec un geste d'impuissance, il désigna sa tenue étrange et se passa la main sur le visage. Subitement, ses genoux se dérobèrent sous lui et il eut l'impression que le sang refluait de sa tête. Il sentit son épaule heurter le chambranle de la porte, et Mme Ali, si rapide qu'il ne put la suivre du regard, se trouver à ses côtés pour le soutenir.
«Je crois que nous ferions mieux de rentrer au chaud et de nous asseoir, dit-elle d'une voix empreinte de sollicitude. Si vous le permettez, je vais aller vous chercher un verre d'eau.»
Comme il lui semblait avoir perdu presque toute sensibilité à ses extrémités, il n'eut d'autre choix que d'obtempérer. Elle le guida le long de l'étroit couloir au dallage de pierre inégal puis le déposa dans la bergère, au coin, juste derrière la porte du salon lumineux tapissé de livres. C'était le fauteuil qu'il appréciait le moins, avec son rembourrage plein de bourrelets, sa rude corniche en bois située précisément au mauvais endroit, à hauteur de sa nuque - mais il n'était pas en position de se plaindre.
«J'ai pris celui qui séchait sur l'égouttoir», fit-elle, en lui présentant le gros verre à bord épais dans lequel il mettait à tremper son demi-bridge la nuit. Le très léger soupçon de parfum mentholé lui souleva le cœur. «Vous sentez-vous un peu mieux?
— Oui, bien mieux, fit-il, les yeux baignés de larmes. C'est très gentil à vous...
— Puis-je vous préparer un peu de thé ? »
Rien qu'à l'entendre le lui proposer, il se sentit fragile et pitoyable.
«Merci», dit-il.
Il aurait donné le bon Dieu sans confession, pourvu qu'elle sorte de la pièce afin de lui laisser le temps de g recouvrer un semblant de vigueur et de se défaire de cette robe de chambre.
C'était étrange, songea-t-il, d'entendre à nouveau des tasses de thé s'entrechoquer dans la cuisine, entre les mains d'une femme. Dans son cadre sur la tablette de cheminée, son épouse Nancy lui souriait, ses cheveux châtains en bataille, le nez moucheté de taches de rousseur et légèrement rosi par un coup de soleil. En mai de cette année pluvieuse - ce devait être en 1973 -, ils étaient dans le Dorset, lorsqu'un rayon de soleil avait brièvement éclairé cet après-midi venteux; assez longtemps pour qu'il la prenne en photo, et comme une très jeune fille, elle lui avait fait signe de la main depuis les remparts de Corfe Castle. Six ans qu'elle était partie. Et maintenant, Bertie était parti, lui aussi. Ils le laissaient seul, lui, le dernier membre de la famille, le dernier de sa génération. Il joignit les mains, de manière à calmer un discret tremblement.
Bien sûr, il y avait Marjorie, sa belle-sœur désagréable ; mais il ne l'avait jamais tout à fait acceptée, comme ses défunts parents. Elle avait des opinions excessives, incongrues, et un accent du nord de l'Angleterre qui vous écorchait le tympan comme un rasoir à la lame émous-sée. Pourvu qu'elle ne cherche pas désormais à créer davantage de familiarité entre eux. Il allait lui demander une photo récente de Bertie, et son fusil de chasse, bien entendu. Quand leur père avait dissocié cette paire d'armes entre ses deux fils, il leur avait clairement signifié qu'il faudrait la reconstituer en cas de décès, afin qu'elle reste dans la famille, intacte. Durant toutes ces années, l'arme du major était restée couchée, solitaire, dans son double étui en noyer matelassé de velours, un evasement indiquant l'absence de sa jumelle. Les deux fusils allaient à présent retrouver leur valeur pleine et entière - autour d'une centaine de milliers de livres, sans doute. Quoi qu'il en soit, jamais il ne songerait à les vendre. L'espace d'un instant, il s'imagina très distinctement rejoignant le groupe des invités lors de la prochaine chasse, peut-être le long de la rivière sur l'une de ces fermes toujours infestées de lapins, la paire de fusils calée nonchalamment au creux du bras, canon ouvert.
«Dieu du ciel, Pettigrew, est-ce une paire de Churchill?» lui lancerait quelqu'un - Lord Dagenham en personne, pourquoi pas, s'il tirait en leur compagnie ce jour-là -, et lui, il poserait un bref regard sur les armes avant de répondre, l'air de rien, comme s'il avait déjà l'esprit ailleurs.
«Oui, une paire assortie. On les travaillait dans un noyer assez élégant à l'époque de leur fabrication. »
Et il les tendrait à son interlocuteur, pour qu'il les examine et les admire.
Un cliquetis métallique contre le montant de la porte le tira en sursaut de ce plaisant interlude. C'était Mme Ali avec un plateau lourdement chargé. Elle avait retiré son manteau de laine verte et jeté un châle à motif cachemire sur ses épaules, par-dessus la robe bleu marine qu'elle portait avec un pantalon noir à la coupe étroite. Le major se rendit compte qu'il ne l'avait jamais vue sans le grand tablier en tissu raide dont elle se couvrait à la boutique.
«Laissez-moi vous aider.» Il s'apprêtait à se lever de son fauteuil.
«Oh, je me débrouille très bien», lui assura-t-elle, et elle alla déposer son plateau sur le bureau tout proche, en repoussant du coin une petite pile de livres à reliure en cuir. «Vous avez besoin de récupérer. Vous êtes sans doute sous le choc.
— Je ne m'y attendais pas, le téléphone a sonné tellement tôt, c'est invraisemblable. Il n'était pas six heures, vous savez. Je crois qu'ils ont passé toute la nuit à l'hô-pi l al.
— Vous ne vous y attendiez pas?
— Crise cardiaque. Une attaque foudroyante, apparemment. » Plongé dans ses pensées, il lissa sa moustache hérissée. «C'est curieux, je ne sais pourquoi, mais les gens qui font une crise cardiaque, de nos jours, on croit pouvoir les sauver. C'est l'impression que ça donne, quand on voit ce genre de choses à la télévision.» Mme Ali approcha le bec vacillant de la théière contre le bord de la tasse. Il y eut un toc sourd et il redouta une fêlure. Il lui revint à l'esprit (mais trop tard) que le mari de Mme Ali était lui-même décédé d'une crise cardiaque. Cela devait remonter maintenant à dix-huit mois ou deux ans. «Je suis désolé, quel manque de tact de ma part, je... » Elle l'interrompit d'un geste à la fois compré-hensif et dissuasif, et continua de verser. «C'était un homme bien, votre mari», ajouta-t-il.
Son souvenir le plus net du personnage, c'était sa réserve, un grand bonhomme silencieux. Après la reprise de la boutique du village de la vieille Mme Bridge, les choses ne s'étaient pas déroulées sans heurts pour M. Ali. En deux occasions au moins, le major l'avait vu, par une vivifiante matinée printanière, calmement occupé à gratter les injures bombées sur ses baies vitrées toutes neuves. Le major Pettigrew s'était plusieurs fois trouvé au magasin quand, par défi, de jeunes garçons avaient pointé d'énormes épis de maïs par la porte en hurlant : « Pakistanais, du balai ! » M. Ali s'était contenté de secouer la tête avec un sourire, mais le major, lui, fulminait et bredouillait des excuses. Cette fureur avait fini par s'apaiser. Les mêmes petits spécimens se glissaient en catimini dans la boutique, à neuf heures du soir, quand leur mère se trouvait à court de lait. Le plus buté des ouvriers du coin avait fini par se fatiguer de rouler six kilomètres sous la pluie pour s'acheter son billet de loterie nationale dans un magasin «anglais». Les couches supérieures de la société villageoise, conduite par les dames des divers comités locaux, compensaient la grossièreté de ses couches inférieures en témoignant à M. et Mme Ali un respect largement partagé. Le major avait entendu plus d'une de ces dames évoquer avec fierté «nos chers amis pakistanais de la boutique», la preuve de ce qu'Edgecombe Saint Mary était un lieu véritablement utopique de l'entente multiculturelle.
La mort de M. Ali avait bouleversé tout le monde, comme il se devait. Le conseil municipal au sein duquel siégeait le major avait débattu d'un éventuel service com-mémoratif, sous une forme ou une autre et, l'idée n'ayant pas abouti (ni l'église de la paroisse, ni le pub n'étant tout à fait adéquats pour la circonstance), on avait envoyé une très grosse couronne au funérarium.
«Je trouve désolant de ne pas avoir eu la chance de rencontrer votre charmante épouse, lui fit-elle, en lui tendant une tasse.
— Oui, elle nous a quittés depuis six ans maintenant.
Extraits

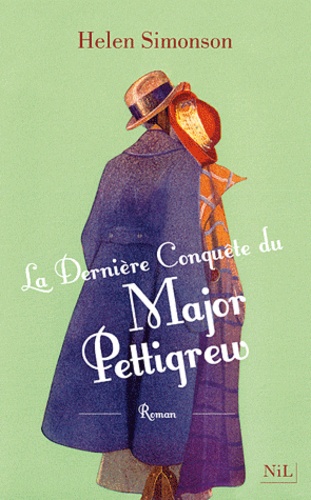



























Commenter ce livre