Le confident
Hélène Grémillon
PARIS, 1975.
Un jour, j'ai reçu une lettre, une longue lettre pas signée. C'était un événement, car dans ma vie je n'ai jamais reçu beaucoup de courrier. Ma boîte aux lettres se bornant à m'annoncer que la-mer-est-chaude ou que la-neige-est-bonne, je ne l'ouvrais pas souvent. Une fois par semaine, deux fois les semaines sombres, où j'attendais d'elles, comme du téléphone, comme de mes trajets dans le métro, comme de fermer les yeux jusqu'à dix puis de les rouvrir, qu'elles bouleversent ma vie.
Et puis ma mère est morte. Alors là, j'ai été comblée, pour bouleverser une vie, la mort d'une mère, on peut difficilement mieux faire.
Je n'avais jamais lu de lettres de condoléances. À la mort de mon père, ma mère m'avait épargné cette funèbre lecture. Elle m'avait seulement montré la convocation à la remise de médaille. Je me souviens encore de cette foutue cérémonie, j'avais treize ans depuis trois jours : un grand type me serre la main, il me sourit mais c'est un rictus que je reçois à la place, il a la gueule de travers et quand il parle, c'est pire.
— Il est infiniment déplorable que la mort ait été l'issue d'un tel acte de bravoure. Votre père, mademoiselle, était un homme courageux.
— Vous dites cette phrase à tous les orphelins de votre guerre ? Vous pensez qu'un sentiment de fierté fera diversion à leur chagrin. C'est très charitable de votre part, mais laissez tomber, je n'ai pas de chagrin. Et puis mon père n'était pas un homme courageux. Même la grande quantité d'alcool qu'il ingurgitait tous les jours ne l'y aidait pas. Alors disons que vous vous trompez d'homme et n'en parlons plus.
— Au risque de vous étonner, je maintiens, mademoiselle Werner, que c'est bien du sergent Werner — votre père — dont je vous parle. Il s'est porté volontaire pour ouvrir la voie, le champ était miné et il le savait. Que vous le vouliez ou non, votre père s'est illustré et vous devez prendre cette médaille.
— Mon père ne s'est pas «illustré», stupide grande gueule de travers, il s'est suicidé et il faut que vous le disiez à ma mère. Je ne veux pas être la seule à le savoir, je veux pouvoir en parler avec elle et avec Pierre aussi. Le suicide d'un père, ça ne peut pas être un secret.
Je m'invente souvent des conversations pour dire les choses que je pense, c'est trop tard, mais ça me soulage. En vrai, je ne suis pas allée à cette cérémonie pour la mémoire des soldats de la guerre d'Indochine et, en vrai, je l'ai dit une seule fois ailleurs que dans ma tête que mon père s'est suicidé, c'était à ma mère, dans la cuisine, un samedi.
Le samedi, c'était le jour des frites et j'aidais ma mère à éplucher les pommes de terre. Avant, c'était papa qui l'aidait. Il aimait éplucher et moi j'aimais le regarder faire. Il ne parlait pas plus quand il épluchait que quand il n'épluchait pas, mais au moins il y avait un son qui sortait de lui et ça faisait du bien. Tu sais Camille que je t'aime. Je posais toujours les mêmes mots sur chacun de ses coups de couteau : tu sais Camille que je t'aime.
Mais sous mes propres coups de couteau ce samedi-là, j'ai posé d'autres mots : «Papa s'est suicidé, tu le sais, n'est-ce pas, maman ? que papa s'est suicidé. » La friteuse était tombée en brisant le carrelage du sol et l'huile s'était répandue entre les jambes figées de ma mère. J'avais eu beau nettoyer frénétiquement, nos pieds avaient continué de coller pendant plusieurs jours, faisant grincer ma phrase à nos oreilles : « Papa s'est suicidé, tu le sais, n'est-ce pas, maman, que papa s'est suicidé ? » Pour ne plus l'entendre, Pierre et moi parlions plus fort, peut-être aussi pour couvrir le silence de maman qui, elle, depuis ce samedi-là, ne parlait presque plus.
Aujourd'hui, le carrelage de la cuisine est toujours cassé, je m'en suis fait la réflexion la semaine dernière en faisant visiter la maison de maman à ce couple intéressé. Chaque fois qu'il regardera cette grande fissure sur le sol, ce couple intéressé, s'il se transforme en couple acheteur, déplorera le laisser-aller des propriétaires d'avant, et le carrelage sera leur première étape de rénovation et ils seront très contents de s'y atteler, ça aura au moins servi à ça, mon horrible déballage. Il faut absolument qu'ils achètent la maison, eux ou d'autres je m'en fous, mais il faut que quelqu'un l'achète. Je n'en veux pas et Pierre non plus, un endroit où le moindre souvenir rappelle les morts n'est pas un endroit pour vivre.
Quand elle était rentrée de la cérémonie pour papa, maman m'avait montré la médaille. Elle m'avait dit que le type qui la lui avait remise avait la gueule de travers et elle avait essayé de l'imiter en essayant de rire. Depuis la mort de papa, elle ne savait plus faire que ça : essayer. Et puis elle m'avait donné la médaille en me serrant fort les mains, en me disant qu'elle me revenait, et elle s'était mise à pleurer, ça, elle y arrivait très bien. Ses larmes étaient tombées sur mes mains, mais je les lui avais brutalement retirées, ressentir la douleur de ma mère dans mon corps m'était insupportable.
En ouvrant les premières lettres de condoléances, mes propres larmes sur mes mains me rappelèrent ces larmes de maman et je les laissai glisser pour voir par où étaient passées celles de celle que j'aimais tant. Je savais ce que ces lettres avaient à me dire : que maman était une femme extraordinaire, que la perte d'un être cher est quelque chose de terrible, que rien n'est plus violent que ce deuil-là, etcetera, etcetera, je n'avais pas besoin de les lire. Alors chaque soir, je répar-tissais les enveloppes en deux paquets : à droite, celles qui portaient le nom de l'expéditeur, à gauche, celles qui n'en portaient pas et je me contentais d'ouvrir le paquet de gauche et de sauter directement à la signature pour voir qui m'avait écrit et qui je devrais remercier. Finalement, je n'ai pas remercié grand monde et personne ne m'en a tenu rigueur. La mort accepte tous les écarts de politesse.
La première lettre que j'ai reçue de Louis faisait partie du tas de gauche. L'enveloppe avait attiré mon attention avant que je ne l'ouvre, elle était beaucoup plus épaisse et plus lourde que les autres. Elle ne ressemblait pas au format d'un mot de condoléances.
C'était une lettre manuscrite de plusieurs pages, sans signature.
Annie a toujours fait partie de ma vie, j'avais deux ans quand elle est née, deux ans moins quelques jours. Nous habitions le même village — N. — et je la croisais sans la chercher, l'école, les promenades, la messe.
La messe, cette heure terrible où il se passait toujours les mêmes choses que je devais invariablement supporter, coincé entre mon père et ma mère. Les places que nous occupions à l'église étaient un signe de notre tempérament : entourage fraternel pour les plus doux, parental pour les plus récalcitrants. Dans ce plan de messe adopté sans concertation par tout le village, Annie faisait figure d'exception, la pauvre, elle était fille unique, je dis « la pauvre » parce qu'elle s'en plaignait tout le temps. Ses parents étaient déjà vieux quand elle est arrivée et sa naissance fut pour eux un tel miracle que pas un jour ne passait sans qu'ils disent « tous les trois », comme ça, à la moindre occasion, pendant qu'Annie regrettait de ne pas entendre « tous les quatre », « tous les cinq », « tous les six »... Chaque messe lui rendait ce constat plus éprouvant : seule sur son banc.
Quant à moi, si j'estime aujourd'hui que l'ennui est le meilleur terreau de l'imagination, à cette époque, j'avais surtout décrété que le meilleur terreau de l'ennui, c'était la messe. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse m'y arriver quoi que ce soit. Jusqu'à ce dimanche-là.
Un profond malaise me saisit dès le chant d'ouverture. Tout me semblait déséquilibré, l'autel, l'orgue, le Christ sur sa croix.
— Arrête de soupirer comme ça, Louis, on n'entend que toi !
Cette remontrance de ma mère, ajoutée au malaise qui ne me quittait pas, réveilla une phrase tapie en moi, une phrase que mon père lui avait un soir murmurée : « Le père Fantin a rendu son dernier soupir. »
Mon père était médecin et il connaissait toutes les expressions pour annoncer la mort de quelqu'un. Il les utilisait tour à tour, chuchotant à l'oreille de ma mère. Mais comme tous les enfants, j'avais le don de percevoir ce que les grands se murmuraient et je les entendais toutes : « fermer son parapluie », « mourir dans ses souliers », « rendre l'âme », « mourir de sa belle mort » — celle-ci je l'aimais bien, j'imaginais qu'elle faisait moins mal.
Et si j'étais en train de mourir ?
Après tout, on ne sait jamais ce que ça fait de mourir avant de mourir pour de bon.
Et si c'était le prochain, mon dernier soupir ? Terrorisé, je bloquai ma respiration et je me tournai vers la statue de saint Roch en le suppliant ; il avait guéri des lépreux, il pouvait bien me sauver.
Le dimanche qui suivit, il était hors de question que je retourne à la messe, cette fois la mort ne me raterait pas, j'en étais certain. Mais quand je me suis retrouvé sur le banc que nous occupions toutes les semaines avec ma famille, le malaise que j'appréhendais ne se fit pas sentir. Au contraire, une certaine douceur m'envahit, je retrouvai avec plaisir l'odeur de bois si particulière à cette église, tout était à sa place. Mon regard avait retrouvé son socle, il s'appuyait sur Annie, ses cheveux pour tout visage. Tout à coup je le compris, c'était son absence qui m'avait jeté dans cet horrible trouble la semaine passée. Certainement était-elle allongée chez elle, un gant sur le front pour calmer les spasmes, ou en train de peindre, à l'abri de mouvements trop brusques. Annie était sujette à de violentes crises d'asthme qu'on lui enviait tous car elles la dispensaient des choses désagréables. Sa silhouette encore un peu toussotante rendait à tout ce qui m'entourait sa plénitude et sa cohérence. Elle se mit à chanter, elle n'était pas d'un naturel joyeux et je m'étonnais toujours de la voir s'animer de tout son buste dès que l'orgue retentissait. Je ne savais pas encore que le chant était pareil au rire et qu'on pouvait tout y mettre, même la mélancolie.
La plupart des gens tombent amoureux d'une personne en la voyant, moi l'amour m'a pris en traître. Annie n'était pas là quand elle s'est installée dans ma vie. C'était l'année de mes douze ans, Annie avait deux ans de moins que moi, deux ans moins quelques jours.
J'ai commencé par l'aimer comme un enfant, c'est-à-dire en présence des autres. L'idée d'un tête-à-tête ne m'effleurait pas, je n'avais pas l'âge de la conversation. J'aimais pour aimer, non pas pour être aimé. Le seul fait de passer devant Annie suffisait à me mettre en joie. Je lui volais ses rubans pour qu'elle me coure après et qu'elle me les arrache des mains, sèchement, avant de tourner les talons, sèchement. Il n'y a rien de plus sec qu'une petite fille vexée. C'étaient ces bouts de tissu qu'elle rajustait maladroitement dans ses cheveux qui m'avaient fait les premiers penser aux poupées du magasin.
Ma mère tenait la mercerie du village. Après l'école, nous nous y rendions tous les deux, moi pour rejoindre ma mère, Annie pour rejoindre la sienne qui y passait la moitié de sa vie, la moitié qu'elle ne passait pas à coudre. Un jour où Annie passait sous l'étagère des poupées, la ressemblance me frappa soudain. Outre les rubans, elle en avait le même teint sauvagement blanc et fragile. Mon jeune raisonnement s'emporta alors et je remarquai que je n'avais jamais vu de sa peau plus que ce que son cou, son visage, ses pieds et ses mains ne m'en offraient. E-xa-cte-ment comme pour les poupées de porcelaine ! Quand je traversais la salle d'attente du cabinet de mon père, il arrivait parfois qu'Annie soit là. Elle venait toujours toute seule en consultation, assise, petite, au milieu du siège noir. Son asthme lui mangeant le visage, elle ne leur ressemblait jamais plus qu'avec ce fard à joues de quinte de toux. Mais, bien sûr, mon père ne me le dirait jamais qu'Annie avait un corps de chiffon, même si je lui demandais. « Secret professionnel », me répondrait-il en me tapotant sur la tête avant de faire la même chose sur les fesses de maman qui lui sourirait avec ce sourire qui me gênait tant.
Toute ressemblance étant réciproque, les poupées de porcelaine me faisaient penser à Annie, alors je les volais. Mais une fois à l'abri dans ma chambre, j'étais immanquablement frappé par leurs cheveux trop bouclés ou trop raides, leurs yeux trop ronds, trop verts, et jamais ces longs cils qu'Annie rehaussait de son index quand elle réfléchissait. Comme tout le monde, ces poupées n'étaient faites pour ressembler à personne, mais je leur en voulais. Alors, j'allais à l'étang, je leur attachais une pierre aux pieds et je les regardais couler sans peine, tout en pensées à la nouvelle que j'allais m'approprier, une plus ressemblante, j'espérais.
L'étang était profond, il n'y avait qu'en de rares endroits où l'on pouvait se baigner sans danger.
Cette année-là, au centre du monde, il y avait moi et Annie. Autour, il se passait plein de choses dont je me fichais éperdument. En Allemagne, Hitler devenait chancelier du Reich et le parti nazi, parti unique. Brecht et Einstein s'enfuyaient pendant que Dachau se construisait. Naïve prétention de l'enfance de se croire à l'abri de l'histoire.
Extraits


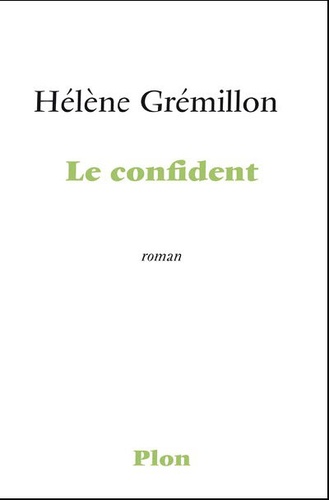




























Commenter ce livre