Mer blanche
Roy Jacobsen
I
1
Le poisson apparut en premier. L’homme n’est qu’un invité tenace de la mer. Le contremaître entra et demanda aux filles si certaines d’entre elles savaient découper le poisson, car un banc de morues que l’on n’attendait pas venait d’arriver. Ingrid leva la tête du tonneau de harengs et posa le regard sur le quai où des flocons de neige dansants disparaissaient dans la charpente noire, elle s’essuya les mains sur son tablier, suivit l’homme dans l’atelier de salage et se plaça à côté du banc de découpe et d’un bac de poissons nettoyés. Ils se dévisagèrent. D’un mouvement de la tête, il désigna le couteau sur la table, qui ressemblait à une petite hache.
Elle prit une morue d’une aune dans le bac et la déposa sur le banc, coupa le collier, souleva l’opercule des branchies et découpa l’arête centrale de la tête au ventre, pratiquant l’incision jusqu’à la nageoire caudale, elle trancha l’arête centrale au niveau de l’anus, coupa l’arête également du côté droit et l’enleva comme si elle ouvrait d’un coup une fermeture éclair rouillée, et elle se retrouva avec l’arête dans la main gauche, immobile ; le poisson avait l’air d’une aile blanche sur le banc ensanglanté, prêt à être lavé et mis dans la saumure, prêt à être salé, mis à sécher, nettoyé, empilé et vendu en tant que cet or d’un blanc ivoire qui avait maintenu en vie ces côtes affamées depuis huit cents ans, depuis la première fois qu’il avait surgi dans un manuscrit.
« Fais voir le dos. »
Ingrid retourna le squelette dans sa main droite afin de cacher la coupure qu’elle s’était faite entre le pouce et l’index.
« Tout propre. »
Elle ajouta qu’elle pourrait rester tant qu’il y aurait du poisson, on ne savait jamais, à l’automne…
« Oui, mais il faut que tu te trouves des gants. »
Ingrid regarda son sang qui se mêlait à celui du poisson, pour former une goutte qui tomba à l’instant où le contremaître lui tourna le dos pour entrer dans son bureau avec ses semelles en caoutchouc qui gargouillaient.
Ingrid rêvait de partir, de regagner Barrøy, mais nul ne peut vivre seul sur une île, et il n’y avait personne là-bas, pas un homme ni une bête, Barrøy était vide et déserte, elle n’avait même pas été visible depuis la fin octobre, et elle ne pouvait pas non plus rester sur la Grande Île.
Elle découpa du poisson dix heures par jour, tenant le même rythme que deux saleuses. Au bout d’une semaine, elle ne pouvait plus s’endormir dans le grenier glacé de la tonnellerie, où elle était couchée avec Nelly et deux filles de l’intérieur du pays venues ici à cause de la guerre. Elles firent comme si elles ne pleuraient pas chaque soir, elles vidaient le hareng, le découpaient, le salaient dans des tonneaux, ajoutaient de la saumure et buvaient de l’ersatz de café, elles salaient, dormaient, se débarbouillaient un soir sur deux à l’eau froide, se lavaient les cheveux une fois par semaine, également dans une eau froide et couleur rouille sous un ciel d’écailles de hareng étincelantes, et Ingrid découpait la morue comme un homme.
Au milieu de la deuxième semaine, une des saleuses disparut et Nelly dut venir travailler avec elle. Il y eut une tempête le jour suivant et les bateaux cherchèrent refuge dans les îles. Ils n’accostèrent pas non plus le lendemain et, le troisième matin, quand ils purent enfin échapper à l’emprise de la neige, ils n’avaient même pas un gardon à bord.
Pourtant, ils étaient nombreux à les attendre, un pays entier les attendait, prêt à accueillir des hommes qui rentrent en vie, une fois encore. Puis il y eut davantage de mauvais temps, avec l’obligation de rester au port et de remiser le matériel, avec des prises inutilisables, tout juste bonnes à faire du guano, peut-être, cela dépendait de tant de choses, surtout des prix dans un autre monde que le leur ; on garda le rebut, on le mit à sécher, et l’histoire étrange de l’automne se termina.
Ingrid et Nelly trièrent le poisson salé, enlevant le mauvais et veillant à ce que celui qui était au fond de la saumure précédente se retrouve sur le dessus de la nouvelle. Le hareng prit fin à son tour et les deux filles qui venaient d’ailleurs furent congédiées, elles reçurent leur maigre salaire, s’ôtèrent mutuellement les écailles de leur visage, elles se lavèrent à l’eau froide, se séchèrent, se peignèrent, veillant à ce que leurs barrettes soient bien mises comme il faut, puis elles partirent par le vapeur en riant, avec des vêtements que personne ne leur avait vus.
Par ce même bateau arriva une lettre de la tante d’Ingrid, Barbro, qui était hospitalisée. La lettre était rédigée par une infirmière qui écrivait comme un médecin ; Ingrid fut capable de la déchiffrer, mais elle n’en comprit pas le contenu. Sa tante ne pouvait pas rentrer dans le Nord car sa fracture du col du fémur refusait de guérir, et il n’y avait pas de transports… Mais elle serait rentrée à temps pour Noël. C’était écrit deux fois. Barbro avait cinquante-neuf ans et Ingrid trente-cinq, ce soir-là, elle s’endormit tôt et ne rêva pas.
Elle se réveilla tôt également, resta au lit à écouter le vent qui grattait le toit d’ardoises et la mer qui sifflait et soufflait entre les piliers du quai et sous la respiration de Nelly, Nelly dormait comme une personne, le bruit du sommeil de Nelly, nuit après nuit, était la seule chose normale dans cet endroit, et ce jour-là, il était insupportable.
Ingrid se leva, se lava dans le seau en zinc, fit sa valise, ne mangea pas, ne prépara pas de café, prit ses vêtements de travail puants, passa derrière l’usine de conserve où les Allemands faisaient brûler des ordures dans un tonneau, elle y jeta ses vêtements, regarda les flammes jusqu’à ce que du monde arrive sur le quai. Il neigeait un peu.
Elle remonta à l’étage, prépara une sorte de café, en remplit une tasse qu’elle posa sur la chaise à côté du chevet de Nelly, qui ressemblait à une belle morte, elle attendit que le reflet sur le mur de l’usine lui indique que le contremaître était arrivé lui aussi, que l’aube allait poindre dans la nuit, puis elle se releva, descendit avec sa valise et demanda son solde.
Le contremaître posa son crayon usé d’un air stupéfait, il dit à la fois qu’elle devançait sa demande et qu’il ne pouvait pas se passer d’elle, des prises allaient être débarquées ce soir, elle était indispensable et superflue, l’escroquerie habituelle et compliquée du travail salarié, or Ingrid venait d’une île avec le ciel comme toit et comme murs, elle répéta donc qu’elle voulait son argent maintenant, elle attendit patiemment que tous les tiroirs soient ouverts et refermés, que les papiers soient bien déplacés et reposés, qu’il y ait les soupirs ambigus sur sa fiche horaire et le décompte minutieux des billets froissés, comme si c’était une insulte de demander son salaire, comme si, le jour de la paie, c’était le maître qu’il fallait plaindre et non l’esclave.
Ingrid emprunta le chemin verglacé jusqu’à la boutique, attendit que Margot ouvre, prit les produits dont elle avait besoin, y compris du café et de la margarine, elle paya avec des tickets et de l’argent, emprunta la carriole de Margot et roula ses courses jusqu’à la barque qui était restée sous le quai pendant tout l’automne.
Elle en vida la neige avec l’écope, chargea les courses et sa valise, elle remonta, reprit le chemin avec la carriole et croisa deux soldats allemands qui fumaient à l’abri de l’atelier de salage, ils avaient dû rester à l’observer pendant tout ce temps.
Elle redescendit l’escalier, remonta à bord, défit l’amarre et se mit aux avirons. Un des soldats vint sur le quai et lui cria quelques mots, agitant la main qui tenait la cigarette, un œil rouge dans l’hiver. Elle reposa les avirons, l’air étonné. Il répéta des paroles qu’elle n’entendit pas, la neige tomba plus dru encore, le bateau glissa sur l’eau et le soldat disparut.
Ingrid rama jusqu’à l’îlot tout en longueur de Gråholmen, suivit les rochers à un aviron de distance jusqu’à ce qu’ils disparaissent, il n’y avait aucune visibilité, la mer était lourde et calme.
Elle prit un cap à partir de la marque sur le dernier rocher, se guidant avec l’angle formé par le sillage sur la houle, et parvint à Oterholmen au bout d’une grosse demi-heure. Elle le passa à bâbord alors qu’elle aurait dû l’avoir à tribord. Elle ajusta son cap, poursuivit avec un nouvel angle entre les vagues et le sillage sinueux et toucha Barrøy une demi-heure après qu’Oterholmen eut disparu.
Elle porta les provisions à terre, ouvrit les portes du hangar à bateaux, remonta la barque avec le treuil que son père avait installé jadis dans son enfance, elle redressa le dos et regarda autour d’elle, elle regarda les maisons là-haut sur la masse grise du dos voûté de l’île, visibles à quinze ou vingt milles par temps dégagé et qui, en cet instant, n’étaient que quelques petites caisses noires sous une mince couche de lait, sans lumière, sans la moindre trace dans la neige.
[...]
2
Il faisait bon désormais dans la cuisine. Ingrid ôta son manteau, moulut le café et mit la bouilloire à chauffer, rangea les courses dans le garde-manger, alla chercher plus de combustible. Le café était prêt. Elle enleva le reste de ses vêtements d’extérieur et but le café en s’installant sur son fauteuil près de la fenêtre, jeta des coups d’œil vers les ombres à l’ouest, Moltholmen, Skogsholmen, les Lundeskjærene, et l’horizon endormi quelque part, au loin, dans ce jour qui ne donnerait rien. Elle ne mangea toujours pas. Elle chercha par où elle allait commencer, sous le poêle ou sous la table, dans le coin du garde-manger ?
Elle se leva, approcha la caisse de tourbe et commença à déchirer les journaux, elle fit des boules de papier qu’elle empila sur le plancher comme une lanterne de neige. Elles partirent dans toutes les directions. Elle les entassa à nouveau. C’était un journal qu’elle tenait du temps où Barrøy était une communauté, avec des gens, des bêtes et un phare, avec des tempêtes et de l’entêtement, avec du travail, des étés, des hivers et de la richesse, elle soutint les boules avec de petits bouts de bois et de tourbe afin de faire un feu, une idée que personne n’avait jamais eue, incendier une maison sur une île ; sur Barrøy, il y avait des ruines à l’est, mais ce n’était pas le résultat d’un incendie, et il ne faisait soudain aucun doute que ceux qui avaient quitté Karvika l’avaient fait de leur plein gré et non à cause d’une catastrophe ; ils en avaient eu assez, c’est tout, ils s’étaient regardés dans le miroir, avaient fait leurs valises et ils étaient partis. C’était une pensée insupportable.
Elle prit une lampe et monta dans la Salle Nord, puis elle entra dans la Salle Sud, jeta un regard dans la chambre de Barbro qui donnait à l’est, dans sa chambre avec le lit, le pot, la table de chevet et les dessins jaunis qu’elle avait faits à l’école et qu’elle n’avait pas vus depuis qu’elle était venue prendre des pommes de terre au mois de septembre ; la maison avait rapetissé, les portes étaient plus basses, les fenêtres plus étroites ; l’odeur des gens s’était incrustée dans les murs comme celle de la peinture, aujourd’hui, ce n’était qu’un parfum de terre lourde et humide ; elle passa le bout du doigt sur les perles de condensation et s’assit sur le lit de ses parents, dans lequel sa mère était morte.
« Laisse Lars reprendre Barrøy » avaient été ses dernières paroles. « Et pars, tu es jeune et intelligente, tourne le dos à la mer, retiens la leçon, ne fais pas comme moi… »
Ingrid dit non.
« Tu n’es pas assez forte.
— Si », répondit Ingrid à sa mère mourante.
Et, le printemps suivant, Lars ne rentra pas des Lofoten, il avait trouvé l’amour, disait-il dans sa lettre, et il resta sur place avec bateau, équipement et équipage, une année après l’autre, même quand la guerre éclata. Ingrid et Barbro furent de plus en plus seules au fil de chaque soleil qui se levait et de chaque tempête qui s’abattait, de chaque bête qu’elles tuaient et de chaque sac de duvet ramassé qu’elles ne vendaient pas, une femme jeune et une femme entre deux âges sur une île qui attendaient des lettres de Lars, rédigées d’une écriture soignée et régulière et qui, un beau jour, furent ornées de quelques fioritures vertes, la signature de Hans, le fils de Lars âgé de trois ans, les trois plus longues années de la vie d’Ingrid. Aujourd’hui, la guerre avait quatre ans et Hans avait un frère, Martin, et avec lui arrivèrent d’autres fioritures destinées à une tante et une grand-mère qui ne répondaient pas, parce que l’une était trop fière et l’autre ne savait pas écrire.
Ingrid entra dans la Salle Nord et décida d’y dormir, car il y avait une trappe dans le plancher qui donnait dans la cuisine, et permettait à la chaleur de monter. Elle secoua les couettes et prépara le lit, puis redescendit et but le café tiède tout en relisant la lettre de Barbro, qu’elle froissa et ajouta à la pile par terre.
Mais elle n’alluma pas le feu.
Elle alla dans la grande pièce pour charger le poêle et vit que la porte de la chambre du grand-père était entrouverte. Elle posa la main sur la poignée pour la fermer, mais elle avait déjà fermé cette porte il y a peu. Or elle était ouverte à nouveau, il n’y avait pas un bruit dans la maison, ni de courant d’air.
Elle entendit un bruit sec, très lointain, un coup de tonnerre prolongé dans les entrailles du monde, elle retourna à la cuisine, elle y resta, comme paralysée, bien trop longtemps, avant de ressortir et d’ouvrir brusquement la porte de la chambre, furieuse contre elle-même de ne pas l’avoir fait sur-le-champ, car la personne avait donc pu disparaître à nouveau.
Mais il n’y avait aucune odeur, ni de pas traînant, ni de murmures, ni de bruit de chat, juste le même sifflement atténué, à l’intérieur comme au-dehors. Elle décrocha la lampe du mur de la grande pièce, alla dans tous les coins, armée d’un marteau, et vérifia qu’il n’y avait personne, ni dans le lit ni sous celui-ci, ni dans le placard ni dans le coffre qu’elle ouvrit et referma avant de s’asseoir sur le couvercle, avec le silence sans fin qui lui sifflait si fort dans les oreilles qu’il lui fallut crier.
Puis le silence fut total.
Elle s’habilla et sortit dans la neige qui tombait doucement, resta plantée là à contempler les maisons, la grange, les quais et le hangar près de la mer, soudain étonnée par tout ce qui l’avait retenue sur l’île, ce qui, en vérité, n’était rien du tout. Bientôt, la neige allait se muer en pluie et, si le vent ne tournait pas, l’île allait être marron comme la gale, et la mer, grise.
Ingrid descendit au sud à travers les jardins, évitant les portes et escaladant les clôtures comme lorsqu’elle était enfant. Mais elle n’était pas une enfant. Elle continua jusqu’à la pointe sud et resta là à examiner longuement les restes du phare qu’elle et Barbro avaient fait sauter avec les derniers bâtons de dynamite de son père quand la guerre avait éclaté, morceaux de verre de couleurs claires et vives, algues et goémon comme autant de cheveux noirs enroulés autour de poutrelles rouillées et tordues, le réservoir de paraffine ressemblait à une rose calcinée. Elle s’assit sur le tronc d’arbre qu’ils avaient trouvé un jour sur le rivage, ils l’avaient immobilisé avec des pieux et des chevilles pour que la mer ne le leur reprenne pas, ce géant énorme et d’une blancheur de squelette, ils avaient cru qu’un jour peut-être il vaudrait une fortune, en trente ans, il avait fait office de banc pour des gens qui ne s’asseyaient jamais.
Et elle n’était plus une enfant.
Elle attendit jusqu’à se mettre à frissonner, remonta au nord en suivant les rochers à l’ouest, sans voir de traces et sans entendre autre chose que les lamentations désolées de la mer, passa le rocher avec le nouveau quai et les trois remises, il y en avait au moins une de trop ; elle se rendit compte que si elle avait réveillé Nelly ce matin, si elle s’était permis d’entendre une voix et de voir son sourire, elle aurait continué à l’usine, à ôter l’arête centrale de morues mortes, tandis que les pensées ne cessaient d’aller et venir dans son esprit.
[...]
3
Ingrid dîna, dormit et, à son réveil, elle n’avait toujours pas peur. Elle mangea lentement, s’habilla lentement, sortit dans la frêle lumière de novembre et mit la prame à l’eau. Le vent avait tourné une fois encore et soufflait du suroît. Elle contourna la pointe dans des creux de plusieurs mètres, continua vers le sud par la passe jusqu’au piton que Lars avait fixé, y attacha l’extrémité d’une ligne sans descendre du bateau – et sans le briser non plus « –, elle rama avec les vagues, traversa la passe jusqu’à Moltholmen, là où son cousin avait également fixé un piton et où il y avait un palan. Elle fit passer la ligne dans le trou de la poulie, là encore sans descendre du bateau – et sans le briser non plus « –, puis elle se dirigea vers Barrøy. Elle avait estimé qu’il devait y avoir quatre-vingts, quatre-vingt-dix brasses, il y en avait plutôt cent cinquante, la ligne était trop courte.
Elle se mit à pleurer, attacha un flotteur à l’extrémité de la ligne et le lâcha dans l’eau, elle rama avec la mer, repartit au nord jusqu’au nouveau quai, prit une ligne supplémentaire. La mer avait grossi. Elle ressortit en bataillant avec les avirons et retrouva le flotteur, rallongea la ligne et regagna le mouillage de Barrøy avec un bout de la ligne, trempée, brûlante, épuisée et furieuse, mais elle avait désormais une ligne à travers la passe et pouvait poser un filet ou deux, elle pouvait pêcher sans prendre le bateau, par tous les temps, jusqu’à l’arrivée des grosses gelées, peut-être même plus tard.
Elle se laissa dériver vers le nord, remonta le bateau, nota que la mer descendait, elle fut un instant stupéfaite car elle avait cru que la marée montait, mais elle n’avait toujours pas peur.
Elle gagna la maison, s’endormit sur la banquette à côté du poêle et se réveilla alors que la nuit était tombée. Elle avait froid, des courbatures, elle se leva et fit du feu, prépara à manger et se demanda si elle devait poser des filets dans l’obscurité, chassa cette idée et ouvrit un des cahiers qu’elle avait apportés, il n’y avait rien dedans.
Elle s’habilla, descendit à la nouvelle remise et prit deux filets, alla au mouillage de la passe sud et posa le premier dans la houle noire, le tirant comme une toile d’araignée silencieuse, elle accrocha le second et tira, une chaîne de deux filets ce n’est pas difficile à déplacer, elle les sortit de quinze brasses de plus, bloqua le tout et rentra.
Elle dormit longtemps et nue dans le lit de ses parents dans la Salle Nord, se leva un matin de plus, releva les filets et put faire cuire de la morue fraîche, elle ressortit et mit à l’eau un filet de plus. Trois. Elle pouvait aller jusqu’à quatre ou cinq. Il lui restait du poisson séché de l’hiver dernier, elle avait une resserre remplie de pommes de terre, elle avait du lieu séché et un demi-tonneau de harengs. Elle avait des confitures, de la farine, du café, de la mélasse, des pois cassés, du beurre du commerce et du sucre. Désormais, elle avait également du poisson frais. Le tas de papier journal n’était plus sur le plancher, mais rangé dans la caisse avec le bois pour allumer les feux sous le poêle. Deux avions apparurent dans un trou entre les nuages, elle entendit des tirs sur le Fort au nord de la Grande Île, et le trou se referma.
Le lendemain, elle prit huit morues et un lieu noir. Elle mangea encore du poisson frais, du foie et sala le reste, elle demeura dans la chaleur de sa cuisine, regarda autour d’elle, jusqu’à ce que l’envie d’aller dans le grenier de la grange où l’on conservait les sacs de duvet lui passe par la tête. Une étiquette était accrochée au premier sac, indiquant Barrøy, 1 kilo, 1939. Elle l’ouvrit et plongea la main dans un été. Elle le referma et ouvrit le deuxième. L’étiquette disait 1937. Encore un été. Elle se dit qu’elle devrait aller au village pour se procurer un chat.
Elle retourna à la maison, mit l’eau à chauffer, se lava et se frotta les ongles au point de presque les fendre, se lava les cheveux, elle les noua puis les laissa retomber le long du corps, l’eau chaude dégoulina sur son ventre, ses hanches et ses cuisses avant de se perdre dans la bassine. Elle s’habilla, s’assit à la table de cuisine et ouvrit le même cahier. Il n’y avait toujours rien dedans. Mais, au moins, elle pouvait dormir comme Nelly.
Elle se coucha et pensa au chat. Barbro allait venir bientôt. Elle pensa à Barbro. Et à Suzanne.
Suzanne avait été comme une fille pour Ingrid. Mais elle les avait quittés, elle et Barrøy, quand elle avait tout juste quatorze ans, et elle était partie de son plein gré.
Ingrid se leva, descendit dans la salle de séjour et trouva les lettres dans la commode que son père avait achetée un jour sur un coup de folie. L’écriture soignée de Suzanne, à la capitale, où elle avait commencé par être domestique chez une famille aisée, puis téléphoniste dans un central de taille substantielle au nom imposant. Ingrid lut lentement, se balançant au rythme des mots, elle acquiesça, hocha la tête et rangea les lettres ; elle revit Suzanne le jour où elle avait quitté l’île, vêtue des plus beaux habits qu’ils avaient réussi à lui trouver, tendue et bouillonnante, fragile comme du verre, elle n’était pas uniquement partie avec toute sa superbe, mais aussi avec toutes les économies de l’île, et ce n’était pas un beau spectacle.
[...]
4
Alors qu’Ingrid était sur l’île depuis longtemps, au point que l’idée même d’une horloge s’était envolée, un phoque se prit dans le filet le plus éloigné.
Elle le ramena à terre et constata qu’il était mort. C’était un petit phoque, peut-être un bébé. Elle le laissa là pour que les aigles de mer le mangent. Mais il avait détruit de grands bouts du matériel, qu’elle emporta avec elle afin de le réparer, puis elle aperçut un deuxième phoque, couché dans la neige, bougeant à peine les nageoires. Elle s’approcha. Il la regarda avec un œil noir et un œil blanc. Ils avaient déjà eu des phoques sur l’île, mais ils étaient craintifs et plongeaient dans l’eau dès que quelqu’un venait. Celui-ci semblait lent et malade, et n’était pas plus gros que le phoque mort.
Ingrid déposa le filet, prit une pierre et tua le phoque. Deux aigles s’envolèrent de Moltholmen et vinrent vers elle. Elle leva un bras, ils remontèrent en battant leurs ailes immenses et retournèrent sur l’îlot, se posèrent, donnant des coups de bec en la regardant. L’un avait une tête presque blanche, l’autre était plus marron et plus petit.
Ingrid se demanda si elle devait dépecer le phoque, mais elle ne savait pas comment faire, et son père avait dit qu’il fallait se méfier de la viande de phoque, il pouvait y avoir des trichines.
Elle voulut repartir, mais au moment où elle souleva le filet, elle aperçut un vêtement marron sous la neige, on aurait dit de la bure. Elle ramassa une veste élimée et une poignée de laine de bois s’en détacha. Un pantalon avec une demi-jambe était accroché à la veste par une ficelle. Elle n’avait jamais vu des habits pareils. Elle les emporta au séchoir à poissons, les suspendit comme de la lessive, alla à la remise et accrocha les filets entre les crochets, en ôta le goémon et les herbes, puis elle considéra qu’elle avait assez de filets pour laisser ceux-là à sécher, c’était plus facile de les raccommoder quand ils étaient secs.
Elle se demanda si elle devait poser d’autres filets, mais elle se dit qu’elle pouvait manger du poisson salé pendant quelques jours, et se dirigea vers la maison sous une neige légère. Il y avait désormais un homme là-bas, sur le séchoir, il la regardait, un unijambiste. Derrière lui, les deux aigles étaient en train de déchiqueter un des phoques. On aurait dit que l’homme les observait, eux aussi, il était impossible de dire de quel côté il regardait, il n’avait pas de tête.
Ingrid entra dans la maison, prépara le repas, mangea, récura le plancher de la cuisine, de l’appentis et du couloir, nettoya l’escalier qui montait à l’étage, elle trouva de la laine et ravauda le trou dans son pull, elle vit alors que le trou n’avait pas été fait par un clou à l’usine, mais par le couteau qui ressemblait à une petite hache. Demain, elle allait préparer du pain, des crêpes et des galettes de pommes de terre, ce serait un jour de cuisine, un jour où elle emplirait la maison d’odeurs de vie, et de travail d’une dureté étourdissante.
Elle alla à la grange, trouva un sac de laine et se mit à la nettoyer et à la carder. Elle apporta le rouet dans la cuisine et passa le reste de la journée à filer. Le rythme. Il n’y avait plus de gouttes de condensation sur les murs intérieurs. Cela ne sentait plus la terre humide. Elle avait cessé de faire du feu dans la grande pièce. Il y avait le calendrier suspendu à un clou de la salle à manger, le chat qu’elle aurait bientôt, la pendule dont elle n’avait plus besoin, le fil qui courait entre ses doigts rendus lisses par la lanoline, et, chaque fois qu’elle jetait un coup d’œil par la fenêtre, l’étranger sur le séchoir, là-bas, la regardait aussi.
[...]
5
Vivre sur une île, c’est chercher. Ingrid avait cherché depuis sa naissance, elle avait cherché des baies, des œufs, du duvet, du poisson, des moules, des plombs, des ardoises, des moutons, des fleurs, des planches, des ramilles… Les yeux d’un îlien cherchent, que sa main ou sa tête soit occupée, avec ces coups d’œil incessants sur les îles et la mer qui s’accrochent au moindre changement, qui notent le signe le plus insignifiant, qui voient le printemps avant qu’il n’arrive et la neige avant qu’elle ne peigne ses touches blanches dans les crevasses et les creux, ils découvrent les bêtes avant qu’elles ne meurent et les enfants avant qu’ils ne tombent, ils voient les poissons invisibles dans la mer sous les nuées d’ailes blanches, la vue est le cœur battant de celui qui vit sur une île.
Mais quand Ingrid sortit dans le matin et vit que le temps ne lui permettrait pas non plus d’aller au village ce jour-là, elle eut le sentiment de chercher quelque chose d’introuvable, et ce quels que soient ses efforts à scruter, cela ressemblait à l’impression de faire une erreur avant de la commettre ; et les mêmes nuages déchirés glissaient dans le ciel et lâchaient ici et là des grains obliques sur la mer infatigable, il n’y avait pas un soupçon de vie en vue.
Elle descendit par le sud vers les rives de l’est, elle ne trouva ni phoques ni vêtements, elle fut envahie par une inquiétude croissante qui lui ordonna de parler tout haut car, tôt ou tard, un homme doit entendre une voix, ne fût-ce que la sienne, tous les îliens le savent, alors elle dit qu’elle devait vraiment finir par se procurer ce chat, elle sursauta en entendant le bruit étranger, elle reprit sa phrase jusqu’à ce qu’elle en devienne banale et rassurante, mais une nouvelle crainte s’insinua en elle, le sentiment de s’être perdue sur sa propre île, ou de se trouver sur une autre île, ou pire encore : le sentiment de ne pas être seule sur cette île qui était la sienne.
Elle avait noté à quelle vitesse les aigles avaient dépecé les phoques, elle avait vu le sang dans la neige recouvert par une neige fraîche, et un souvenir ténu lui revint. Elle pressa l’allure, traversa une bande d’algues amoncelées, elle tomba sur d’autres vêtements, usés, marrons et mouillés, avec ces touffes de laine de bois semblables à la bourre d’une poupée, mais usés d’une manière différente, comme s’ils avaient appartenu à d’autres personnes, avec d’autres habitudes et d’autres existences. Elle les étendit sur la neige, trois tenues complètes, un caban et une veste, elle chercha à les réunir, tels qu’ils l’avaient été, elle obtint une grande personne et deux plus petites, et il lui resta un vêtement en trop, la moitié de quelqu’un, et c’étaient tous des hommes.
Elle les entassa dans le filet qu’elle portait toujours avec elle, dans l’intention de les brûler au nord de l’île. Mais ils étaient mouillés, et on ne pouvait pas non plus les enterrer dans le sol gelé, elle les accrocha donc à côté de l’homme déjà suspendu sur le séchoir, puis elle décida de refaire le tour complet de l’île.
Dans la crique où elle avait trouvé les premiers vêtements, elle aperçut à nouveau les aigles, le géant à la tête blanche et le plus petit, le marron, perchés sur un rocher dans la mer, battant des ailes, en train de donner des coups de bec et de griffes comme s’ils se disputaient une proie.
Mais il n’y avait pas de rocher à cet endroit, c’étaient des eaux dégagées dans tout le secteur, cent brasses de profondeur, et le rocher bougeait dans les vagues.
Elle courut sur la pointe, voulut faire demi-tour et chercher la longue-vue, mais elle trébucha sur une pierre et découvrit un autre rocher là où il ne devait pas y en avoir, un rocher qui se déplaçait lui aussi, qui disparaissait pour réapparaître comme un bois flottant, un dos de baleine. Et au-dessus d’eux volaient des nuées gloussantes d’oiseaux en furie, qui repliaient et dépliaient les ailes, plongeaient, piquaient et se battaient dans un tourbillon de plumes et de bruits, pour disparaître d’un coup dans une violente averse de neige.
Ingrid se mit la main sur les yeux et cria à haute voix. La nausée monta et son cœur s’emballa, elle fut obligée de se mettre à quatre pattes, le souffle coupé, car elle avait compris ce qu’elle venait de voir.
Elle se frotta le visage avec de la neige et courut vers la maison, elle trouva d’autres vêtements, deux tenues complètes et un pantalon, un manteau gris et abîmé… Elle les traîna avec elle à travers les jardins, les accrocha sur le séchoir, entra dans la maison et alluma toutes les lampes, y compris dans la grande pièce.
Elle alluma les deux poêles, resta debout dans ses affaires qui dégoulinaient, elle regarda fixement une armée sans tête, là-bas, sur le séchoir, qui lui faisait des signes dans un vent silencieux, l’un n’avait qu’une jambe, l’autre n’avait qu’un bras, un buste, deux vestes saluaient gaiement, il manquait aussi un bras à l’une d’elles… Elle se rendit compte qu’elle les avait ramassés car il s’agissait d’effets personnels, quand bien même ils étaient usés jusqu’à la corde et sans valeur, avec ces touffes de laine de bois.
Ingrid descendit à la remise des Suédois et prit la longue-vue, un lourd cylindre extensible recouvert d’une sorte de similicuir noir, avec des anneaux en cuivre et deux petites vis, elle se souvint vaguement que son père ne s’en servait jamais car elle faussait la vision, elle se dit qu’elle n’en avait pas besoin non plus, elle savait bien ce qu’elle avait vu.
Elle reposa la longue-vue comme si celle-ci lui brûlait les mains, elle ramenda deux filets secs jusqu’à avoir froid aux doigts, elle les tira derrière elle dans la neige, passa la ligne dans l’œillet du premier et vit le flotteur glisser dans les vagues, elle attacha les lests ronds en ardoise en veillant à ne pas les casser contre le rocher, attacha le filet suivant et tira les deux, les quinze brasses habituelles, quand son regard quitta la ligne, la mer et Moltholmen, et c’est là qu’elle vit le premier corps.
La ligne lui échappa des mains, elle se jeta à l’eau et la rattrapa, regagna la terre en pataugeant, posa les mains sur les genoux, redressa le dos, regarda fixement la passe, voyant toujours ce qu’elle avait vu, ce qu’elle avait déjà vu la veille – et malgré cela elle avait dormi comme Nelly.
Elle tapa dans ses mains avec ses moufles et vit l’homme qui gisait à moitié sur le rocher, les jambes baignant dans la mer, comme si quelqu’un l’avait amarré au piton.
Mais la mer descendait, et il serait bientôt au sec, jusqu’à ce que la prochaine marée haute ne l’emporte, et que les armées de harpies criardes ne piquent pour déchiqueter la silhouette marron.
Ingrid alla au nord vers le hangar à bateaux et se dit qu’elle s’était rendue deux fois dans la grange, une fois pour vérifier le duvet et une autre pour chercher de la laine ; là aussi, elle avait vu quelque chose sans comprendre ce que cela signifiait, et elle était sortie de la maison d’innombrables fois, mais elle n’était pas allée dans le jardin des baies, à l’arrière, on n’y allait jamais en hiver, car qui aurait l’idée de faire le tour de sa propre maison ?
Elle passa en courant à côté du séchoir à poissons, traversa la tourbière, hésita avant d’ouvrir la porte, elle entra et resta figée un instant dans sa propre maison, elle fila d’une pièce à l’autre avec le sang qui lui cognait dans les oreilles, elle s’immobilisa et ressortit en vitesse, fit le tour de la maison et aperçut les traces à peine visibles sous la neige fraîche, comme si quelqu’un avait traîné un sac à travers le jardin et sur la passerelle de la grange.
Elle monta et constata que les portes étaient fermées avec le verrou tiré à l’intérieur, elle fit le tour du bâtiment, entra dans l’étable, elle se rappela qu’elle avait vu des gouttes d’eau dans l’escalier et qu’elle s’était dit qu’elles provenaient d’une fuite dans le toit, elle grimpa dans le grenier à foin et, dans la faible lumière, elle distingua deux jambes qui dépassaient sous des vieilles peaux de mouton. Elle écarta les peaux et vit un homme entre deux âges, chauve, avec des poils de barbe bleu-noir dans un visage émacié et blanchâtre, un homme mort. Mais quelqu’un lui avait fermé les yeux et joint les mains sur sa poitrine, on aurait dit qu’il priait.
Extraits

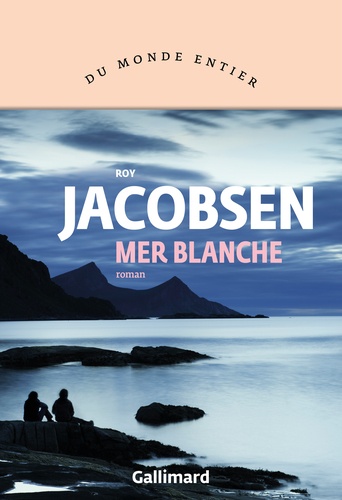




























Commenter ce livre