Prédatrice
Alissa Nutting
J’ai passé la nuit précédant mon premier jour d’enseignement à me masturber frénétiquement en silence de mon côté du lit, sans fermer l’œil un seul instant. Je m’étais couchée, en secret, avec une chemise en soie et une petite culotte en dentelle, sous mon peignoir, bien sûr, afin que mon mari, Ford, ne s’avise pas de me saccager. Il s’entête toujours à ruiner le paysage. Je trouve ça hilarant que, sur la seule base de notre apparence, les gens pensent que Ford et moi formons le couple idéal. À notre mariage, pendant son discours le frère de Ford, qui était son témoin, a dit : « Vous deux, on dirait que vous êtes les gagnants de la loterie génétique catégorie homme et femme. » La voix épaissie par une envie presque palpable, il a ajouté qu’on aurait dit que nos visages avaient été retouchés sur Photoshop. Après cette ultime réflexion, plutôt que de conclure par un toast comme d’usage, il a reposé le micro sur la table sans un mot et il est retourné s’asseoir. La nana avec qui il était venu avait un œil paresseux que nous avons tous poliment prétendu ne pas remarquer.
Je devrais trouver Ford séduisant jusqu’à l’absurde ; c’est ce que pense tout le monde. « Il est trop beau, a gémi l’une de mes camarades de sororité le soir qui a suivi notre première sortie à quatre avec Ford et un autre mec à la fac. À chaque fois que je le regarde, j’ai l’impression de prendre un grand coup de poing entre les jambes. » Mon vrai problème avec Ford, en fait, c’est son âge. Comme l’époux de la plupart des femmes qui se marient pour l’argent, Ford est bien trop vieux pour moi. Comme j’ai moi-même vingt-six ans, il est vrai que nous sommes dans la même catégorie. Mais trente et un ans, ça le place pas loin de dix-sept au-dessus de la tranche d’âge qui m’attire sexuellement.
Par certains côtés, la bague, à elle toute seule, justifiait presque d’épouser Ford – elle a ralenti le rythme auquel je me faisais draguer par des crétins au quotidien. Et, bien sûr, c’était une très belle bague. Ford est flic, mais ses parents sont pleins aux as. J’espérais que sa fortune me fournirait une distraction, mais il y avait un sacré revers à la médaille – elle ne me laissait aucun désir inassouvi, à part les désirs sexuels. Quelques semaines seulement après notre mariage, je sentais déjà ma libido affolée griffer le papier peint fleuri de notre belle maison de banlieue avec ses jolies barrières blanches. Au dîner, je me suis mise à croiser douloureusement les cuisses : si je les ouvrais même imperceptiblement, je craignais qu’elles ne lâchent une plainte stridente qui ferait éclater les verres en cristal. À mes yeux, cette crainte n’avait rien d’irrationnel. Le bourdonnement impérieux du désir était devenu si fort à l’intérieur de moi – son réseau électrique parcourait un circuit ininterrompu entre mes tempes, mes seins et mes cuisses – que la venue de l’instant où l’appel de la luxure serait capable d’actionner mes grandes lèvres comme le mannequin d’un ventriloque pour s’exprimer tout haut semblait inévitable.
Je n’arrivais pas à penser à autre chose qu’aux garçons à qui je ferais bientôt cours. À tort ou à raison, j’accuse ma toute première fois, à l’âge de quatorze ans dans le sous-sol d’Evan Keller, d’avoir gravé en moi un schéma d’excitation immuable – mon souvenir de l’événement se déroule toujours en Technicolor dans mon esprit. J’étais un peu plus grande qu’Evan, ce qui me donnait la sensation d’être une demi-déesse face à un simple mortel : à chaque fois qu’on se roulait une pelle, j’étais obligée de me pencher en avant pour cueillir ses lèvres. Comme il était plus petit, il est venu sur moi et il s’est déhanché avec la détermination athlétique d’un jockey de la Triple Couronne, jusqu’à ce que son corps soit trempé de sueur. Après, je suis allée aux toilettes et je l’ai appelé ; les yeux pleins d’une certaine curiosité mélancolique, comme subjugué devant un aquarium, il a regardé les vestiges de mon hymen flotter sur l’eau bleue de la cuvette des waters comme s’il s’agissait du dernier survivant d’une espèce autrefois répandue. Pour ma part, je ne ressentais qu’une seule émotion : je me sentais tellement vivante que c’en était grisant. J’avais l’impression que je venais de donner naissance au premier jour de ma vraie vie.
Lorsque Evan a eu une poussée de croissance, quelques mois plus tard, notre dynamique sexuelle a changé – je l’ai plaqué et je me suis lancée dans une série de rencards repoussants avec des garçons plus âgés pendant tout le lycée avant de réaliser que mes véritables désirs étaient restés bloqués plusieurs années en arrière. À la fac, je me suis plongée corps et âme dans les lettres classiques, trouvant un bref palliatif à ma frustration sexuelle dans les textes qui décrivaient les diligents carnages du temps jadis. Mais en licence, après avoir rencontré Ford, je m’étais réorientée vers l’enseignement et, à présent, j’étais enfin dotée d’un boulot qui allait m’autoriser à retourner en quatrième de façon permanente.
Non, il n’était pas question de laisser Ford fourrer les doigts dans le gâteau la veille du jour où mes années d’études et de remplacements allaient enfin payer. Ce soir-là, je m’étais donné un mal de chien pour me préparer à la perfection, intérieurement et extérieurement, comme un top model avant un défilé. Mes jambes, mes aisselles et mon pubis avaient été rasés et enduits de crème ; toutes les lotions que j’avais appliquées sentaient la fraise. Je voulais que mon corps évoque un fruit consommable à l’envi. Au lieu d’avoir le parfum d’une créature de près de trente ans d’âge, j’avais pour but que les organes glissants de mon sexe aient le goût du gel à raser rose presque transparent que j’avais appliqué dessus ; je voulais que mes tétons blond-roux exhalent le goût du gommage à la pêche. Dans l’espoir que le parfum imprègne ma peau, j’ai couvert mes deux seins d’une couche de masque hydratant que j’ai laissée poser dix minutes pendant que je me rasais ; elle a durci comme le glaçage d’une friandise, moulant mon excitation dans une carapace fine et friable. Après avoir rasé tous les poils de mon corps, je me suis émerveillée devant le lac de mousse et de poils qui s’attardait dans le lavabo. Ça m’a fait penser au punch à la crème glacée qu’on sert dans les bals de collégiens.
Imaginez un peu le pied que j’allais bientôt pouvoir prendre à jouer les chaperons dans ce genre de soirées ! Peut-être que j’aurais même la chance de valser avec un ou deux des élèves les plus entreprenants sous couvert de plaisanterie et de frivolité – les garçons prendraient ma main avec confiance et me guideraient au centre de la piste, ne réalisant qu’au moment où nos corps se serreraient l’un contre l’autre qu’ils pouvaient sentir le parfum de l’humidité palpitante, odorante, sous ma robe, à une simple couche de tissu d’eux. Je pourrais me presser subtilement contre eux, leur faire exploser tous les circuits par le trouble de mes rires insouciants et autres badineries susurrées à leur oreille par mes lèvres mouillées. Bien sûr, avant de le dire, je jetterais sur le côté un regard paresseux suggérant qu’il ne se passait rien, que je n’avais pas remarqué ma ceinture pelvienne qui frottait sur la bosse chaude à l’intérieur de leur pantalon de smoking de location. Il faudrait que ce soit un garçon modèle – le genre qui ne serait pas capable de répéter une phrase de ce genre à sa mère ou à son père, qui se demanderait s’il avait rêvé et ne se rappellerait cet instant que dans le sommeil profond et aviné de ses grands moments de solitude d’adulte : après un dîner de boulot, en voyage d’affaires dans un quelconque Comfort Inn du Midwest, après avoir appelé sa femme et ses enfants au téléphone et retiré la capsule de plastique de trois ou quatre petites bouteilles de bourbon raflées dans l’avion, réglé le réveil ; là, seulement, il s’autoriserait à s’asseoir bien droit dans son lit, une main serrant l’épaisseur croissante de son organe, et le souvenir le hanterait – avais-je vraiment dit ce qu’il croyait avoir entendu ? Dans l’enceinte du collège, en plus, au milieu des notes électroniques tonitruantes du tube de cette année-là, une chanson qu’il écoutait à son tout premier boulot au centre commercial, en pliant des chemises et en accueillant les mères et les enfants qui entraient dans le magasin – avais-je vraiment soufflé cette phrase à son oreille ? Mais je l’ai senti, se répéterait-il ; il avait senti mes mots se former dans l’air tiède, une phrase, un chuchotement qui s’était dissipé en quelques secondes, avant l’intervention de la raison ou de la mémoire. Pour le restant de ses jours, une partie de lui serait toujours sur cette piste de danse, incertaine et avide d’éclaircissements. À tel point qu’adulte, dans cet hôtel, il aurait sans doute été prêt à renoncer à beaucoup de choses en échange du sens de l’ordre que je lui avais dérobé, ou même pour entendre quelqu’un lui dire : Ça s’est vraiment passé. Et je saurais toujours, et il serait toujours persuadé, mais pas certain, que j’avais pressé la saillie de mon pelvis contre son gland, l’avais pressée là comme une photographie sous la couverture de plastique d’une page d’album, et que j’avais chuchoté la phrase : J’ai envie de sentir l’odeur de ton foutre dans ton pantalon.
L’heure matinale du début des cours à Jefferson Junior High était l’un des principaux attraits du boulot : 7 h 30. Les garçons seraient pratiquement endormis, leurs corps toujours à différents stades d’excitation nocturne persistante. De mon bureau, je serais aux premières loges pour surprendre leurs mains nues qui frotteraient leur pantalon sous les tables, leur honte, et leurs efforts surhumains pour reprendre le contrôle sur leur organe à demi bandé.
Autre bonus, j’ai réussi à obtenir une salle de classe hors de l’enceinte du bâtiment principal. C’étaient des espèces de mobile homes derrière le collège, mais les portes fermaient à clé et, surtout lorsque l’air conditionné bruyant fixé à la fenêtre était en marche, il était impossible de savoir ce qui se passait à l’intérieur. Lors de la réunion des profs du mois de juillet à la cafétéria, aucun enseignant n’a voulu se porter volontaire pour ces salles – cela signifiait plus de chemin chaque matin, l’obligation de retourner dans le bâtiment pour aller aux toilettes, de courir sous une pluie battante pour aller déverrouiller la porte. J’ai levé la main, jouant à l’élève modèle, et j’en ai demandé une. « Je suis au service du groupe », ai-je annoncé, avec un grand sourire plein de dents. Une rougeur subite a envahi le visage du principal adjoint, Rosen ; j’ai baissé le visage de façon que la trajectoire de mes yeux se porte, sans la moindre ambiguïté, vers son entrejambe, puis j’ai pressé les lèvres l’une contre l’autre, croisé son regard et fait un sourire entendu. Bien sûr, en entendant l’expression « au service du groupe », vous m’avez imaginée en pleine partouze, essayaient de lui dire mes yeux rassurants. Ce n’est pas votre faute.
« C’est très gentil, Celeste », a-t-il dit en hochant la tête ; il a essayé d’écrire quelque chose mais a fait tomber son stylo ; il l’a ramassé en s’éclaircissant nerveusement la gorge.
« C’est ce que je disais », est intervenue Janet Feinlog derrière moi. Janet, une prof d’histoire, était affligée d’une calvitie prématurée ; la teinture tie and dye foncée qu’elle infligeait artisanalement à ses mèches raréfiées ne servait qu’à produire un contraste encore plus marqué avec les plaques de peau blanche qui transparaissaient dessous. Comme la plupart des défauts physiques, celui-ci n’allait pas seul. Les bas de contention qu’elle portait donnaient à ses mollets et chevilles la texture ridée du carton ondulé. « Les classes devraient être attribuées en fonction de l’ancienneté.
– Je suis d’accord, ai-je dit. Je suis la petite nouvelle. Ce n’est que justice. » Puis j’ai gratifié Janet d’un sourire étudié qu’elle ne m’a pas rendu. Au lieu de quoi elle a sorti de son sac un mouchoir jauni et s’est mise à tousser dedans en me regardant, comme si je n’étais qu’un produit vénéneux de son imagination qui allait disparaître si seulement elle parvenait à expulser suffisamment de glaires de ses poumons.
Disposer d’une salle mobile signifiait que je pouvais vraiment me l’approprier. J’ai posé des rideaux opaques, apporté mon parfum préféré et les en ai aspergés, ainsi que le tissu de mon siège à roulettes. Bien que je ne sache pas encore lesquels des garçons de ma classe d’anglais de quatrième allaient être mes préférés, j’ai fait des suppositions à partir de la liste de noms et j’ai exécuté une petite cérémonie vaudoue ; j’ai remonté ma robe jusqu’à l’encrier transparent que j’avais entre les jambes, trempé le bout de mon doigt et écrit leurs noms sur les bureaux du premier rang, espérant que, par une opération magique, ils seraient attirés directement par ces places : leurs hormones liraient l’écriture invisible par leurs yeux. Je me suis caressée derrière le bureau jusqu’à être épuisée et le siège trempé. J’espérais que l’atmosphère serait saturée de phéromones qui informeraient les élèves concernés de ce que je n’avais pas le droit d’exprimer tout haut. J’ai enfourché le rebord du bureau et j’ai laissé mes grandes lèvres s’approcher dangereusement près du coin de bois coupant avant de me laisser glisser en avant et de m’asseoir. La nudité bouillante de mon entrejambe se pressait contre la couche de vernis froide. Ces angles. Si je ne faisais pas attention en me relevant, ils mordraient facilement dans la chair de ma cuisse.
Le bureau rectangulaire, qui était constitué d’une plaque de bois plein assez longue pour que je puisse m’y allonger, avait un côté un peu symbolique : entièrement lisse, mais avec quatre pointes de danger acéré – comme pour me rappeler de ne pas dépasser les bornes. Chaque fois que j’ai visité la classe dans les jours précédant la rentrée, je me suis couchée dessus, j’ai pressé ma colonne vertébrale en regardant fixement le revêtement inachevé du plafond, et j’ai ouvert et fermé alternativement les jambes ; je remuais comme pour faire un ange dans la neige. Lorsque je me rasseyais enfin, je me laissais volontairement glisser par un angle, de sorte que le coin de la table me morde légèrement le trou du cul. Ça me faisait une petite douleur à trimballer comme un lot de consolation en attendant le début des cours. Chaque fois que je coupais la clim vrombissante de la fenêtre et me préparais à partir, j’avais l’impression de débrancher le moteur qui alimentait mes fantasmes. Dans le silence qui suivait, la salle se reconfigurait : l’âcreté imaginée de la sueur pubescente était couverte par l’odeur des lambris en faux bois. La poussière de craie qui flottait à l’intérieur d’un rayon de soleil semblait stagnante, et on aurait dit que les particules étaient des insectes pétrifiés dans l’ambre de la lumière. Avec la clim allumée, ces poussières auraient été dans un mouvement frénétique, courant vers la bouche d’évacuation comme des cellules de peau égarées fouillant la salle en quête d’un nouvel hôte – avant de partir, je tirais toujours la langue dans ce miel de lumière et je faisais de petits cercles, espérant me sentir satisfaite d’avoir attrapé quelque chose dessus, même si c’était si petit que je ne pouvais le sentir.
À 5 heures, le matin de notre premier jour d’école, l’anticipation me rendait fébrile. Pendant que l’eau de la douche chauffait, j’ai posé un pied sur le lavabo pour regarder entre mes jambes et j’ai inspecté mon sexe jusqu’à ce que le miroir s’embrume et le censure à mes regards. Mes ongles, des carrés rouge cerise qui luisaient comme du vinyle, ont arraché un dernier aperçu à la condensation, cinq minces traits par lesquels je pouvais regarder comme à travers des persiennes ouvertes, et j’ai pu évaluer les dégâts que j’avais causés pendant ma nuit : mes parties génitales étaient bouffies et rouges. Largement écartées entre mes doigts, mes grandes lèvres ressemblaient à un cœur fendu en deux. Je me suis mise sur la pointe des pieds et j’ai surélevé mon pelvis pour mieux voir. C’était impossible de ne pas sentir une sourde panique devant les plis qui ne se fermaient sur rien d’autre qu’eux-mêmes – pas de fins doigts adolescents se tortillant comme des larves contre leur chair. J’ai essayé de trouver un peu de réconfort dans le jet d’eau tiède de la douche. Quand je pensais aux garçons que j’allais rencontrer dans quelques heures, le sirop fruité du gel douche dont je m’enduisais les seins semblait distiller un alcool enivrant. J’ai souri en les imaginant en train de respirer le parfum du shampooing à la pomme verte que j’appliquais sur mes cheveux blonds ; malgré l’amertume chimique que démentait leur mousse odorante, lorsqu’une mèche pleine de mousse a glissé sur mon visage, je n’ai pu m’empêcher de la prendre dans la bouche et de la sucer. Bientôt, j’ai été prise d’un tel vertige que j’ai dû m’agenouiller sur le sol de la douche ; maladroitement, j’ai décroché le pommeau de douche et l’ai guidé entre mes jambes, comme on mettrait un masque à oxygène tombé du plafond de l’avion à cause d’un terrible changement de pression dans la cabine, sans plus rien ressentir qu’une soif de survie pleine de terreur.
Un coup d’œil sur la chaîne météo m’a fait un pincement au cœur : on allait atteindre des records d’humidité. J’ai sursauté en imaginant mon maquillage filé et mes cheveux frisottés à la fin de la journée. J’ai poussé un juron ; Ford est sorti de la chambre avec une demi-érection et a lâché un énorme bâillement devant la fenêtre par laquelle on voyait le soleil se lever. « Bonne chance, chérie, a-t-il lancé. Quelle belle matinée ! » J’ai claqué la porte en sortant.
Comme on pouvait s’y attendre, la température dans la salle des profs était quasi insupportable. Nous nous étions rassemblés sur ordre du principal Deegan, qui s’est lancé sans attendre dans un discours de motivation plutôt tiède. Comme toutes ses allocutions, celle-ci reposait en grande partie sur le procédé rhétorique consistant à demander : « Pas vrai ? » à la fin de chaque phrase. « Zut ! a marmonné M. Sellers, le prof de chimie efflanqué qui s’éventait à côté de moi. Comme si les gamins n’avaient pas assez de munitions comme ça ! Va falloir que j’aille faire cours avec les aisselles trempées, en plus. » Janet ne cessait d’émettre des bruits de mastication ; j’ai cru qu’elle s’enfilait des poignées de granola, mais, au second coup d’œil, j’ai vu que c’étaient des cachets d’aspirine.
J’avais envie de quitter cette pièce en toute hâte pour rejoindre ma salle de classe ; les premiers élèves devaient déjà être en train d’arriver. J’éprouvais une vague brûlure à l’endroit où ma colonne vertébrale se reliait à mon cou et à ma tête ; tout mon corps se languissait de l’effluve des possibles. Je me sentais comme une fiancée optimiste au matin de son mariage arrangé ; j’étais possiblement sur le point de rencontrer quelqu’un qui allait me connaître dans toute mon intimité. « Ce ne sont pas des ennemis », a souligné Deegan ; les autres profs sont partis d’un petit rire lapidaire.
« Vous faites bien de le préciser », a aboyé Janet. Un élan de sympathie a fait partir le cou penché de M. Sellers dans une série de petits hochements de tête conciliants ; on aurait dit une vraie perruche.
Soudain, j’ai senti les yeux de Janet me clouer au mur. Le rire poli parcourant la salle s’était réduit à un faible bruit de fond entre les oreilles de Janet, et elle avait entendu mon silence en réaction à sa plaisanterie retentir comme un hurlement ; pire encore, elle avait surpris mon expression – un regard sarcastique de mépris indéniable. Ses années d’enseignement dans le secondaire l’avaient peut-être dotée de pouvoirs surnaturels quand il s’agissait de reconnaître qu’on se foutait de sa gueule. Quand j’ai vu son regard fixé sur moi, je me suis immédiatement fendue d’un grand sourire, mais elle ne me l’a pas rendu. « Vérifier que personne ne fume dans les toilettes, c’est indispensable et ça doit être systématique », a continué Deegan. J’ai regardé la pendule, feignant de réfléchir à ses mots. Au bout de trente secondes, j’ai de nouveau tourné les yeux. Janet me regardait toujours fixement. Lorsque la cloche a sonné, elle a encore fourré une poignée d’aspirine dans sa bouche, comme des cacahuètes, mais sans détourner les yeux.
« Allez, les étalons ! » a finalement lancé le principal Deegan, invoquant la mascotte du collège ; ses mots bien articulés brillaient de passion factice. Avec le bruit de centaines d’élèves qui débouchaient dans les couloirs juste derrière la porte, pendant un moment, on aurait dit que son appel avait conjuré une cavalcade de bétail. J’ai de nouveau tourné les yeux vers son visage souriant, à ses mains levées au-dessus de sa tête dans l’enthousiasme. « Allez, les étalons ! » Il a répété ces mots comme un pantin articulé.
J’ai été la première sortie de la salle. Dans le couloir, l’atmosphère s’était alourdie de l’âcreté de la sueur adolescente. De bruyants éclats de rire et cris stridents, comme ceux que déclenche un chatouillement intempestif, retentissaient dans toutes les directions. Je me suis dirigée vers la sortie ; des nuages d’eau de Cologne appliquée sans modération stagnaient parmi des bandes d’amis en pleine fanfaronnade ; les portes d’aluminium des casiers s’ouvraient et se refermaient avec des boums violents qui m’ont fait sursauter deux ou trois fois. Bien vite, la population du couloir s’est muée en une horde en mouvement. Une cadence compétitive s’est établie : les élèves se dirigeant vers les salles externes comme la mienne ont afflué vers la porte ; on aurait dit qu’un groupe de rock célèbre s’apprêtait à monter sur scène. J’ai profité de la cohue pour me coller contre le dos d’un garçon dont les chevilles portaient une marque de bronzage de chaussettes de sport – un membre de l’équipe de cross-country, sans doute. « Je suis désolée, ai-je chuchoté avec espoir à son oreille. On me pousse. » Était-ce le destin, était-ce le bon ? Mais le visage qu’il a retourné pour me saluer était couvert d’acné ; je me suis hâtée d’écarter ma poitrine de la chaleur de son dos.
J’ai eu un pincement au cœur en voyant deux filles un peu gourdes se prendre la main et courir vers la porte de ma classe. Sur le tableau de service, j’avais repéré que j’avais dix garçons pendant la première heure, douze filles – même s’il n’y avait aucun prétendant convenable dans cette première classe, il m’en restait quatre autres, et chacune apporterait d’autres possibilités. Cela n’était pas pour dire que ça allait être facile : mon partenaire idéal, je m’en rendais compte, devait rassembler un ensemble de caractéristiques très précis qui excluait d’emblée la plus grande partie de la population masculine du collège. Les poussées de croissance extrêmes ou une musculature trop prononcée représentaient un motif de disqualification immédiate. Il fallait qu’ils aient une assez belle peau, qu’ils soient assez minces et qu’ils soient habités de suffisamment de honte ou possédés de la discipline surnaturelle indispensable à garder un tel secret.
Il fallait forcer considérablement pour ouvrir la porte de ma salle – l’air froid de la clim produisait un effet de succion. À l’intérieur, il faisait sombre et froid. Deux garçons, type farceur, se tenaient devant la clim ; ils ont couru immédiatement à leur place avec un sourire, comme s’ils s’attendaient à une remontrance quelconque (« Vous savez que vous n’avez pas le droit de toucher à ça ! ») qui les distinguerait du lot et assiérait leur audace supérieure à celle de leurs camarades. Je n’ai pas bien vu leurs visages, mais, de ce que j’avais aperçu de leurs corps, je savais déjà que je n’étais pas intéressée : un mélange ingrat de traits pré- et postpuberté. La silhouette des biceps du premier se voyait à plusieurs mètres. Le second avait de viriles touffes de poils bouclés bruns sous les aisselles. Mais il y en avait d’autres.
Je suis allée me placer d’un pas résolu à côté de la clim et j’ai senti mes tétons se durcir et pointer sous mes vêtements. Pendant un instant, j’ai fermé les yeux. Je devais rester calme ; je devais regarder les élèves comme une exposition de fragiles œuvres d’art et rester en permanence à deux mètres, sans quoi je serais tentée de toucher.
« C’est vous, la prof ? » Cette voix également était masculine, mais un peu trop grave. Je me suis retournée, laissant la clim me rafraîchir la nuque.
« Oui. » J’ai souri. « Il fait une chaleur à crever, ici. » J’ai tripoté le crayon qui retenait mon chignon, mais, en jetant un regard circulaire sur la salle, j’ai vu qu’il était encore trop tôt pour lâcher mes cheveux – il n’était pas là, il n’était pas dans cette classe. Il y avait quand même de quoi se rincer l’œil. Pendant mon laïus inaugural, j’ai réussi à me contenir jusqu’à ce qu’un jeune homme du deuxième rang, croyant que personne ne le regardait, se mette la main entre les jambes. Il a passé un bon moment à se rajuster les parties. À ce spectacle, mes poumons et ma poitrine se sont serrés brusquement ; je me suis agrippée au rebord de mon bureau et j’ai fait de mon mieux pour articuler encore quelques mots sans ressembler à une asthmatique en fin de course. « Présentez-vous, suis-je parvenue à dire, faites le tour de la classe. Racontez vos hobbies, vos peurs les plus secrètes et les plus profondes, ce que vous voulez. » Mais, tandis que mon excitation redescendait peu à peu à un niveau contrôlable, un autre genre de panique s’est emparé de moi. Tous les garçons attirants de ma classe semblaient inutilisables – trop fanfarons, trop sûrs d’eux.
À la fin de la deuxième heure, quand il est devenu clair que cette classe non plus n’avait pas de gagnant, j’ai commencé à me demander si je ne ferais pas mieux de m’éclipser carrément pendant la pause déjeuner. M’étais-je juste jetée plus avant dans la torture sans espoir de délivrance ? À présent, j’allais devoir communiquer avec eux, les voir quotidiennement, et aucun ne semblait assez prometteur pour tenter quelque chose. Peut-être que je ferais mieux de passer l’automne sur des remplacements et de tenter ma chance ailleurs au printemps. « Mais on n’a pas de devoirs ? » a demandé une élève quand la cloche a sonné. À cause de la petitesse de ses yeux et de son nez, à cause de son teint cireux, on ne voyait que son appareil dentaire. J’ai eu envie de la coller de force devant un miroir et de demander au reflet : Non, mais ça existe, des visages pareils ?
« Pourquoi cette question ? ai-je répondu. Tu veux des devoirs, c’est ça ? » Elle m’a jeté un regard impuissant ; je venais de lui cracher du sang au visage dans un bassin de requins. Les autres élèves se sont mis aussitôt à lui lancer des insultes pendant la sortie collective de la classe, et ça m’a plu. Je savais que je trouverais difficile de passer quoi que ce soit aux filles de mes classes, connaissant la générosité dont la nature avait déjà fait preuve à leur égard. Elles étaient à l’aube de leur vie sexuelle et n’avaient pas besoin de se presser – dès qu’elles seraient prêtes, une grande quantité d’attractions les attendraient, faciles et jetables. Leurs besoins grandiraient à leurs côtés, telle une ombre. Elles n’auraient jamais le sentiment que leur libido était un monstre dévoyé qu’il convenait de garder enchaîné dans le grenier de leur esprit et de ne nourrir qu’en secret, à la nuit tombée.
Finalement, un dernier groupe de trois garçons est passé devant mon bureau en échangeant chuchotements et rires.
« À demain, tout le monde », j’ai dit. Cette adresse directe a donné au plus grande gueule des trois le brin de courage qui lui manquait.
« Kyle vous trouve sexy », a-t-il lâché à toute vitesse, des mots suivis immédiatement par un rire tandis que Kyle le poussait avec agressivité. Lui-même n’est parvenu qu’à proférer un « Ta gueule » qui sonnait comme un aveu bourru. Physiquement, il aurait pu convenir – il n’était pas encore trop grand, il n’avait pas les muscles trop épais – mais il avait beaucoup trop confiance en lui et il était trop entreprenant ; il n’était pas question d’aller avec les garçons les plus motivés. Ils seraient aussi les plus motivés à parler.
Les minutes précédant la troisième heure, chaque fois que la porte s’ouvrait, le bruit et la lumière de l’extérieur inondaient la salle, et l’anticipation me bloquait l’œsophage. Comme ils arrivaient de dehors, où la lumière était si vive, en entrant dans la pénombre de la salle, leurs corps étaient éclairés par-derrière, leurs visages étaient indistincts et leurs silhouettes semblaient tellement angéliques – la moindre mèche de cheveux était illuminée – qu’on aurait cru chaque fois qu’ils sortaient tout droit d’un rêve. Mais lorsqu’ils apparaissaient en pleine lumière, la plupart étaient décevants. Je n’ai même pas repéré l’entrée de Jack ; une affreuse créature au menton et aux pieds éléphantesques par rapport au reste de son corps s’était approchée de mon bureau pour me parler de ses lectures de l’été. Mais je l’ai vu peu après la sonnerie. Il était déjà assis. On aurait dit un garçon plus jeune dont on aurait étiré les membres – des cheveux clairs qui lui arrivaient au menton, des traits peu définis et une bouche diaboliquement pleine. Il regardait dans ma direction, mais à la dérobée. De temps à autre, un ami lui chuchotait une remarque quelconque et il tournait la tête et acquiesçait ou riait. Mais juste après, il jetait de nouveau un regard timide vers l’avant. Il y avait une politesse hésitante dans ses gestes ; il a fait mine de prendre un cahier dans son sac, s’est ravisé, a regardé autour de lui pour voir si les autres avaient sorti le leur, et là, seulement, s’est penché en avant pour défaire la fermeture de son sac à dos. Je pouvais l’imaginer s’interrompre avec la même réserve en descendant la fermeture Éclair de ma jupe, ramenant fréquemment ses yeux marron alertes vers mon visage, à l’affût d’une expression contradictoire qui indiquerait qu’il devait s’arrêter ; il me faudrait alors l’encourager, dire : « Tout va bien, continue ce que tu es en train de faire. »
Je me suis rendu compte avec un peu de gêne que c’était la première fois de la journée que je prenais la peine de faire l’appel. Soudain, j’étais sincèrement curieuse de l’identité de quelqu’un. Son nom était ordinaire, mais singulier – deux prénoms.
« Jack Patrick ? »
Il a fait un sourire timide, plus d’assurance polie que de prétention. « Ici », a-t-il dit.
Rapunzel, Rapunzel, ai-je pensé. J’ai porté la main à ma nuque, libéré mes cheveux et pris la mine de plomb du crayon dans la bouche.
Lorsque je suis sortie après ma dernière heure de cours, le soleil sans fard de l’après-midi était aveuglant. L’atmosphère de chahut de la fin de journée donnait aux murs de brique impavides et à tous les marqueurs fallacieux de l’ordre imposé du collège – la géométrie parfaite du paysage, les demi-cercles de copeaux de bois impeccables bordés de haies vertes et de palmiers – l’air de reliques d’une civilisation récemment envahie et engloutie. Les jeunes qui rentraient chez eux poussaient des cris farouches et se dépassaient en courant comme des fauves en liberté, se hâtant tous ensemble vers quelque invisible carcasse de gros gibier tombé juste à l’extérieur des limites de l’école. J’ai remonté l’allée de béton blanchi qui servait de cordon ombilical à l’école en clignant des yeux ; le revêtement contenait une roche minéralisée qui la faisait luire au soleil. Une pile de chemises en kraft contre la poitrine – des fiches d’informations sur les élèves, parmi lesquelles les numéros d’urgence de Jack –, j’ai plissé les yeux sous le coup de la luminosité du sol réfléchissant et traîné des pieds sur sa surface granuleuse. Je me serais crue dans un rêve éveillé : je me rendais à ma voiture par une piste de sucre phosphorescent.
« Les étés sont de plus en plus courts », a lancé une voix de gorge.
Je n’avais pas plus tôt entendu ces mots que j’ai senti une odeur de cigarette. Je me suis retournée et j’ai porté les doigts de ma main droite à mon front, moitié visière, moitié salut. Dans le parking des enseignants, Janet Feinlog était assise sur le marchepied de son van bleu. Elle regardait droit devant elle ; un petit mégot allumé servait de pont défiant la gravité entre ses doigts et cinq centimètres de cendre en suspension. Ne sachant pas très bien si elle s’adressait à moi ou à elle-même, j’ai appuyé sur la télécommande de ma clé et désactivé l’alarme de ma voiture avec un bip prononcé.
« Vous savez ce que je donnerais pour une semaine d’été en plus ? » a-t-elle demandé. Le tremblement dans sa voix révélait un conflit intérieur en acte : j’ai imaginé tous ses organes rebondir pour essayer de contenir la rage inassouvie qui couvait sous son ventre distendu. L’acier de sa colère avait été aiguisé contre la pierre de décennies sans joie. Elle a toussé, lâchant un pet bas et rond qu’elle a fait mine de ne pas remarquer. « Juste une semaine de plus sans voir d’ados, c’est tout. » Même si le reste de son corps est demeuré voûté de la même manière, j’ai vu ses deux iris se tourner dans ma direction : deux éclaireurs envoyés pour estimer si ça valait le coup de faire l’effort suprême de tourner la tête. J’ai eu pitié des jeunes garçons que le destin avait mis dans sa classe. Je ne m’imaginais pas, à l’âge de comprendre la différence du corps féminin, devoir faire entrer Janet Feinlog dans le moule.
À l’instant où j’ai laissé échapper un rire nerveux, le lombric de cendre est tombé de sa cigarette. « Vous aurez peut-être un meilleur groupe cette année ? » ai-je demandé. L’idée que ses classes devaient être pleines à ras bords de jeunes hommes puérils et timides était insupportable. Pendant sa carrière, combien de spécimens parfaits avaient dû passer par sa salle à son insu ? Ses oreilles sexuellement sourdes n’auraient su faire la différence entre les footballeurs au physique d’ogre et les gringalets à l’ossature délicate. À en juger par ses lunettes, elle était tellement aveugle qu’elle ne remarquerait sans doute même pas si on remplaçait tous ses élèves par des mannequins de cire, si ce n’est pour se faire la réflexion que leur comportement s’était amélioré.
Lorsque sa tête a pivoté vers moi, c’est tout juste si je n’ai pas entendu les craquements d’un rocher qu’on n’a pas remué depuis longtemps. Ses yeux asymétriques se sont posés sur mon corps comme des lasers, dans une évaluation qui a débuté par mes pieds. Ce diagnostic a continué si lentement, avec une telle rigueur méthodique, que ma peau a commencé à me démanger.
« Vous avez quel âge, au juste ? » a-t-elle finalement croassé. Je ne cessais de tourner inconsciemment la tête vers la file de bus pleins à craquer ; il était difficile de ne pas entendre les cris excités, juvéniles des élèves comme une invitation à les rejoindre. Elle a tiré une longue bouffée de sa cigarette et recraché plus de fumée que je ne l’aurais cru possible ; le nuage s’est amoncelé autour d’elle avant de dériver le long du flanc du van, comme sorti du pot d’échappement. « Vous n’avez pas encore donné la vie, ça se voit.
– Non. » J’ai souri, avec peut-être trop d’orgueil. « Je ne crois pas que ce soit mon chemin de vie.
– Vous êtes en âge de boire ?
– Bien sûr. » Je me suis éclairci la gorge. « J’ai vingt-six ans. »
Elle a hoché la tête.
« C’est la meilleure façon de tenir toute l’année. »
Janet s’est levée et a opéré une longue circonvolution à cent quatre-vingts degrés pour entrer dans son véhicule avec les pas chancelants d’un blaireau somnambule. Ses avant-bras sans force se dressaient souvent pour repousser des obstacles invisibles, battant l’air avec un brusque mécontentement. Avant d’entamer l’ascension des deux marches moquettées du van, la portion la plus sportive de ses adieux, elle a négligemment balancé son mégot sans l’éteindre. J’ai eu l’impression qu’elle espérait qu’il roule sous le réservoir de sa voiture afin de lui offrir un véritable enterrement viking.
Elle a lâché le long grognement d’une femelle morse encombrée d’une portée de petits arrivant par le siège, a monté une marche et, tout à coup, a lancé : « Hé ! » J’aurais cru qu’elle gueulait à l’intention de quelqu’un à l’intérieur, car je ne voyais plus son visage ; peut-être y avait-il un intrus. Espérant que ce soit le cas et que quelque chose soit venu la distraire, je me suis dirigée vers ma voiture avec une bouffée d’adrénaline, mais je n’ai pas réussi à atteindre la portière suffisamment vite. « Pourquoi vous enseignez au collège, d’abord ? »
J’ai regardé par-dessus mon épaule. La portière du van était toujours ouverte, mais Janet s’était installée à la barre, derrière le volant. Elle m’observait à travers le pare-brise. De toute évidence, si je ne donnais pas la bonne réponse, le moteur du van allait immédiatement s’enclencher et son pied, présentement posé sur l’accélérateur, s’écraser au plancher.
La question était raisonnablement facile à éviter – il me suffisait de dire : « Je veux juste essayer de changer les choses à mon niveau », ou : « C’est tellement formidable de voir un enfant apprendre, de le regarder dans les yeux au moment où l’ampoule s’allume », mais ces réponses stéréotypées ne risquaient pas de calmer Janet ou d’apaiser ses soupçons. En revanche, elle pouvait me transformer en victime de délit de fuite en un clin d’œil.
J’ai haussé les épaules et regardé la route principale derrière nous pour voir s’il y avait des voitures. y aurait-il des témoins lorsque le bas de son silencieux d’échappement rouillé allait me scalper de mon bouquet de cheveux blonds ?
« Les vacances d’été, tout ça », ai-je dit, tentant de paraître désinvolte. La chaleur émanant de l’asphalte du parking irradiait autour de nous comme un champ de blé frissonnant à hauteur de mollets. Comme ce serait affreux si, au lieu de me tuer, son van se contentait de me projeter la tête la première dans le goudron, balafrant ma peau à jamais d’une série de brûlures au troisième degré ! J’ai relevé les yeux mais elle n’était plus derrière le pare-brise. En me mettant sur la pointe des pieds, j’ai vu qu’elle avait incliné son siège en position allongée.
« Moi aussi », a-t-elle beuglé. La transpiration gondolait le papier kraft entre mes doigts ; j’ai commencé à m’éventer le visage et la poitrine avec les chemises. « Ça a l’air super, comme ça, hein ? a-t-elle continué. Travailler neuf mois, se la couler douce pendant les trois mois restants. Ce qu’on ne nous dit pas, c’est qu’on passe tout l’été à attendre que le marteau nous retombe sur la gueule en août. Vous avez lu le conte Le Puits et le Pendule ? Moi non plus, mais j’en parle tous les ans dans le cours sur l’Inquisition espagnole. Voilà où j’en suis. Allongée sur le dos, avec la perspective d’une nouvelle année d’enseignement. » J’ai visualisé Janet dans son lit, sa mince lèvre supérieure agitée d’un soubresaut tandis qu’elle voyait une lame métaphorique à quelques centimètres au-dessus de son visage et sentait la puanteur imaginaire du métal.
Mon téléphone s’est réveillé : un rappel à l’ordre de Ford. Cadeau pour toi à la maison ! annonçait-il. Je suppose qu’il sentait que mes attentions feintes s’évanouissaient maintenant que le boulot commençait pour de bon ; il crevait de trouille d’être laissé pour compte.
« C’était très sympa de bavarder, j’ai lancé à Janet. Faut que je rentre, le devoir m’appelle. » J’ai attendu quelques secondes un au revoir du van bleu, mais rien n’est venu.
J’ai baissé la capote de la voiture et me suis assise sur la pile de chemises pour ne pas qu’elles s’envolent. Ma sortie de parking a été un peu plus bruyante et spectaculaire que je ne l’aurais souhaité, mais tant pis ; il fallait que je relâche un peu de pression avant de retrouver Ford. J’ai remonté, comme ivre, l’allée en demi-cercle prévue pour que les parents déposent et viennent chercher les élèves, et j’ai mordu un trottoir et une haie en contournant la voie d’entrée avec son énorme panneau : une horloge et un thermomètre numériques servaient de sous-texte à un fronton déroulant exposant les exigences en matière de vaccination ; à côté, il y avait une grande image d’un étalon, la mascotte de l’école, caracolant sur ses pattes arrière. « L’ÉTALON AU POUVOIR ! » déclarait la légende. J’ai fait vrombir le moteur, mais j’ai eu du mal à déguerpir. Mes yeux ne cessaient de revenir au rétroviseur, espérant que la silhouette de Jack Patrick se matérialise au milieu de la route. J’ai vérifié plusieurs fois qu’il n’était pas, comme par magie, en train de courir après ma voiture en me faisant des grands signes, inexplicablement pieds nus avec la braguette de son jean ouverte, appelant mon prénom dans un gémissement désespéré.
Ce soir-là, Ford a installé mon cadeau à la table du dîner, sur sa propre chaise, comme si un invité qui le portait pendant le repas avait spontanément disparu : un épais gilet pare-balles.
« C’est énorme », ai-je dit. Ford a esquissé un sourire d’orgueil maladroit, imaginant que je mettais dans ces mots une espèce de compliment viril.
« Kevlar. » Il a mastiqué : on aurait dit que ce mot était un jugement sur la texture de sa côtelette de porc. « Magnifique protection. Intérieur renforcé. Un petit branleur te braque un flingue dans le dos et menace de te tuer si tu ne lui mets pas un A ? Tu peux lui dire d’appuyer sur la gâchette jusqu’à s’en faire péter le doigt. Tu n’auras même pas un bleu.
– Une sacrée tranquillité d’esprit. »
Ma séance de la veille sur le bureau m’avait-elle fait un bleu sur les fesses ? J’ai passé un doigt sous la nappe pour inspecter ma chair tendre. Le gilet allait transformer mon corps en cylindre asexué et m’ajouter sept kilos. Je voulais bien porter ce gilet devant les élèves, mais à une seule condition : complètement nue dessous, avec des bottes cavalières et une cravache en cuir pour accessoiriser le tout. J’ai commencé à m’imaginer présenter mes jambes nues aux garçons en frottant la chair sous mon coccyx.
Ford a surpris ma satisfaction et m’a fait un clin d’œil, mastiquant sa viande avec ses mâchoires larges et battantes qui lui mangeaient le visage. Il avait les yeux vitreux, légèrement couleur oignon jaune ; il avait bu du vin. La pensée de sa langue laissant une pellicule aigre sur ma peau a suffi à me pousser à me lever pour intervenir. « Laisse-moi rafraîchir ça pour toi », ai-je dit avec un sourire, m’emparant de son verre vide. Je gardais un assortiment de cachets de Stilnox préécrasés dans des sachets de thé vidés au fond du garde-manger, où il ne risquait pas de regarder. Ford abhorrait le thé : c’était antiaméricain.
« Merci, chérie. » Il a pris une longue gorgée qui a laissé une ombre violette sur ses dents et parlé flingues pendant un moment. « Encore une grosse journée demain, hein ? » a-t-il accordé finalement. Je l’ai guidé vers le lit, telle la gardienne d’un ours anesthésié dans un zoo. Grâce à son inconscience, j’ai pu m’offrir le luxe de regarder une vidéo d’un boys band sur la télé de la chambre avec mon vibro rugissant comme un hors-bord, réglé au maximum.
La bouche de tous les jeunes chanteurs s’ouvrait sur un large O réceptif tandis qu’ils harmonisaient. À cause des lubrifiants huileux de la machinerie de la puberté, leur peau semblait presque mouillée sous les éclairages. C’est leur torse plat et carré qui m’a fait accélérer le tempo de mon poignet, la légèreté dingue de leur frange renvoyée sur le côté, juste un peu trop longue, qui leur retombait dans les yeux. Pour bien regarder la caméra, les ados devaient ramener leurs franges en arrière en passant leurs doigts dans leurs cheveux pendant un gros plan ; quand ils le faisaient, plusieurs rigoles de front luisant étaient exposées. Ces aperçus de chair auparavant cachée ne duraient qu’une seconde, mais me faisaient battre le cœur aussi vite que s’ils avaient baissé collectivement leur pantalon.
Ma concentration a été distraite un instant lorsque Ford a émis un gargouillis à basse fréquence. La lueur de la télé lui donnait l’air d’un cadavre bleui, et la pellicule blanche de bave aux coins de sa bouche luisait comme un poison givré.
L’idée de Ford mort ne m’excitait pas nécessairement, mais celle de jeunes éphèbes espiègles chantant autour de son cadavre, retirant leurs tee-shirts colorés et les agitant au-dessus de leur tête en célébration, comme si sa mort était une victoire en sport et une étape cruciale dans leur conquête d’un championnat de division lycéen – il y avait quelque chose de plus que réconfortant dans cette image. Cela tenait du mythe grec. J’ai commencé à fantasmer que les garçons à la télévision étaient des têtards qui avaient grandi dans le ventre de Ford jusqu’au jour où ils étaient assez grands et forts pour s’en arracher dans une naissance collective violente. C’était presque assez pour me faire ressentir une sympathie hypothétique pour Ford. Si son corps, déchiré en deux, était effectivement un cocon qui avait incubé quatre adorables jeunes hommes, je l’embrasserais sur la joue en toute sincérité. Merci, Ford. Mais je n’aurais guère le temps de m’attarder. Ces nouveaux adolescents, collants de leur séjour à l’intérieur de lui, auraient besoin que je leur donne une douche peu après leur arrivée. J’ai toujours soupçonné que les entrailles de Ford sentaient la moquette bon marché : une odeur chimique persistante qui voudrait faire neuf mais n’arrive qu’à signaler son omniprésence. Une odeur qui disait : « Je n’ai absolument rien de rare. Il y a assez de rouleaux de moi à l’entrepôt pour recouvrir la planète. »
Mon orgasme est arrivé pendant le dernier couplet, tandis que les quatre garçons se lançaient ensemble dans une démonstration de spontanéité minutieusement orchestrée : ils pataugeaient dans l’océan en s’éclaboussant d’un air mutin. Un des garçons recevait une poignée d’eau salée en plein visage et montrait les dents, feignant d’être outré : il ripostait par un baptême, poussant son assaillant sur ses fesses dans l’eau. Ses deux autres amis l’aidaient à se relever en le prenant chacun par un bras. Ses minuscules tétons, sous l’effet de la chair de poule, pointaient sous le tissu mouillé de sa chemise. Il était intégralement trempé, à part ses cheveux. Je me suis imaginée m’approcher de lui et soulever sa frange une fois de plus pour lui lécher le front. Il aurait sans doute le même goût que la sueur sur ses cuisses, la saveur piquante de l’humidité dans son caleçon après qu’il a couru des kilomètres sur la plage ensoleillée.
Extraits

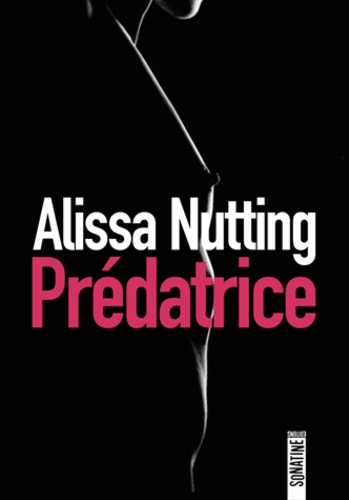



























Commenter ce livre