rançon
Extraits

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè
Les Écorcheurs - Violence et pillage au moyen Age, 1435-1445. Guerre et pillage à la fin du Moyen Âge
10/2023
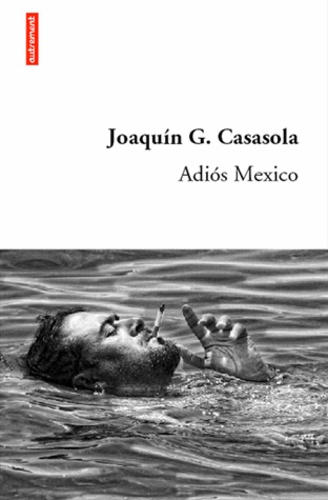
Littérature étrangère
Adios mexico
10/2012
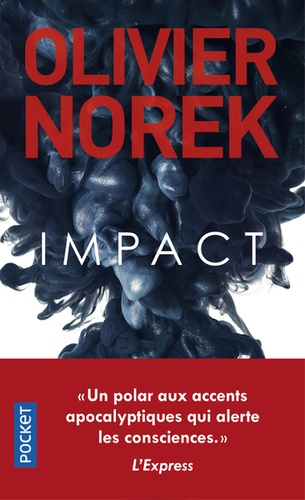
Romans noirs
Impact
10/2021
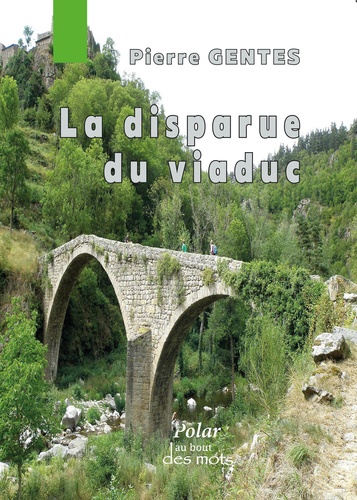
Littérature française
La disparue du viaduc
09/2023
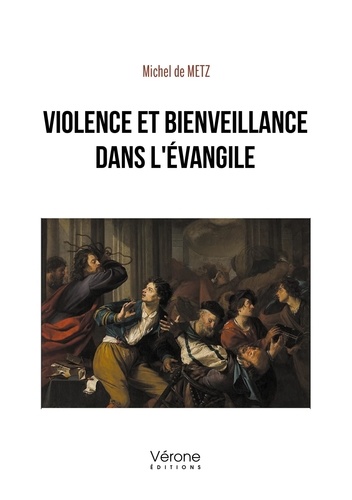
Exégèse
Violence et bienveillance dans l'Évangile
10/2022
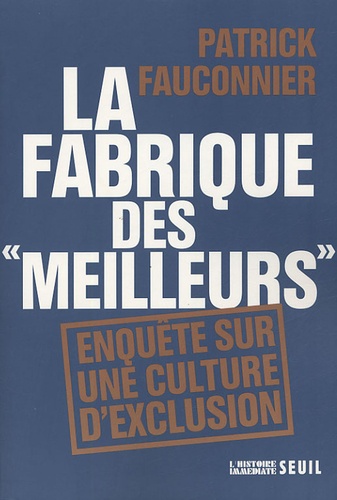
Sociologie
La fabrique des "meilleurs". Enquête sur une culture d'exclusion
04/2005

Beaux arts
Le surréalisme et la peinture
01/2002
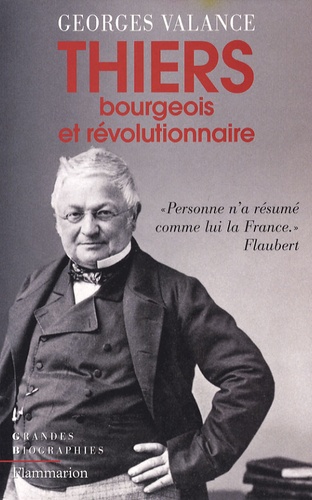
Histoire de France
Thiers. Bourgeois et révolutionnaire
10/2007

Contes et nouvelles
Des fraises au balcon. Histoires de vieillir et d'en sourire
03/2023
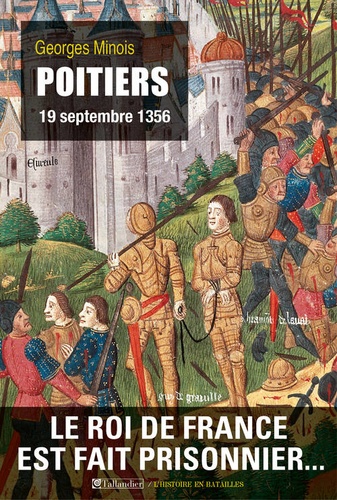
Histoire de France
Poitiers, 19 septembre 1356
02/2014
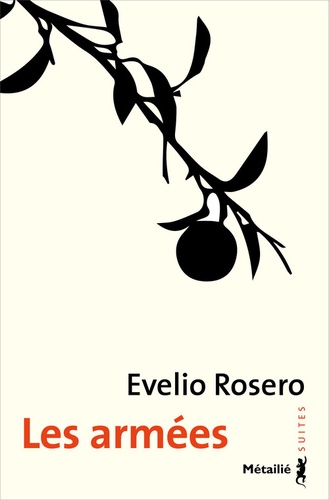
Poches Littérature internation
Les armées
01/2016
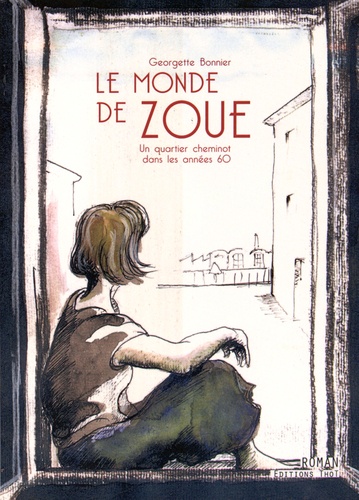
Littérature française
Le monde de Zoue. Un quartier cheminot dans les années 60
03/2016
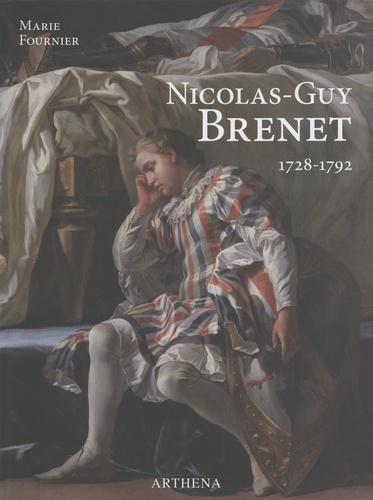
XVIIe - XVIIIe siècle
Nicolas-Guy Brenet (1728-1792)
05/2023
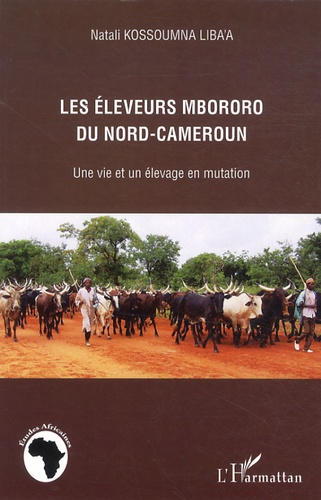
Ethnologie
Les éleveurs mbororo du Nord-Cameroun. Une vie et un élevage en mutation
12/2012
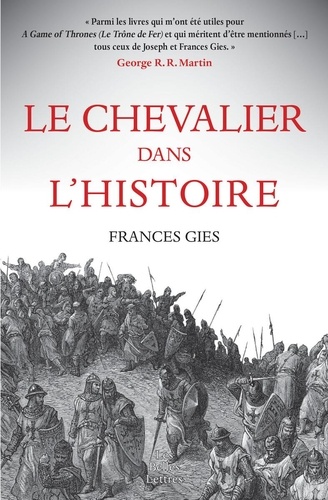
Histoire internationale
Le Chevalier dans l'Histoire
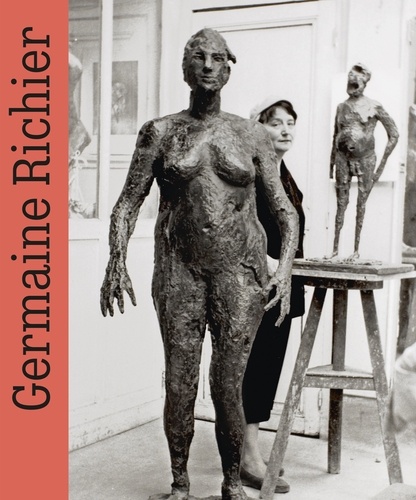
Sculpteurs
Germaine Richier
02/2023
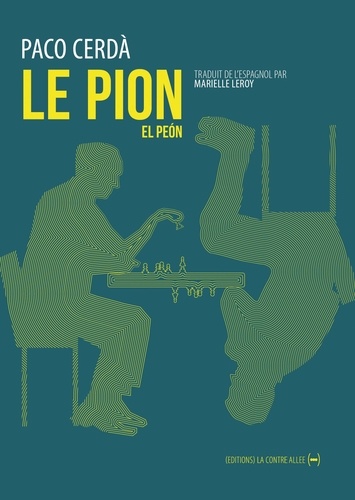
Littérature Espagnole
Le pion
09/2023
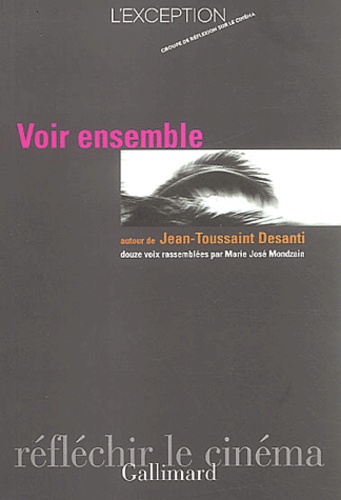
Cinéma
Voir ensemble
10/2003
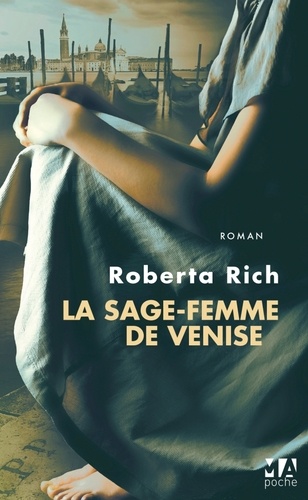
Romans historiques (poches)
La sage-femme de Venise
06/2013
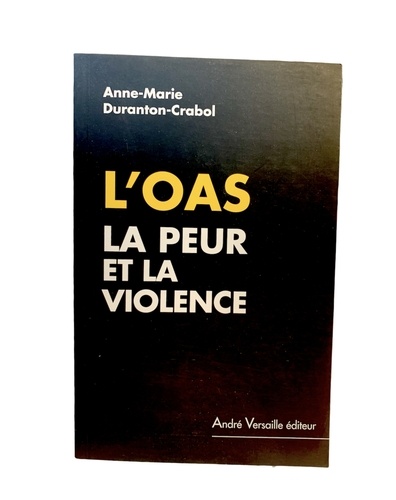
Histoire de France
L'OAS. La peur et la violence
02/2012
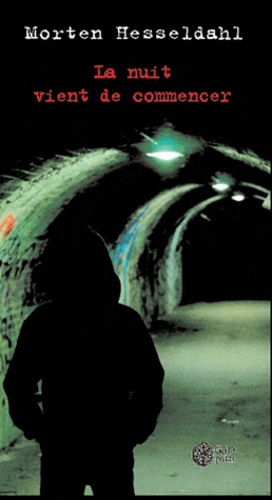
Policiers
La nuit vient de commencer
04/2011

Sciences historiques
Le Castellet. Mémoires d'un village perché
03/2004
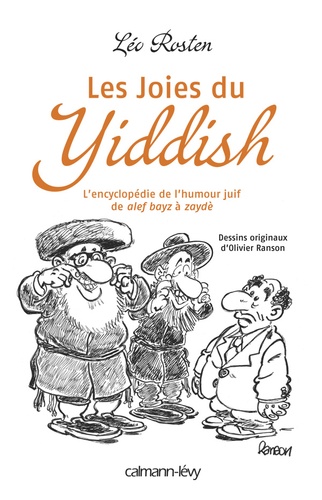
Humour
Les joies du yiddish
10/2011
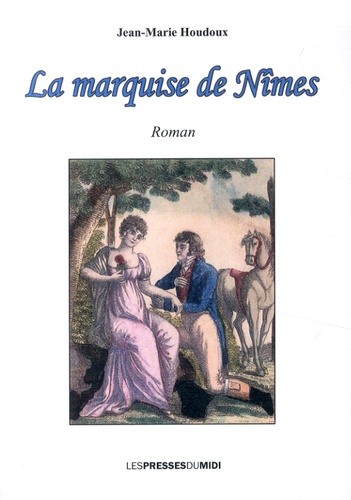
Romans historiques
La marquise de Nîmes
05/2014
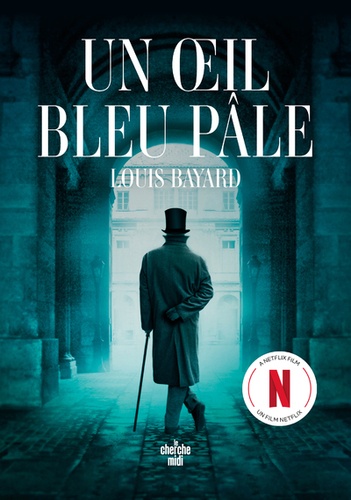
Romans policiers
Un oeil bleu pâle (NE)
01/2023

Historique
Le premier Dumas Tome 1 : Le Dragon noir
09/2022
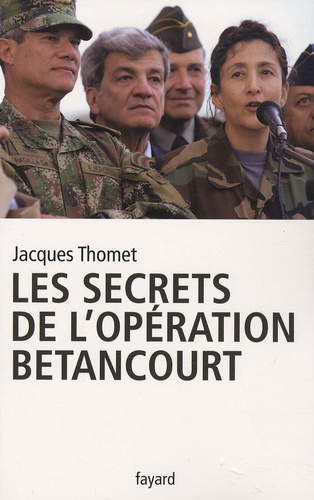
Actualité et médias
Les secrets de l'opération Bétancourt
10/2008
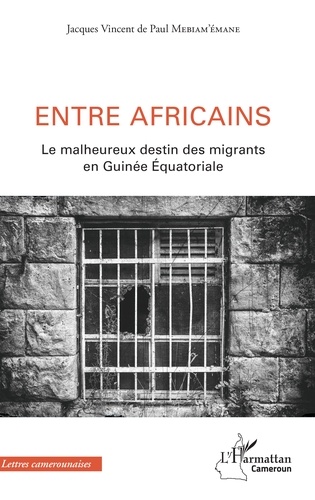
Littérature française
Entre africains. Le malheureux destin des migrants en Guinée Equatoriale
11/2018
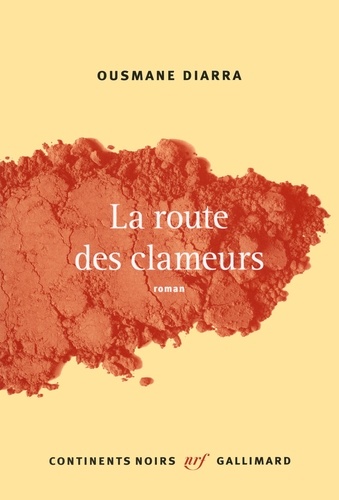
Littérature française
La route des clameurs
09/2014
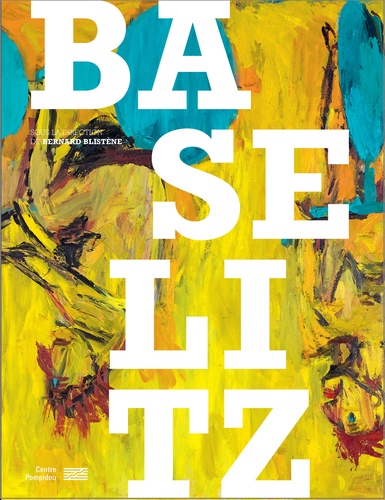
Art contemporain
Baselitz. La rétrospective
10/2021

