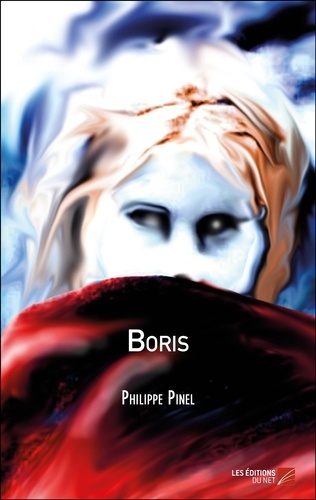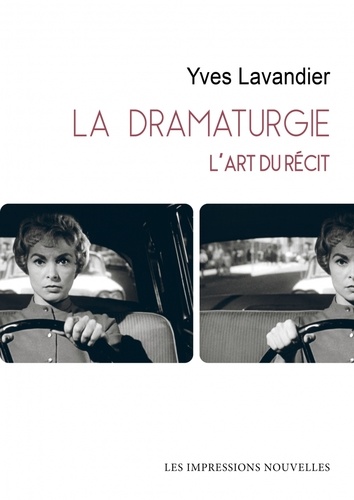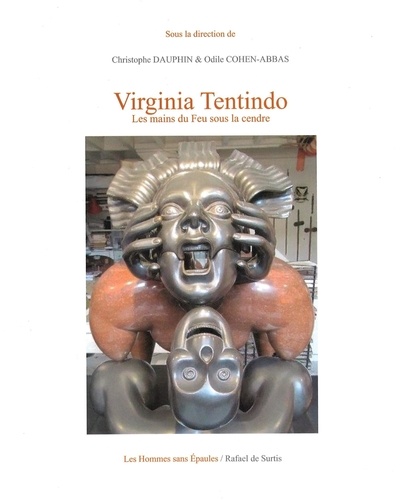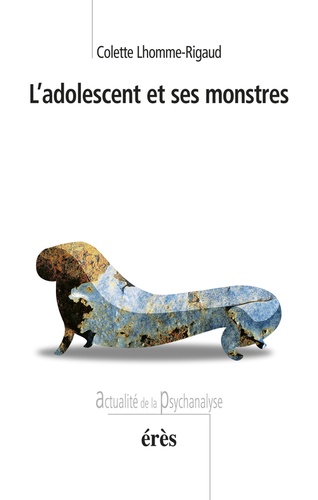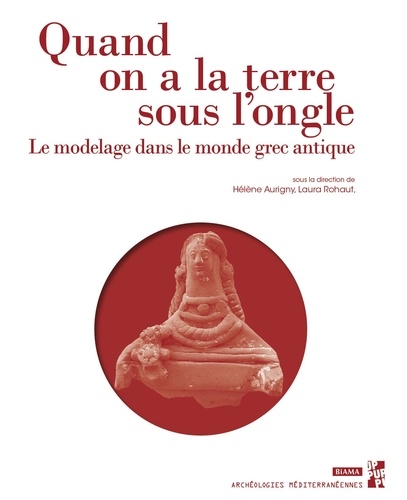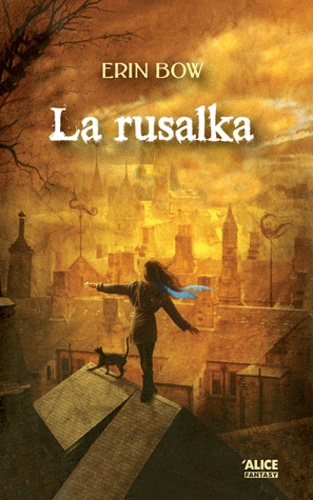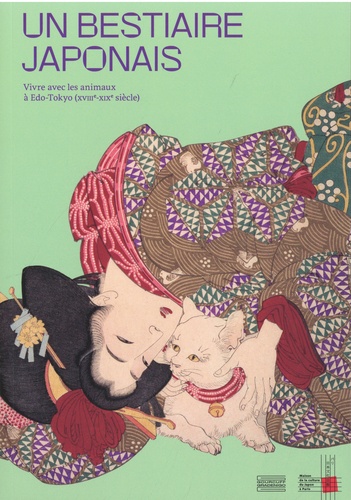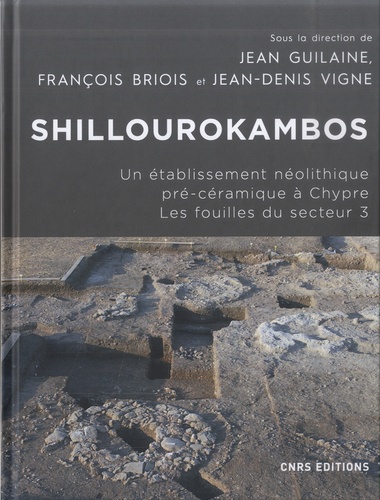L'Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique
Prenant part à la programmation culturelle des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, l'exposition propose au public de découvrir la création des premiers Jeux Olympiques modernes, d'en saisir le contexte politique et de comprendre comment et pourquoi ses organisateurs ont voulu réinventer les concours de la Grèce antique. A partir d'archives inédites, d'objets jamais montrés et d'oeuvres d'art antique emblématiques, elle montre comment cette réinvention repose sur une combinaison orientée des sources antiques (textes, images et vestiges), faisant de l'olympisme moderne une illusion collective mais efficace. Le catalogue qui l'accompagne prolonge et illustre cette perspective. Il rappelle comment Paris, trois fois capitale olympique (1900, 1924, 2024), a été aussi le berceau où est née en 1894 l'idée de l'olympisme moderne : les collections du Louvre et la formation des artistes de l'Ecole des Beaux-Arts, la Sorbonne, le Collège de France et les réformes de l'instruction ou encore le milieu philhellène de Paris, forment le cadre où ont évolué des personnalités célébrissimes, comme Pierre de Coubertin, ou mal connues ou inconnues du grand public, comme l'écrivain grec Démétrios Vikélas, le philologue français Michel Bréal ou l'artiste suisse Emile Gilliéron. Grâce à l'exploitation du fonds d'archives inédites de l'atelier de E. Gilliéron déposé récemment à l'Ecole française d'Athènes, il est aujourd'hui possible d'analyser précisément la fabrique de la première iconographique olympique, de 1896 à 1924, inspirée des images antiques et déclinée en affiches, trophées, médailles, timbres et cartes postales. A l'aide de documents d'époque, comme la chronophotographie, est aussi retracé le processus de réinvention de gestes sportifs grecs, comme le lancer du disque. Enfin le catalogue montre comment cette réinvention, qui est aussi une manipulation des sources, occasionne des dérives nationales ou internationales, des exclusions ou des stéréotypes dont les études classiques ont été d'une certaine manière les victimes. L'ensemble des textes qui composent le catalogue fournissent ainsi les clés pour comprendre les enjeux de l'olympisme moderne. Editeurs scientifiques : Christina Mitsopoulou est archéologue, formée à l'université de la Sorbonne et l'Université d'Athènes, en Histoire de l'Art et Archéologie grecque. Spécialiste de l'archéologie des cultes, de céramique, petits objets et d'iconographie, son activité de terrain a surtout porté sur la région des Cyclades et l'Attique (Eleusis). Par sa formation comme guide culturelle en Grèce elle tire aussi une expérience de la topographie et de la communication du savoir académique vers un plus grand public. Depuis 2013 elle a étendu ses recherches vers le domaine de l'histoire de l'archéologie et des questions d'authenticité en art antique. Enseignante à l'Université de Thessalie en Grèce, elle mène depuis 2017 un projet de recherches au sujet du fonds Gilliéron à l'Ecole française d'Athènes, d'où est issue la présente exposition. Alexandre Farnoux est professeur d'archéologie et d'histoire de l'art grec à Sorbonne Université depuis 2001. Ancien directeur de l'Ecole française d'Athènes (2011-2019), il a fouillé en Macédoine, dans les Cyclades et en Crète. Il mène des recherches sur la civilisation grecque, en particulier sur le sport, et en histoire de l'archéologie, par exemple sur A. Evans et la découverte de la Crète ou sur la réception d'Homère. Il a été co-commissaire en 2019 de l'exposition Homère au Louvre-Lens et de l'exposition Christian Zervos, le tournant archaïque, au musée Benaki à Athènes. Violaine Jeammet est conservatrice générale au département des Antiquités grecques, romaines et étrusques du musée du Louvre. Spécialiste des figurines en terre-cuite grecques et romaines et membre associée de l'UMR 8164-HALMA, , elle enseigne à l'Ecole du Louvre. Commissaire ou co-commissaire de nombreuses expositions, dont l'exposition Tanagra-Mythe et archéologie au Louvre en 2003, elle conduit des études plus particulièrement sur l'artisanat et la polychromie antique.
04/2024