urban
Extraits
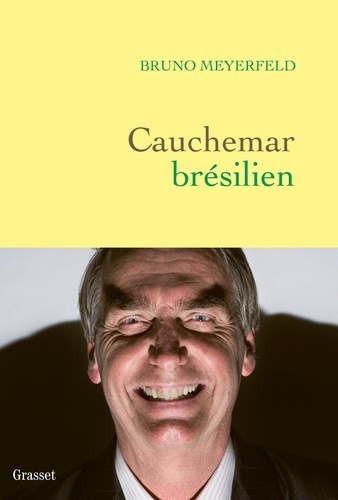
Brésil
Cauchemar brésilien. Histoire d'un grand pays et de son dictateur
09/2022

Sociologie
Contribution à une histoire du logement social en France au XXe siècle. Des bâtisseurs aux habitants, les HBM des États-Unis de Lyon
09/1997

Allemagne
Les chartes constitutionnelles des villes d'Allemagne du Sud (XIVe-XVe siècle)
04/2021
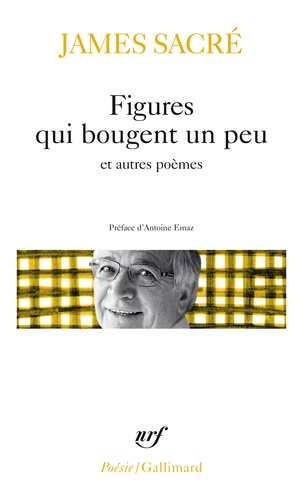
Poésie
Figures qui bougent un peu et autres poèmes
01/2016
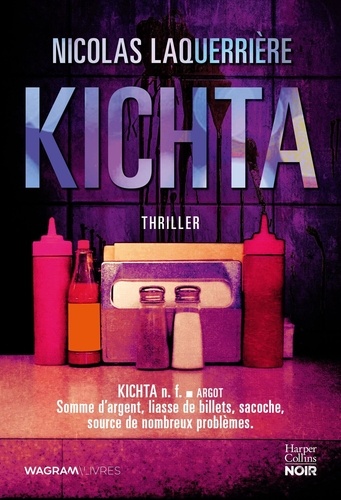
Thrillers
Kichta
03/2024
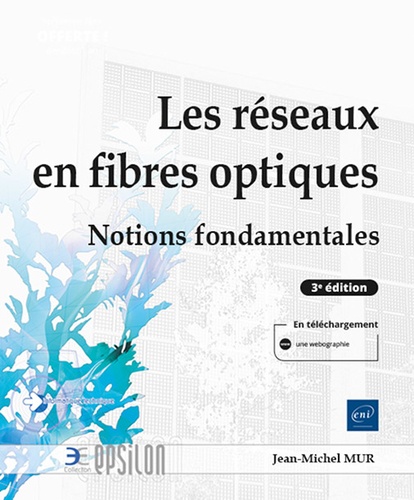
Télécommunications
Les réseaux en fibres optiques. Notions fondamentales, 4e édition
04/2024
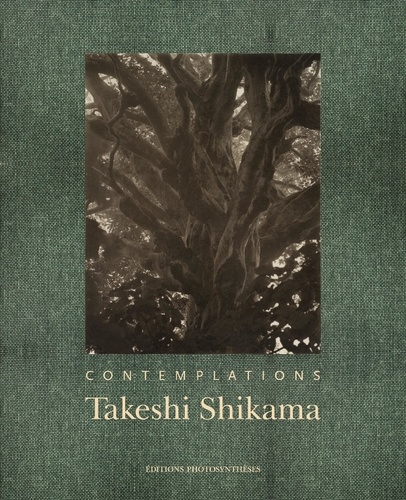
Photographes
Monographie
11/2022

Policiers
Riposte
03/2020

Beaux arts
Thomas Lanfranchi. Edition bilingue français-anglais
01/2021
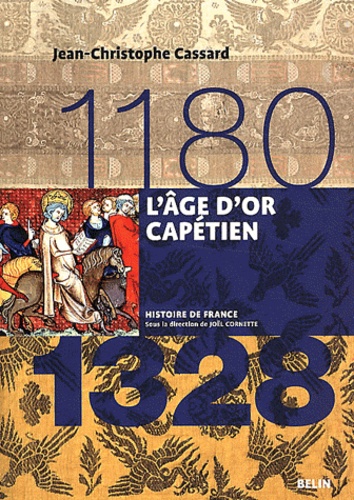
Histoire de France
L'âge d'or capétien (1180-1328)
12/2011

Littérature étrangère
Il y a mieux à vivre
03/2016

Sciences politiques
Merci l'Europe !
02/2019

Beaux arts
Architecture de la contre-révolution. L'armée française dans le Nord de l'Algérie
11/2019
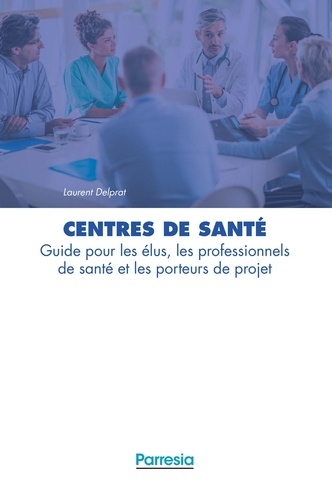
Spécialités médicales
Centres de santé. Guide pour les élus, les professionnels de santé et les porteurs de projet
11/2019
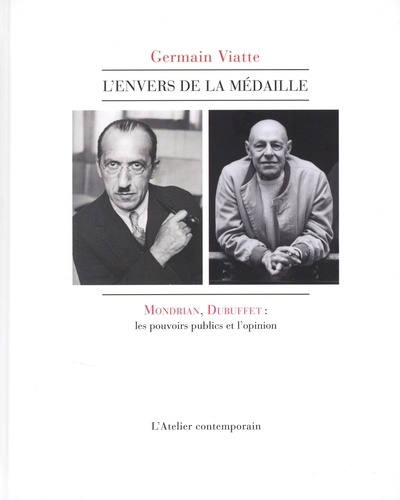
Ecrits sur l'art
L'envers de la médaille. Mondrian, Dubuffet : les pouvoirs publics et l'opinion
06/2021
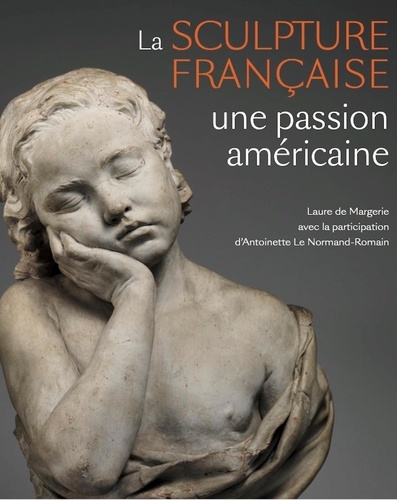
Sculpture
Sculpture française en Amérique. Une passion américaine
06/2023
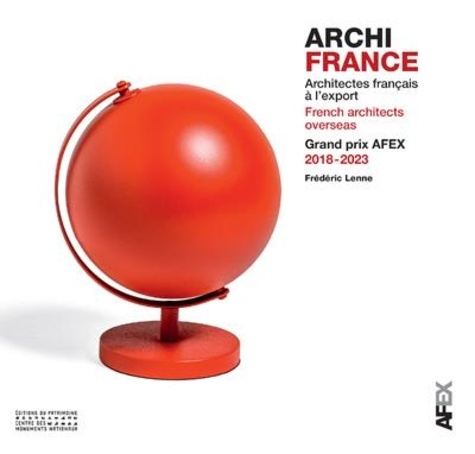
Architecture
Architecture française dans le monde. Edition bilingue français-anglais
10/2023
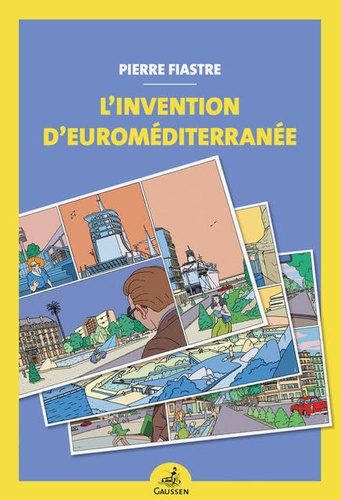
Essais
L’invention d’Euroméditerranée
09/2023
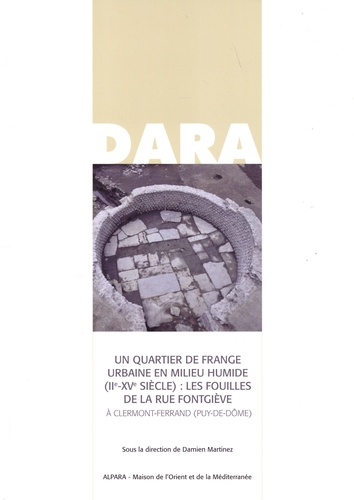
Archéologie
Un quartier de frange urbaine en milieu humide (IIe-XVe siècle) : les fouilles de la rue Fontgiève à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
10/2021
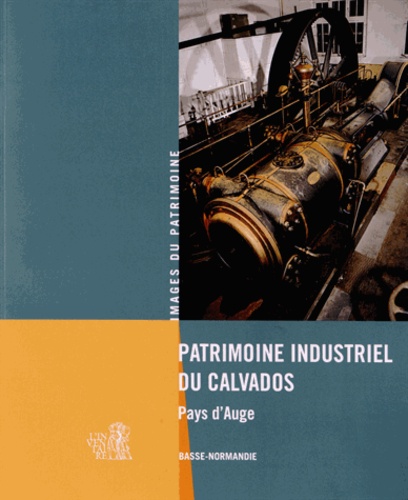
Beaux arts
Patrimoine industriel du Calvados. Pays dAuge
02/2013
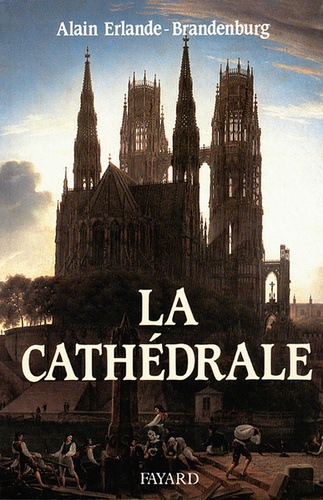
Histoire de France
La cathédrale
10/1989

Sociologie
L'origine des systèmes familiaux. Tome 1 : l'Eurasie
09/2011
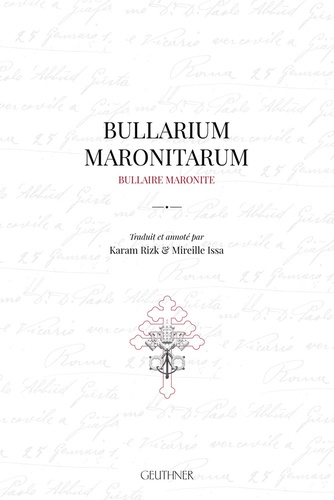
Religion
Bullarium maronitarum. Bullaire maronite
04/2019
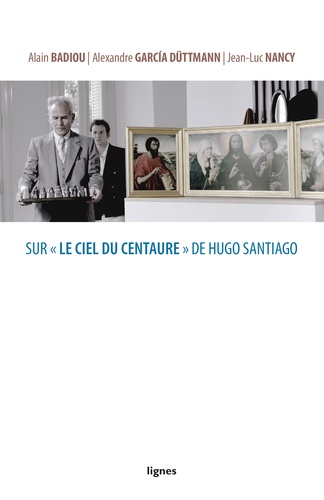
Cinéma
Sur "Le Ciel du Centaure" de Hugo Santiago
11/2016
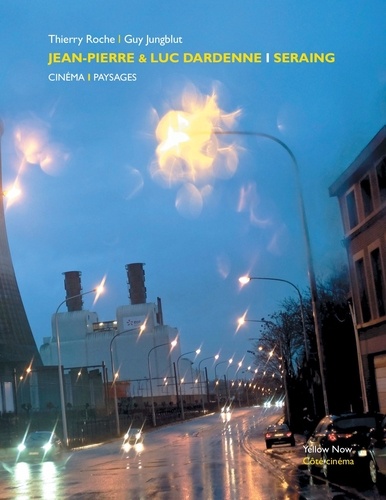
Cinéastes, réalisateurs
Jean-Pierre & Luc Dardenne / Seraing
03/2021
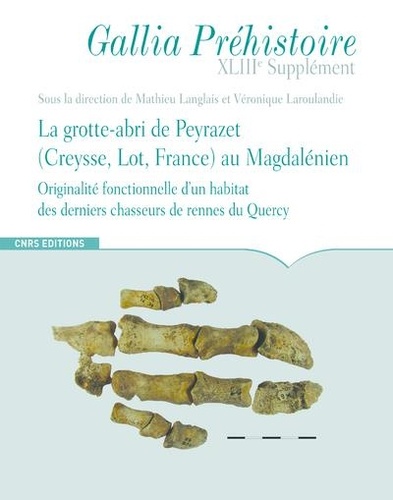
Archéologie
La villa gallo-romaine de Grigy à Metz
05/2021
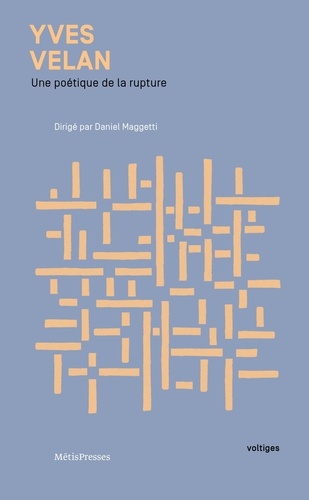
Littérature française
Yves Velan. Une poétique de la rupture
11/2023
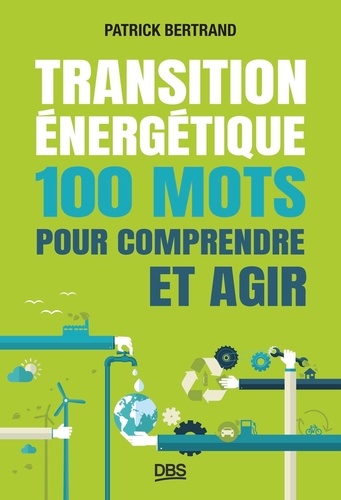
Energie
Transition énergétique. 100 mots pour comprendre et agir
02/2024
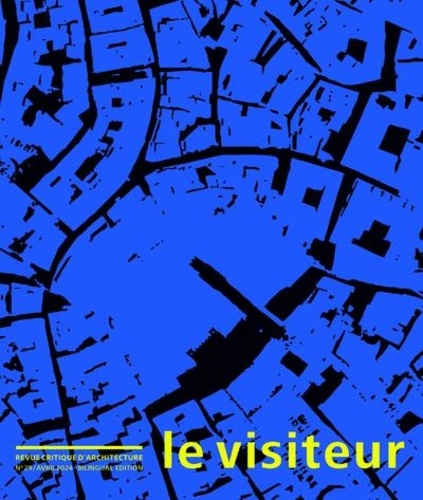
Architecture
Le Visiteur N° 29, avril 2024 : Le rêve européen. Edition bilingue français-anglais
04/2024
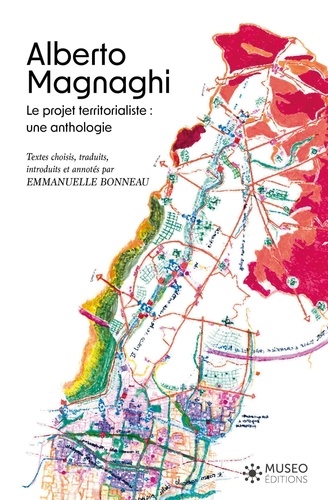
Urbanisme
Alberto Magnaghi. Le projet territorialiste : une anthologie
06/2024

